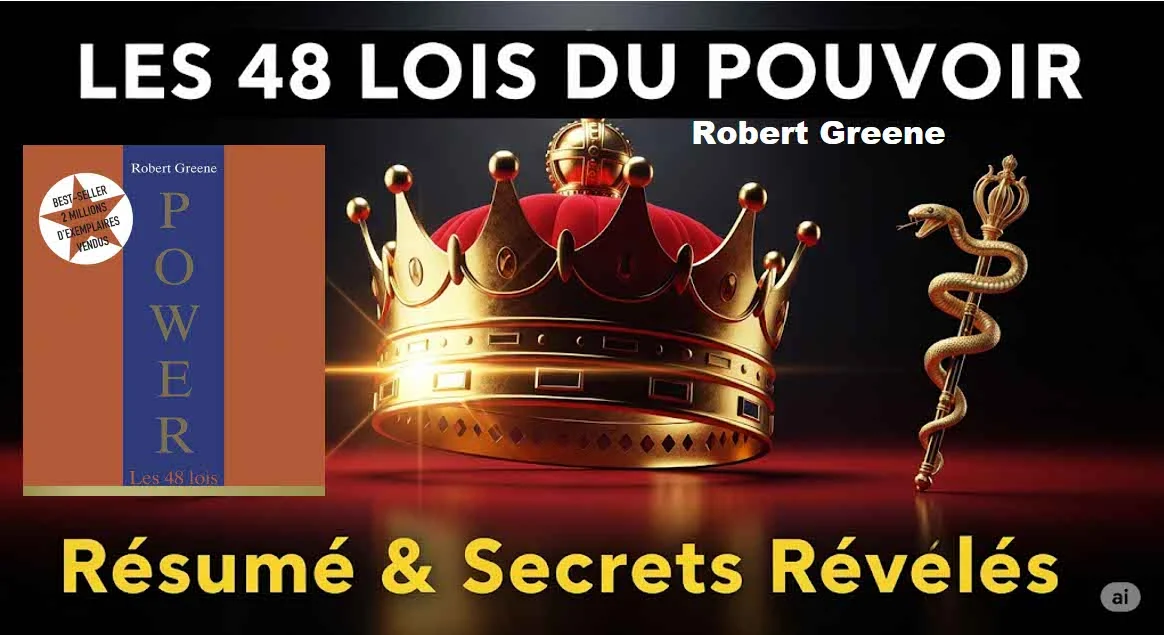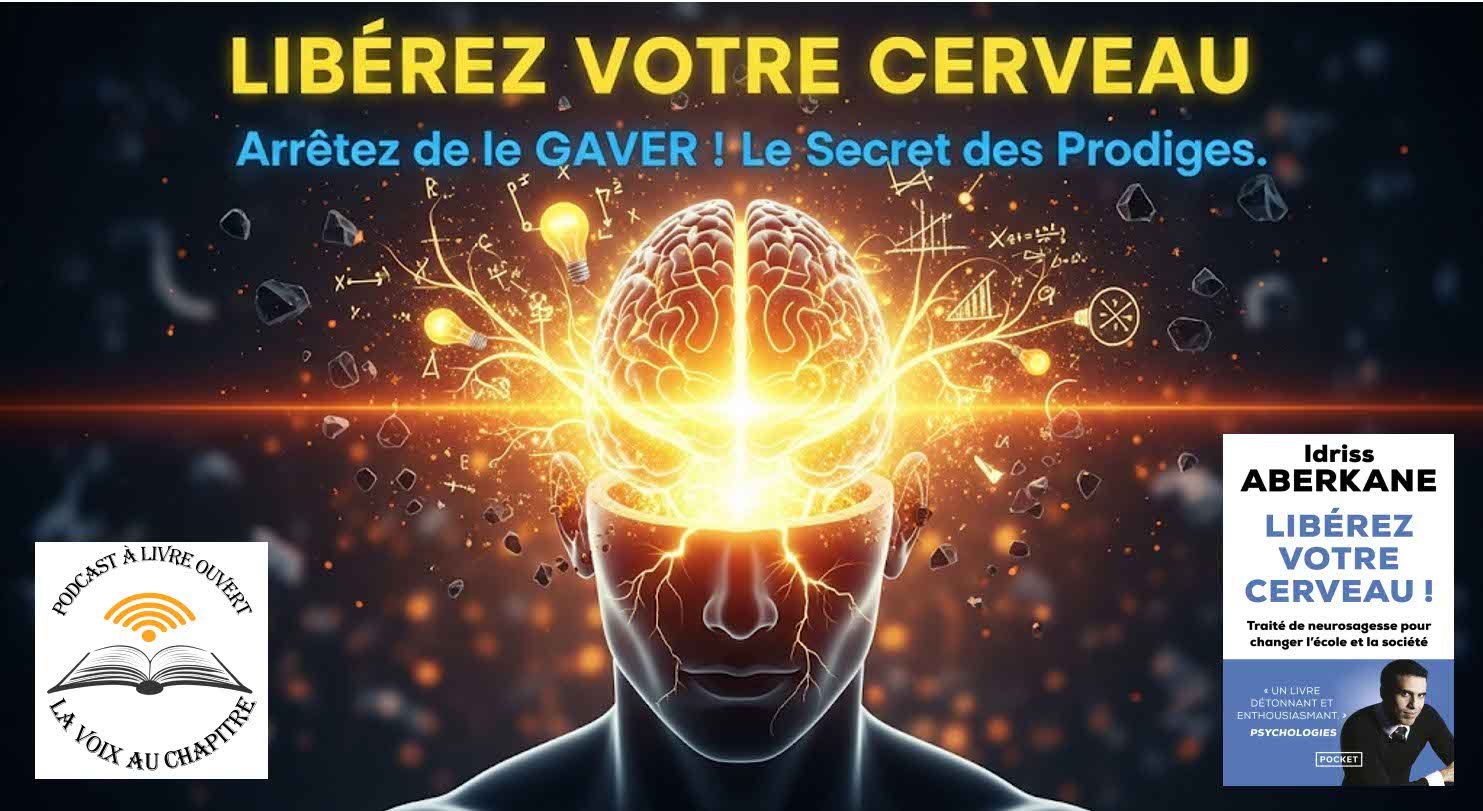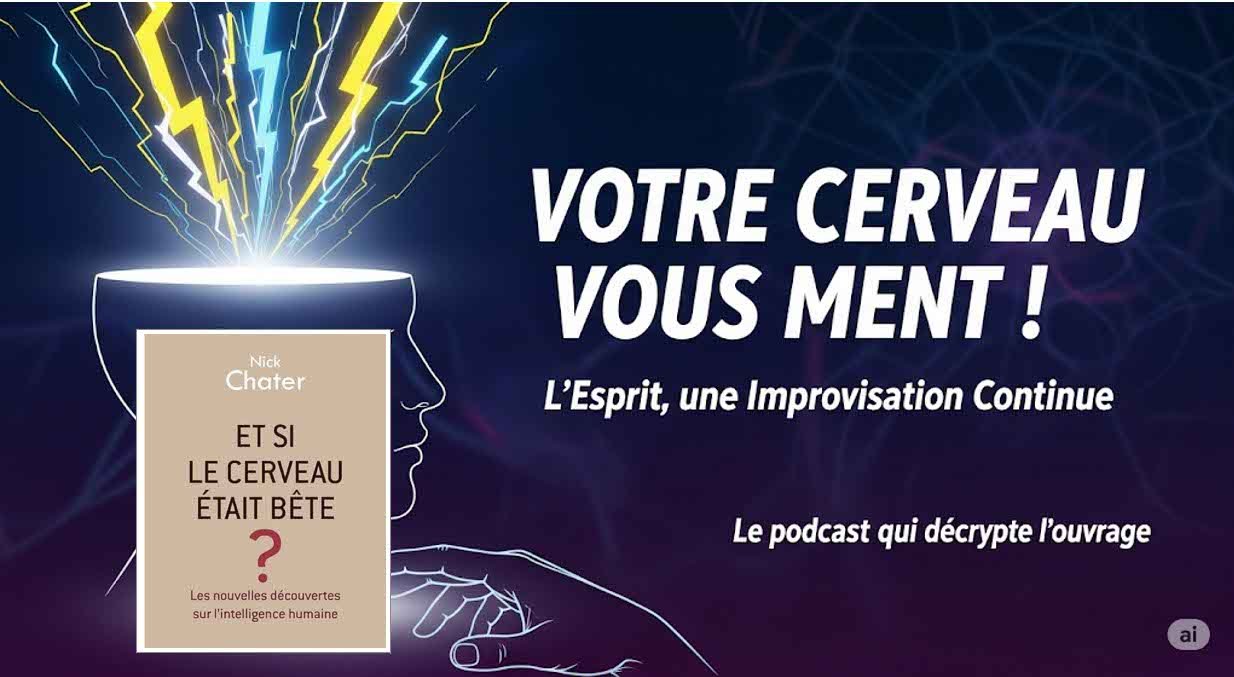Les liens pour vous procurer les différentes versions
📕Lien vers l’ebook : https://amzn.to/3Jem8WQ
Bienvenue, chers futurs romanciers et passionnés de littérature ! 🌟 Avez-vous déjà rêvé d’écrire un roman captivant, mais vous vous sentez dépassé par l’ampleur de la tâche ? « Write Away » d’Elizabeth George est le guide qu’il vous faut. Dans cet article, nous plongerons au cœur de cet ouvrage essentiel, en offrant un résumé détaillé et une analyse perspicace de son approche de l’artisanat de l’écriture. Préparez-vous à déverrouiller les secrets d’une narration puissante et à transformer vos idées en histoires inoubliables. 📖✨
Le Guide Ultime de l’Écriture de Romans : Analyse Approfondie de « Write Away » d’Elizabeth George ✍️📚
Elizabeth George, auteure à succès international de thrillers psychologiques se déroulant en Angleterre, offre dans « Write Away » une perspective unique et profondément pratique sur la manière d’écrire de la fiction. Loin des clichés sur l’inspiration divine et l’ineffable « don », George insiste sur la primauté de l’artisanat – les outils, les techniques et le processus – comme fondement de toute écriture réussie. Ce guide est une mine d’or pour quiconque souhaite comprendre les mécanismes sous-jacents à la création d’un roman crédible et captivant.
L’Artisanat avant l’Art : La Philosophie d’Elizabeth George 🛠️🎨
Dès la préface de son ouvrage, Elizabeth George défie une idée reçue tenace : celle que l’écriture ne peut être enseignée. Elle établit une distinction cruciale entre l’art et l’artisanat de l’écriture. L’art, c’est l’âme de l’artiste, la sensibilité, la passion innée, l’étincelle divine ; cela ne s’enseigne pas. En revanche, l’artisanat, c’est la maîtrise des principes fondamentaux de la fiction, des outils et des techniques que tout praticien doit apprendre et perfectionner. Elle compare l’écriture à d’autres disciplines artistiques comme la sculpture, la peinture à l’huile ou la composition musicale, où l’apprentissage des bases est universellement reconnu comme nécessaire avant d’aspirer à la grandeur.
Aux États-Unis, note-t-elle, la tradition des écrivains qui enseignent et transmettent leur savoir-faire est forte, contrairement à d’autres pays où l’écriture est perçue comme un processus mystérieux, compris intuitivement ou non. Des géants littéraires comme Saul Bellow, Toni Morrison ou Joyce Carol Oates ont tous été des enseignants, démystifiant ainsi le processus créatif et renforçant l’artisanat.
L’objectif de son livre n’est donc pas d’enseigner l’art ou la passion, mais bien l’artisanat pur. Ce savoir-faire, bien qu’il ne transforme pas n’importe qui en Shakespeare, sert de « guide, de terreau dans lequel un écrivain en herbe peut planter la graine de son idée afin de la nourrir dans une histoire ». La connaissance approfondie des outils du métier est essentielle, car elle offre une boussole lorsque l’écrivain rencontre des difficultés, évitant ainsi de dépendre d’une Muse inconstante. Chaque écrivain doit développer son propre processus, qui découle directement de l’artisanat. L’art, quant à lui, émerge lorsque l’écrivain se familiarise avec le métier.
Partie I : Un Aperçu de l’Artisanat – Les Fondamentaux 🏗️
Chapitre 1 : L’Histoire est le Personnage 🧍♀️🧍♂️
Elizabeth George commence son exploration de l’artisanat par le caractère, un choix qui surprendra peut-être ceux qui s’attendent à commencer par l’idée ou l’intrigue. Elle cite Isaac Bashevis Singer, qui affirme que l’analyse du caractère est le « plus grand divertissement humain » et que les écrivains qui négligent les personnages au profit des problèmes sociaux « enlèvent à la littérature son essence même ».
Son argument central est que l’histoire est le caractère. Sans comprendre que l’histoire est intrinsèquement liée au personnage, même l’éclair d’inspiration le plus intrigant ne pourra pas être insufflé de vie. Ce qui reste d’un bon roman, c’est avant tout le souvenir des personnages, car les événements ne prennent un sens profond que lorsque nous connaissons les personnes qui les vivent. Des classiques comme To Kill a Mockingbird résonnent grâce à la dignité de Tom Robinson et à la représentation héroïque d’Atticus Finch, non seulement en raison de l’idée sous-jacente. La liste des personnages littéraires inoubliables (Elizabeth Bennet, M. Darcy, Sherlock Holmes) prouve que ce sont les êtres créés par les écrivains qui brillent davantage que les histoires dans lesquelles ils évoluent.
Pour que le lecteur se soucie des personnages, ils doivent devenir de « vraies personnes ». George propose des lignes directrices fondamentales pour leur création :
- Donnez-leur des défauts : Les vraies personnes sont imparfaites, en développement. Les personnages parfaits sont « désagréables ». Sherlock Holmes, par exemple, possède un intellect parfait mais est un « trou noir émotionnel » et abuse de drogues, ce qui le rend mémorable.
- Permettez-leur de douter d’eux-mêmes : Le doute de soi est un point commun de l’humanité ; les lecteurs veulent voir des personnages qui font des erreurs et qui ont des faiblesses.
- Assurez-vous qu’ils grandissent et changent : Les personnages intéressants évoluent et apprennent des événements, révélant de nouvelles facettes au fur et à mesure que l’écrivain enlève les couches. Leur conflit, leur misère et leur confusion les rendent intéressants, tandis que la joie et la sécurité les privent d’histoire. Un exemple d’histoire sans conflit, comme celui d’un détective privé et de sa famille trop heureux, ne mène à aucune histoire.
- Mettez-les en conflit : Le conflit est l’essence même de l’histoire.
George utilise le terme « design » pour la création de personnages, se positionnant comme « maître architecte et entrepreneur général ». Le processus commence par le nom. Un nom n’est pas arbitraire ; c’est un outil pour révéler qui est la création. Les noms peuvent suggérer des traits de personnalité (Ebenezer Scrooge), des origines sociales/ethniques (Capitaine Ross Poldark), la géographie, l’attitude ou même des événements futurs. L’auteure donne l’exemple de son propre processus avec le personnage de Leo Swann, qu’elle a dû renommer Alexander Stone (Alex Stone) pour lui conférer la force et la détermination souhaitées.
Après le nom, George crée une analyse de personnage détaillée. Elle devient le « psychiatre, le psychanalyste, l’agent de probation et le biographe » du personnage. Cette connaissance préalable assure que le personnage est « en vie avant que le livre ne commence », permettant des réactions crédibles aux événements de l’intrigue et évitant la répétition. Le dialogue, comme le personnage, est fondamental. Il doit refléter la personnalité, l’éducation, le milieu économique, les attitudes, les croyances et la pathologie du personnage. L’exemple du dialogue de Bob Ewell dans To Kill a Mockingbird démontre comment les mots révèlent l’ignorance, le racisme et la haine d’un personnage sans narration explicite.
D’autres outils pour donner vie au personnage incluent le récit de son passé, comme le fait Toni Morrison avec Sethe dans Beloved, en utilisant des détails cruciaux et angoissants. Ces aperçus du passé enrichissent le personnage et le rendent plus crédible. Les bizarreries de personnalité et les détails révélateurs (ex: Annie Wilkes dans Misery, M. Bridge dans Mrs. Bridge) sont également essentiels, car la connaissance profonde des personnages permet à l’écrivain de savoir comment ils vont réagir, prévenant ainsi le blocage créatif.
En résumé : le personnage, c’est l’histoire ; le dialogue, c’est le personnage ; donner vie à un personnage dépend d’une connaissance complète et préalable, combinée à une utilisation judicieuse des dialogues et des détails révélateurs.
Chapitre 2 : Le Cadre est une Histoire 🏞️🏙️
Le cadre, ou décor, est la prochaine étape cruciale dans l’aperçu de l’artisanat. Elizabeth George affirme qu’un cadre bien exploré et pleinement utilisé n’est pas seulement une partie du personnage, mais peut aussi être une clé de l’intrigue, générant des idées et éclairant le thème.
Le cadre est défini comme l’endroit où se déroule l’histoire, incluant chaque lieu distinct où se déroulent les scènes individuelles. Ses fonctions sont multiples :
- Créer une ambiance : Le cadre guide la compréhension du lecteur quant au type de roman et établit une « sensation » qui déclenche l’ambiance et la réponse émotionnelle. L’exemple du brouillard « ténébrique » de Cambridge dans son propre roman Pour l’amour d’Elena démontre comment l’atmosphère du cadre peut préfigurer la confusion ou servir de toile de fond au désespoir.
- Révéler le caractère : C’est l’essence même du « montrez, ne dites pas ». L’environnement d’un personnage peut en dire long sur lui sans que l’écrivain n’ait à le dire directement. L’illustration magistrale de Roger Williams dans The Crown of Columbus de Michael Dorris et Louise Erdrich montre comment les détails de son appartement (le New York Times, le Brie danois, Bach puis Aretha Franklin) révèlent sa personnalité et son penchant pour le compromis, sans narration explicite.
- Agir comme un contraste : Le cadre peut contraster avec l’horreur qui s’y produit, intensifiant la réaction émotionnelle du lecteur. P.D. James place un double meurtre dans la sacristie silencieuse d’une église dans A Taste for Death, et T. Jefferson Parker utilise un cadre d’un « blanc immaculé » pour un cadavre incendié dans Laguna Heat, augmentant l’horreur et la crédibilité de la réaction du détective.
Quant au choix du cadre, George rejette le conseil « écrivez sur votre propre jardin » si celui-ci ne résonne pas avec l’écrivain. Elle insiste sur la nécessité de choisir un lieu que l’on désire connaître, explorer et décrire, un lieu qui évoque une « réponse personnelle et intensément viscérale ». Il est également crucial de pouvoir s’y rendre pour l’expérimenter avec les cinq sens, car les recherches documentaires seules ne suffisent pas à donner vie à un lieu.
Pour « rendre » un décor, et non seulement le « signaler », l’écrivain doit s’appuyer sur des détails spécifiques et révélateurs. Ces détails doivent être concrets et mis en action. L’exemple de Barbara Kingsolver dans The Bean Trees, décrivant le magasin de pneus « Jesus is Lord Used Tires » et les personnages qui l’habitent, montre comment la description du lieu et du personnage s’intègre parfaitement à la narration, la rendant inoubliable.
Chapitre 3 : Rien sans Paysage 🌍🗺️
Le troisième chapitre clarifie la distinction entre le paysage et le cadre, souvent confondus. Le cadre est le lieu spécifique d’une scène, tandis que le paysage est une perspective beaucoup plus large, « l’expérience totale du lieu dans un roman », un peu comme une toile de peintre sur laquelle les décors individuels sont placés.
Il est essentiel de penser au paysage, car le rendre réel pour le lecteur, c’est le faire s’approprier le pays lui-même, favorisant ainsi l’émotion et la connexion. Sans cela, le lecteur ne continuera pas à lire (à moins d’y être forcé par un professeur d’anglais ! ). L’auteure cite l’exemple de Wigan dans Rose de Martin Cruz Smith, une ville anglaise de l’ère industrielle dépeinte comme un enfer sur terre, sale, claustrophobe et polluée, rendue réelle par l’intégration continue de ses éléments tout au long du récit. L’écrivain doit « s’approprier » un lieu, qu’il soit imaginaire ou réel, pour que le lecteur ait l’impression d’y avoir été.
Au-delà du lieu physique, le paysage s’applique également aux personnages. Chaque personnage possède deux types de paysages :
- Le paysage extérieur : son apparence, ses vêtements, sa maison, son bureau, sa voiture, ses objets personnels. Tous ces éléments peuvent transmettre des informations au lecteur et ajouter à la caractérisation, incarnant le principe « montrer, ne pas dire ». L’exemple de tante Ida dans A Yellow Raft in Blue Water de Michael Dorris, avec sa salopette, ses bretelles de soutien-gorge saillantes, son épingle à cheveux dans la perruque et ses écouteurs, la rend inoubliable.
- Le paysage intérieur : les désirs, les besoins, les réflexions, les spéculations et les obsessions d’un personnage. Un personnage sans paysage intérieur risque d’être stéréotypé ; lui en donner un lui confère une « dignité humaine » et ajoute de la profondeur au roman. Les pensées de Chas Quilter dans Well-Schooled in Murder, révélant sa culpabilité, son désespoir et ses réflexions internes, illustrent comment le paysage intérieur peut être crucial pour la crédibilité de ses actions (son suicide imminent). George suggère même d’utiliser des objets de l’environnement d’un personnage, comme un réfrigérateur, une voiture ou des chaussures, pour refléter son état d’esprit.
Chapitre 4 : L’Intrigue : « C’est la Cause, Mon Âme » ⚙️💡
La question récurrente pour les écrivains est : « Où trouvez-vous vos idées ? ». Elizabeth George explique que les idées lui viennent de diverses sources, mais qu’elles ne sont jamais « un tout d’un seul tenant » ; elle doit les travailler. Les sources qu’elle identifie sont :
- Le caractère : Parfois, elle décide d’écrire sur un type de personnage particulier dans une situation donnée, et l’intrigue découle de là. L’exemple de Missing Joseph, où elle explore la mort d’une bonne personne par une autre bonne personne, montre comment des questions sur le motif du meurtre peuvent élargir l’idée et donner le début et la fin de l’histoire.
- Un défi : P.D. James l’a un jour mise au défi d’écrire une scène du point de vue du tueur après le meurtre, ce qui a donné naissance à For the Sake of Elena. De même, le défi de Sue Grafton l’a amenée à écrire In the Presence of the Enemy sur un enlèvement.
- Articles de journaux intrigants (Well-Schooled in Murder).
- Tournures de phrases séduisantes (Playing for the Ashes).
- Sujets intéressants (Deception on His Mind).
- Quelque chose entendu et jamais oublié (« Remember, I’ll Always Love You »).
Une fois l’idée initiale élargie, l’intrigue a besoin d’un événement principal qui « fait bouger la balle » et donne une direction au roman et à l’écrivain.
Pour avoir une histoire intéressante, le conflit est indispensable, même si beaucoup d’écrivains débutants l’oublient. Le conflit est une « collision », où les désirs d’un personnage rencontrent une forme de résistance. Cette résistance peut provenir de diverses sources :
- De l’intérieur du personnage (ex: l’esprit de Macbeth).
- De la nature (ex: le requin dans Les Dents de la Mer, la tempête dans A Perfect Storm).
- Du monde des esprits ou d’autres dimensions (ex: L’Exorciste, The Shining).
- D’une autre personne ou d’une situation.
Les événements doivent être organisés en mettant l’accent sur la causalité. George utilise l’analogie des « dominos dramatiques » : chaque événement (ou scène) doit en déclencher un autre, garantissant une progression logique et évitant que les personnages ne « recherchent une intrigue ».
L’intrigue doit également comporter des moments forts de drame, comme le meurtre, la découverte du corps, une menace, une course-poursuite, ou des scènes de conflit direct, de révélation ou d’épiphanie personnelle. Un roman doit avoir un point culminant, et ce point culminant doit lui-même avoir un « coup d’éclat » (un « bang within the bang »), comme la course-poursuite à travers les landes et le coup de feu final dans Missing Joseph. Après le point culminant vient la résolution, où les détails sont réglés et les changements de vie des personnages sont illustrés.
Le blocage de l’écrivain est souvent dû à un manque de préparation des personnages et à l’absence d’une « boîte à outils » de l’artisanat. Les écrivains expérimentés savent qu’il faut continuellement ouvrir l’histoire en posant des « questions dramatiques » et en faisant des « divulgations partielles », créant ainsi du suspense. Le suspense, pour George, est l’état de « vouloir savoir ce qui va arriver aux personnages et comment cela va leur arriver ». Le lecteur s’investit lorsque les personnages sont réels et évoquent une réponse émotionnelle. L’intention d’un personnage (ex: Richard III voulant le trône, Mme Bennet cherchant un mari pour ses filles) est un excellent moyen de créer de l’intérêt et de l’anticipation. L’utilisation du temps et des « promesses » faites au lecteur (comme une arme introduite tôt qui sera utilisée plus tard) renforce également le suspense.
T. Jefferson Parker a un jour dit : « Quand mon histoire me taraude la vue, j’ai joué mon jeu trop tôt ». Cette idée est cruciale pour George, qui gère soigneusement la divulgation des informations pour éviter que « le château de cartes ne s’effondre ».
Partie II : Les Bases – Construction du Roman 📝🏗️
Chapitre 5 : Oui, il y a plus sur l’intrigue. Mais d’abord… 🧠✨
Elizabeth George insiste sur une règle fondamentale qu’elle respecte : toujours planifier avant d’écrire et connaître la fin à l’avance. Elle ne se lance pas à l’aveugle, espérant que les personnages résoudront l’intrigue d’eux-mêmes. Son corps lui indique si l’histoire est la bonne ; elle ressent une « poussée d’excitation » dans son plexus solaire qui envoie le message « Oui oui oui ! » à son cerveau.
Une fois l’idée de base saisie, elle développe une idée d’histoire élargie en posant une série de questions. Pour Missing Joseph, l’idée de la mort d’une bonne personne par une autre bonne personne a mené à la question du motif : la victime devait savoir quelque chose que le tueur ne pouvait pas se permettre de révéler. Les questions secondaires, comme la méthode du meurtre, sont moins cruciales à ce stade que l’arc de l’histoire, qui va du crime à sa solution. L’idée développée pour Missing Joseph est qu’une femme tue parce que la victime sait que sa fille n’est pas la sienne, révélant la vérité sur son fils décédé.
C’est après l’idée développée que les personnages prennent forme. D’abord une liste générique (victime, tueur), puis une liste spécifique (Robin Sage, Juliet Spence), puis une analyse détaillée de chaque personnage. George martèle l’idée que les romans ne sont pas seulement une question d’intrigue, mais avant tout de personnage. L’analyse de personnage est un « récit au présent » en mode « flux de conscience », où l’auteure devient l’analyste, le psychologue du personnage, incluant plus d’informations qu’un vrai psychologue. Cela active le côté créatif de son cerveau.
Ce processus permet de révéler les éléments essentiels de l’intrigue, les relations entre les personnages, leurs forces et faiblesses, les conflits et le thème, et génère même des idées de sous-intrigues. L’auteure utilise une « feuille d’invite de personnage » (disponible en Partie III) comme aide-mémoire, mais la remplit librement. Les cinq domaines les plus importants de l’analyse sont :
- Le besoin fondamental du personnage : Ce besoin unique et essentiel qui façonne leur comportement et dont le déni mène à leur psychopathologie.
- Sa manœuvre pathologique : Comment le personnage réagit au stress, en particulier lorsque son besoin fondamental est contrecarré (ex: une personne impulsive qui ne supporte pas l’ennui fera des « bacts »). Le besoin fondamental et la manœuvre pathologique doivent être alignés.
- Sa sexualité : Ses attitudes et son histoire sexuelle, même si elles ne sont pas explicitement jouées dans le roman, influencent grandement ses actions.
- Une circonstance passée ayant eu un impact énorme : Cela permet de voir le personnage en action ou réaction avant l’écriture du roman, renforçant le personnage dans l’esprit de l’auteure. Souvent, une anecdote illustrant la personnalité est incluse, même si elle n’apparaît pas dans le roman.
- Ce que le personnage veut dans le roman (et dans chaque scène) : Les désirs peuvent être complexes, provenir de motifs mixtes et être influencés par le besoin fondamental.
L’analyse de personnage est cruciale car « il n’y a pas d’intrigue sans personnage » ; dans le débat de l’œuf et de la poule, les personnages viennent en premier.
Chapitre 6 : En Avant de l’Idée – La Planification Détaillée 📊✍️
Après avoir développé l’idée, les personnages et leurs analyses, Elizabeth George est enfin prête à planifier l’intrigue. Elle contraste sa méthode avec celle de son ami T. Jefferson Parker, qui écrivait sans plan, produisant brouillon après brouillon, une méthode qu’elle trouve folle et contre-productive. Pour elle, avoir un plan est essentiel.
Pour se donner une direction, elle crée deux types de plans :
- Le plan d’étape (step outline) : Une liste de scènes dans l’ordre chronologique où elles apparaîtront dans le roman. Ces scènes sont celles qu’elle envisage pour une section du roman, organisées pour montrer les relations causales. Chaque scène doit déclencher la suivante, comme des dominos. Ce plan, rédigé à la main, prend quelques heures et permet de voir la cohérence de la narration.
- Le plan d’intrigue courant (running plot outline) : Une fois le plan d’étape terminé, elle développe chaque scène en mode flux de conscience et au présent. Cela lui permet d’écrire sans se soucier des erreurs techniques (fautes de frappe, ponctuation, structure de phrase), se concentrant sur ce qui se passe dans la scène. Pour chaque scène, elle indique :
- Le point de vue (POV) utilisé.
- Ce qui va se passer.
- Le type de THAD (Talking Head Avoidance Device) : une activité qui se déroule dans une scène de dialogue pour éviter qu’elle ne devienne une simple conversation de « têtes parlantes ». Le THAD révèle le caractère, contient des informations et peut être une métaphore. Exemples : la pose de papier peint reflétant le trouble intérieur d’un personnage, le choix d’un pull pour un match, le sauvetage d’animaux.
- Descriptions, narrations et dialogues réels, ordres du jour des personnages et le but de la scène.
- Le blocage de la scène et le style d’entrée (in media res, dialogue, description). Le plan d’intrigue courant est un document détaillé qui lui permet de se concentrer sur l’art de l’écriture (langue, structure des phrases, transitions) lors de la rédaction du brouillon, car le travail d’artisanat a déjà été fait.
Elle met l’accent sur la crédibilité. Les personnages doivent agir de manière cohérente avec leur nature et ce qui se passe dans la scène, pas arbitrairement pour faire avancer l’intrigue. Chaque scène doit faire avancer l’intrigue principale, une sous-intrigue, le développement du personnage ou le thème. Si ce n’est pas le cas, la scène est jetée dès le stade de la planification, ce qui est plus efficace que de le faire après des heures d’écriture. Le conflit croissant est une exigence fondamentale de chaque scène.
Les sous-intrigues sont également essentielles pour un roman. Elles découlent généralement du thème et reflètent des éléments communs entre les personnages, comme les différents mariages dans Anna Karénine qui reflètent le thème des relations. Les sous-intrigues, comme l’intrigue principale, doivent avoir un conflit croissant, un point culminant et une résolution. L’auteure rappelle que les écrivains font une promesse au lecteur : celle que l’histoire arrivera à une « conclusion logique et inévitable ».
Chapitre 7 : Le Début : Décisions, Décisions – Les Ouvertures de Romans 🚪📖
Le début d’un roman est une décision cruciale. Elizabeth George propose trois alternatives pour commencer une histoire :
- Juste avant le début : Illustrer le statu quo émotionnel des personnages principaux avant l’événement principal. Cela permet d’accrocher le lecteur dans la vie du personnage en quelques paragraphes, car il peut s’identifier à ses expériences. L’exemple de The Horse Latitudes de Robert Ferrigno, qui plonge directement dans l’état émotionnel du personnage suite à son divorce, crée une connexion immédiate.
- Dès le début : Introduire simultanément les personnages et l’événement principal qui lance l’action. P.D. James utilise cette technique dans A Taste for Death, où la découverte des corps et l’introduction des personnages découvrants se produisent immédiatement.
- Après le début (in media res) : Commencer après que l’événement principal se soit produit, plongeant le lecteur directement au milieu de l’action. C’est le choix que George a fait pour son premier roman publié, A Great Deliverance, où le lecteur rencontre un prêtre en train d’éternuer et apprend qu’il se dirige vers Scotland Yard, créant intrigue sans révéler tous les détails immédiatement.
Quelle que soit la méthode choisie, l’ouverture doit posséder ou promettre de l’excitation, de l’intrigue ou un grand intérêt. Elle doit refléter les conflits, indiquer le thème, exposer un problème ou préfigurer des difficultés. L’atmosphère et le lieu doivent être établis, et les personnages (pas nécessairement les principaux) introduits. George encourage à faire confiance à son instinct (« votre corps ») plutôt qu’au « comité dans votre esprit ».
L’accroche (hook) est un outil fondamental pour maintenir le lecteur. Elle peut être une phrase, un paragraphe, une scène ou un chapitre entier, avec le double objectif de stimuler l’intérêt et d’établir l’ambiance. George identifie huit façons d’utiliser une accroche, souvent combinables :
- Nommer un personnage.
- Révéler un élément important de l’intrigue.
- Montrer une bizarrerie de personnalité.
- Illustrer l’attitude d’un personnage.
- Montrer le fonctionnement de l’esprit du narrateur.
- Donner un indice ou une préfiguration.
- Entraîner le lecteur dans l’excitation.
- Rendre un événement mystérieux ou plein de suspense.
Elle fournit des exemples classiques : Poe (« Le tonneau d’Amontillado »), Melville (Moby Dick), du Maurier (Rebecca), Dickens (Conte de deux cités), Shakespeare (Richard III), Ferrigno (The Horse Latitudes), et Follett (The Key to Rebecca). Ces exemples montrent comment plusieurs de ces techniques peuvent être utilisées simultanément pour créer une ouverture puissante. Lors de la planification de l’accroche, il faut penser aux détails spécifiques du lieu (ex: citrouille-lanterne, lumières de Noël), au personnage le plus approprié pour l’introduction, au dialogue pertinent et à l’utilisation d’un THAD.
Chapitre 8 : Comme il y a un point de vue, il y a aussi une voix 🗣️👁️
Le point de vue (POV) est « la décision prise par l’écrivain qui déterminera à travers les yeux de qui l’histoire va être racontée ». C’est crucial car il dramatise les événements, structure l’histoire et fait partie de l’idée artistique globale. Un POV cohérent établit l’autorité et la crédibilité de l’histoire.
George détaille les principaux types de POV :
- Point de vue objectif : L’écrivain reste en dehors des personnages, agissant comme un journaliste, ne donnant que les faits, sans pensées ni sentiments internes. C’est difficile à maîtriser car il demande une grande confiance dans le lecteur et dans la capacité de l’écrivain à affecter le lecteur par une description laconique des événements. L’exemple de « Camp indien » d’Ernest Hemingway illustre ce style distant, qui intensifie l’horreur par l’absence de réaction interne. Stephen King utilise également ce POV dans The Dead Zone pour créer une aura d’intrigue autour de M. Smith. Ce POV offre le moins d’intimité avec les personnages.
- Point de vue omniscient : Le narrateur est une sorte de dieu qui sait, voit et entend tout, pénétrant l’esprit de chaque personnage. Il permet d’explorer le thème, l’intrigue et le caractère en profondeur. Il requiert une main habile pour éviter la confusion et une forte voix narrative. L’ouverture de Second Nature d’Alice Hoffman est citée comme un bel exemple, où le narrateur agit comme un conteur qui révèle l’histoire et les cœurs des personnages, même sur de courtes pages.
- Points de vue à un seul personnage :
- Première personne (« Je ») : L’histoire est racontée par le personnage principal, offrant une forte identification et authenticité. Le personnage peut expliquer ses motivations et actions, rendant l’histoire crédible. Cependant, le narrateur étant toujours sur scène, la planification de l’intrigue doit être rigoureuse, et le lecteur ne voit que ce que le narrateur voit. L’exemple de Susan Isaacs dans Shining Through montre une personnalité et un ton distincts dès le début.
- Troisième personne (limitée à un seul personnage) : L’histoire est racontée à travers les yeux d’un seul personnage (« il » ou « elle »), filtrée par sa conscience. Les avantages sont similaires à la première personne (intimité, exploration des motivations), avec un seul style narratif à développer. Les inconvénients liés à l’intrigue sont les mêmes (le personnage doit être dans chaque scène). Martin Cruz Smith place résolument le lecteur dans le POV d’Arkady Renko dans Havana Bay, permettant de vivre La Havane comme il la découvre.
- Points de vue à plusieurs personnages :
- Première personne changeante : Chaque section ou chapitre est raconté par un narrateur « Je » différent. Cela permet de voir les mêmes événements sous des angles différents. Le défi est que chaque « Je » doit être totalement distinct en ton, style et syntaxe, et doit être cohérent tout au long du roman. Barbara Kingsolver réussit cela brillamment dans The Poisonwood Bible avec les voix uniques de Leah, Ruth May et Rachel Price.
- Troisième personne changeante : L’histoire est racontée à la troisième personne, mais le POV change de personnage en personnage (scène par scène, chapitre par chapitre). C’est le POV préféré de George, offrant la liberté d’entrer dans la tête de n’importe quel personnage, augmentant le suspense et la tension en laissant un personnage en suspens pour passer à un autre. L’inconvénient est la nécessité de créer des tons et des voix légèrement différents, mais subtils, et de bien rythmer le roman pour éviter les ralentissements. Les exemples de Ted Wiley et J.W. Pitchley dans A Traitor to Memory montrent des voix narratives distinctes malgré le même POV à la troisième personne.
Le choix du POV dépend des préférences personnelles, des compétences de l’écrivain et du personnage le mieux placé pour raconter l’histoire. Si de nombreuses scènes impliquent de nombreux personnages, un POV à plusieurs personnages est plus approprié. Si l’écrivain a un style littéraire fort et beaucoup à dire sur le thème, l’omniscient peut être un bon choix. Le narrateur peut être fiable ou non, sympathique ou antipathique, et la narration peut utiliser des lettres ou des journaux. La proximité ou la distance avec le personnage peut également être ajustée. En fin de compte, la voix narrative est cruciale pour le succès du choix du point de vue.
Chapitre 9 : Voix : Tu dois avoir ‘tude 🎶🎭
La voix narrative est « la façon déterminante de parler et de penser du personnage de point de vue ». Ce n’est pas le style de dialogue du personnage, mais le ton qui transparaît dans le récit lui-même lorsque ce personnage est le POV. Si le POV est unique, la voix est constante ; si le POV change, la voix change. George insiste : la voix du personnage n’est pas la vôtre, à moins que vous ne soyez le personnage. La voix découle de l’analyse de caractère préalablement créée, des aspects les plus saillants du personnage, de son besoin fondamental et de son attitude.
Les ingrédients spécifiques qui donnent vie à une voix sont :
- L’utilisation distinctive de la langue par un personnage : Comment le personnage assemble ses phrases lorsqu’il pense ou écrit, pas seulement lorsqu’il parle.
- Le vocabulaire et son utilisation des expressions idiomatiques : Le langage doit être approprié à l’origine et à la situation du personnage (ex: Les Aventures de Huckleberry Finn).
- Le ton du personnage : Développé par le choix des mots, comme le ton de la voix d’une personne.
- L’attitude du personnage (le plus important) : Elle différencie un personnage d’un autre plus que tout.
L’exemple de Robert Gabriel dans Payment in Blood montre comment sa voix reflète son narcissisme et son attitude envers les femmes, utilisant des termes comme « chevaucher-la » pour l’acte sexuel, tandis que Thomas Lynley dans Pour l’amour d’Elena chérit Hélène, reflétant un désir d’union. L’attitude révèle le caractère de manière cruciale, comme le snobisme de Lady Ursula dans A Taste for Death, qui évalue le manque de goût d’une lettre de condoléances après l’assassinat brutal de son fils.
Une attitude bien rendue crée un lien avec le lecteur, soit par une expérience de vie partagée, soit par une curiosité piquée. Le contraste entre les voix de Roger et Vivian dans The Crown of Columbus est un exemple éclatant : Roger, le professeur d’université méticuleux, s’exprime avec un langage formel et précis, tandis que Vivian, la mère enceinte, utilise un langage plus décontracté et des malapropismes, révélant leur personnalité distincte et leur « tude ».
Chapitre 10 : Dialogue : Prononcez le discours, si vous voulez 💬🗣️
Le dialogue, dans sa forme la plus simple, fait avancer l’histoire en révélant des informations, des accusations, des défenses, etc.. Cependant, un dialogue plus complexe et satisfaisant révèle également le personnage par ce qu’il dit et comment il le dit.
Le dialogue peut remplir de multiples fonctions :
- Préfiguration : Prédire des événements futurs. Dans « Le tonneau d’Amontillado » de Poe, le dialogue entre Fortunato et Montreessor préfigure la mort de Fortunato.
- Donner vie aux relations : Le dialogue rend les relations plus réelles que la narration seule, ajoutant à la force du récit. Les échanges entre Lynley et Havers dans For the Sake of Elena illustrent la nature de leur partenariat, leur confort mutuel, leurs taquineries et leur compréhension.
- Provoquer des révélations : Faire avancer l’intrigue, précipiter le point culminant ou les crises, et délimiter le conflit. L’établissement du conflit futur dans Mystic River de Dennis Lehane se fait à travers le dialogue tendu entre trois jeunes garçons.
Le dialogue doit sembler naturel et réel, même s’il ne peut pas l’être littéralement. George insiste sur le fait que la parole naturelle (avec ses hésitations, ses répétitions, ses reformulations) serait illisible et ressemblerait à des « transcriptions du Watergate » si elle était fidèlement retranscrite.
Pour y parvenir, l’écrivain doit :
- Développer une oreille attentive aux modèles de discours.
- Utiliser une syntaxe qui révèle le caractère (pédant, ordinaire, inculte).
- Intégrer des expressions idiomatiques appropriées et inventer des phrases propres à chaque personnage (ex: l’oncle Jake dans The Sky Fisherman et son mot « négation », le Dr Larch dans The Cider House Rules et ses « Princes du Maine »).
- Varier les affirmations simples comme « Oui » pour différencier les personnages (Yeah, Yep, Sure, etc.).
- Suggérer le vernaculaire régional plutôt que de l’orthographier phonétiquement, ce qui attirerait l’attention sur la forme plutôt que sur le contenu (ex: le discours des femmes du Sud dans Light in August de Faulkner).
- Utiliser des moyens subtils pour rendre le dialogue distinct, comme les modes de langage de Lynley et Havers, reflétant leur classe et éducation.
Le dialogue doit être concis, éviter de prêcher ou de traiter trop d’idées à la fois, et ne jamais être manifestement explicatif. Il doit être pertinent pour l’intrigue, le conflit, le thème, la sous-intrigue ou le développement du personnage, et faire avancer la tension de l’histoire.
Chapitre 11 : Les Ficelles du Commerce du Dialogue 🤫🏷️
Le dialogue est un outil puissant qui, bien manié, peut soutenir chaque élément d’une histoire.
- Le sous-texte est ce dont les personnages parlent réellement derrière ce qu’ils semblent dire. Il découle de la connaissance approfondie des personnages et de leurs problèmes. George contraste un dialogue direct sans sous-texte (couple en lune de miel) avec un dialogue riche en sous-texte (Lynley et Hélène), où les non-dits colorent la scène et l’ancrent dans la réalité.
- Les taglines (balises de dialogue comme « dit-il », « répondit-elle ») et leurs modificateurs identifient l’orateur. George recommande d’utiliser « dit » car l’œil du lecteur le filtre facilement, tandis que les balises plus « sophistiquées » comme « grogna », « gémit » attirent l’attention sur elles-mêmes et doivent être utilisées avec parcimonie. De même, les adverbes (ex: « dit avec engourdissement ») doivent être utilisés avec prudence pour ne pas détourner l’attention de ce qui est dit.
- Évitez les mots inutiles (junk words) qui encombrent la page, à moins qu’ils ne soient idiomatiques ou ne révèlent le caractère.
- Pour le dialecte, suggérez-le plutôt que d’utiliser une orthographe phonétique complète, ce qui est plus facile pour le lecteur et l’écrivain. Pour les langues étrangères, une traduction immédiate ou contextuelle est préférable.
- Les discours longs : s’ils sont nécessaires, rendez-les importants, enregistrez les réactions des autres personnages, et interrompez-les avec des moments d’action thématique pour maintenir l’intérêt.
- Le dialogue indirect est une forme résumée de dialogue narrée, utile pour condenser la parole, modifier le rythme et donner au lecteur une pause, tout en révélant l’attitude du personnage. L’exemple de E.M. Forster dans A Passage to India montre comment le dialogue indirect permet d’abréger une discussion longue sans perdre son essence.
Lors de l’évaluation du dialogue, l’écrivain doit s’assurer qu’il ajoute de la tension, démontre le conflit, que chaque personnage a une voix distincte, qu’il est exempt de clichés (sauf si intentionnel), et qu’il révèle le caractère. Un bon dialogue sert de multiples objectifs sans gaspiller de mots.
Chapitre 12 : La Scène : D’accord, c’est sorcier 🎬✨
L’écriture d’un roman se fait « une scène à la fois ». Il faut d’abord décider si une scène est nécessaire ou si une simple narration dramatique suffirait.
- La narration sommaire est une forme abrégée et économique qui rapporte les actions plutôt que de les rendre. L’exemple de E.M. Forster dans A Passage to India montre comment elle permet de faire avancer rapidement l’histoire sans s’attarder sur les détails, en changeant le rythme de la scène.
- La narration dramatique prolongée rend les actions avec plus de détails, permettant aux personnages de grandir et aux conflits de se développer, utilisant des figures de style. « Revenge » de Jim Harrison est un exemple où le narrateur omniscient rapporte la découverte d’un corps blessé, montrant les événements avec force sans dialogue.
- Une scène entièrement jouée place le lecteur comme témoin des actions et des conversations, rendant l’expérience plus vivante. L’exemple de P.D. James dans A Taste for Death montre une scène jouée entièrement du point de vue d’un personnage, y compris son conflit et sa résolution, même si ces personnages n’apparaissent qu’une seule fois dans le roman.
- Les scènes partielles combinent narration et dialogue, comme dans Cider House Rules de John Irving, où la narration est interrompue par de brefs échanges dialogués.
Chaque scène, quel que soit son type, doit être structurée comme une histoire complète : elle doit commencer à un point bas, voir la tension monter à mesure que le conflit s’intensifie, atteindre un point culminant et se terminer par une résolution qui propulse le roman vers l’avant. L’exemple de la scène entre Barbara Havers et Lynley dans Payment in Blood illustre cette structure où la tension monte avant de trouver une résolution qui fait avancer l’intrigue.
Les scènes peuvent varier dans leur construction :
- Établissement-action-dialogue : Commencer par planter le décor, puis introduire l’action, et enfin le dialogue. L’exemple de For the Sake of Elena montre la « caméra » se rapprochant du poste de police de Cambridge, puis Lynley observant, avant que l’action et le dialogue ne commencent à l’intérieur.
- Son par rapport à la vue : Commencer par le dialogue, reculer pour planter le décor, puis revenir au dialogue et à l’action. L’ouverture d’un chapitre dans En présence de l’ennemi utilise cette technique, commençant par la parole avant de situer la scène.
- Présent-passé-présent : Démarrer la scène en temps réel, s’arrêter pour revenir sur une action passée afin de mettre le lecteur à jour, puis revenir au temps présent. Cette structure permet de résumer des événements passés plutôt que de les rejouer, comme dans A Suitable Vengeance.
- Débuts simples avec l’heure de la journée ou le temps écoulé.
- Plongée immédiate dans l’action (in media res) sans autres constructions, comme dans For the Sake of Elena, où le personnage est introduit et l’action commence immédiatement.
La seule règle est « tout ce qui fonctionne, fonctionne », tant que cela implique un conflit croissant, un point culminant et une résolution.
Partie III : Technique – Le Pouvoir de la Maîtrise 💡🔧
Chapitre 13 : La Connaissance est le Pouvoir, la Technique est la Gloire 🧠💪
Elizabeth George soutient qu’une bonne écriture repose sur la compréhension de l’artisanat. Cette compréhension vient de la connaissance des outils et de leur utilisation habile, ce qui nécessite une familiarité avec le langage et sa construction.
Elle recommande de maîtriser les bases de la langue, comme la construction des phrases. Comprendre les différents types de phrases (simples, complexes, fragmentées, longues) permet de manipuler le langage pour modifier l’ambiance et émouvoir le lecteur. Ce savoir confère du « pouvoir » et de la « sagesse », même si on peut écrire sans le connaître consciemment.
Les phrases sont utilisées pour construire des paragraphes, qui sont des collections de phrases unifiées par un sujet dominant, explicite ou implicite. George illustre cela avec des exemples de Lord of the Flies de William Golding : un paragraphe sur le récif où le sujet est énoncé directement, et un autre sur les conséquences de la mort de Simon où le sujet (le changement) est implicite. Chaque phrase d’un paragraphe doit amplifier la précédente ou se rapporter au sujet central ; sinon, elle doit être supprimée pour ne pas entraver le flux narratif.
La connexion des paragraphes par des transitions est cruciale pour propulser le lecteur à travers l’histoire. Les paragraphes doivent être liés de manière transparente, la dernière phrase d’un paragraphe étant soit directement liée à la première du suivant, soit agissant comme une invite. L’exemple de son roman Deception on His Mind montre comment les transitions maintiennent un flux continu de pensée et d’information, créant une expérience « séduisante et mystérieuse » pour le lecteur.
L’unité est primordiale dans un roman, et la plupart des romans sont unifiés autour de leur thème. Le thème est la « vérité fondamentale » ou l’idée centrale que l’écrivain explore. Les conflits et difficultés des personnages reflètent généralement ce thème. Le thème peut être connu à l’avance (ex: A Great Deliverance sur le lâcher-prise du passé, Payment in Blood sur la trahison) ou émerger pendant le processus d’écriture (ex: For the Sake of Elena sur les décisions des femmes). Connaître le thème à l’avance permet de planifier les sous-intrigues de manière cohérente.
Le thème peut être abordé directement dans une scène, comme P.D. James le fait dans A Taste for Death avec la culpabilité de Massingham envers son père, qui se répercute sur son attitude envers sa collègue Kate Miskin. Il peut également englober l’arc entier de l’histoire, comme dans Absalom! Absalom! de William Faulkner, où le thème des préjugés raciaux se manifeste dans la vie du colonel Sutpen jusqu’à son descendant. L’unité est assurée en s’assurant que chaque scène, paragraphe et phrase fait avancer l’intrigue, aborde une idée centrale et un point spécifique.
Chapitre 14 : Les Derniers Détails – Le Suspense et les Indices 🕵️♀️🔍
Elizabeth George considère le suspense comme l’un des éléments les plus incompris de la fiction. Pour elle, le suspense est « tout ce que l’écrivain fait… pour que le lecteur tourne les pages de son livre ». L’objectif est de capter et de maintenir l’intérêt du lecteur du début à la fin. Le suspense se nourrit du désir du lecteur de savoir ce qui va arriver aux personnages, à la situation et à l’intrigue, et comment cela va se produire. L’art du suspense consiste à créer un « grand ne veut pas », c’est-à-dire une telle curiosité que le lecteur ne peut pas lâcher le livre.
Le secret du suspense est simple : faire en sorte que le lecteur se soucie des personnages. Quand on se soucie, on continue à lire. L’exemple de Horse Latitudes de Robert Ferrigno, avec son personnage profondément blessé par l’amour, montre comment l’identification du lecteur à une expérience commune crée un puissant suspense.
Au-delà de l’intrigue et des personnages, il existe des dispositifs pour créer du suspense, à utiliser avec parcimonie pour éviter l’effet « appareil » qui sort le lecteur de l’histoire :
- Mettre un personnage en danger : Cela peut être physique (bord de falaise, poursuite) ou confrontationnel. Les scènes de poursuite sont aussi un classique.
- La violence ou le meurtre : S’ils sont sur la page, ils créent du suspense, et ce n’est pas l’apanage des romans policiers (Faulkner, Dickens, Shakespeare l’utilisent).
- Le combat : La violence physique ou une grande attaque verbale augmentent la tension.
- Une découverte capitale : Une révélation d’information qui propulse l’histoire vers l’avant.
- La course contre la montre : Les personnages luttent contre un délai (thrillers).
- Le MacGuffin : Un objet que tout le monde recherche, la course pour le posséder crée le suspense (ex: Le Faucon maltais).
- Les promesses à long terme par la préfiguration (l’arme introduite doit être utilisée) et les questions dramatiques non résolues.
La structure du roman, avec ses points d’intrigue (moments critiques où les événements changent, des décisions sont prises ou des découvertes faites), est cruciale pour le suspense. George conseille aux écrivains de faire confiance à leur instinct (« leur corps ») pour raconter des histoires, car il ne mentira jamais sur le rythme, les personnages ou l’histoire, contrairement à l’esprit ou à un « comité » interne.
Pour les romans policiers, la connaissance des indices et des faux-fuyants est essentielle.
- Les indices sont des informations (objets matériels, biologiques, absence de quelque chose, timing, déclarations verbales, antécédents) qui, correctement interprétées, peuvent permettre au lecteur de résoudre l’affaire.
- Les faux-fuyants sont des éléments plantés pour tromper le lecteur, le menant à croire que quelqu’un d’autre est coupable, ou des « faux indices » où les personnages mentent. Ils doivent avoir une explication logique dans l’intrigue.
- Agatha Christie est la « reine de l’indice et du placement de diversion » ; elle intègre l’indice de manière subtile, la scène tournant autour de la diversion. L’écrivain doit jouer franc jeu, s’assurer que les indices surgissent naturellement et ne pas laisser le détective de l’histoire ignorer les indices que le lecteur a vus.
Partie IV : Processus – Le Chemin de l’Écrivain 🚶♀️🗺️
Chapitre 15 : Les Petits Pas D’abord – Mon Processus d’Écriture 👣📝
Pour Elizabeth George, développer son propre processus d’écriture est fondamental. Cela évite le blocage de l’écrivain, transforme la tâche effrayante en une joie, et permet de ne pas être à la merci d’une Muse capricieuse. Son processus personnel, affiné au cours de la création de douze livres, se décompose en quatorze étapes essentielles :
- L’Idée et l’Idée Élargie : L’idée doit être une « pensée complète » contenant un événement principal, l’arc de l’histoire (début, milieu, fin) ou une situation intrigante suggérant des personnages en conflit. Pour En présence de l’ennemi, l’idée a évolué d’un enlèvement à celui de l’enfant illégitime d’un député, générant une cascade de questions qui ont formé l’idée élargie (qui est le père, pourquoi ne pas impliquer la police, etc.).
- Peupler le Monde : Lister les personnages génériquement, puis spécifiquement avec noms et âges.
- La Recherche : Examiner l’idée développée pour déterminer les informations nécessaires. Pour En présence de l’ennemi, cela a impliqué des recherches approfondies sur la Chambre des communes, les tabloïds britanniques, les procédures policières d’enlèvement et meurtre, et la recherche de lieux de détention et de découverte du corps en Angleterre (Londres, Somerset, Wiltshire). Elle voyage toujours en Angleterre pour la recherche, interviewe des experts (comme le correspondant de la BBC pour le Parlement), visite des lieux réels, photographie et enregistre ses observations, puis les transcrit.
- Créer les Personnages : Retour aux États-Unis pour la création approfondie des personnages. Elle commence par des noms qui résonnent et reflètent la position sociale. Puis, en mode flux de conscience, elle écrit librement sur leur développement et leur vie, en se référant à une « feuille d’invite de personnage » pour rester sur la bonne voie. Chaque analyse fait généralement trois à quatre pages, et le processus révèle des éléments d’intrigue, le thème et les sous-intrigues.
- Créer le(s) Cadre(s) : Après les personnages, le cadre exact est développé. George ne croit pas aux décors génériques et insiste sur l’authenticité, même si cela signifie créer des lieux composites à partir de sites réels (ex: Bredgar Chambers, St. Stephen’s College). Elle affiche des cartes de ses décors dans son bureau.
- Le Plan d’Étape : Lister tous les événements de l’histoire générés à partir de l’événement primaire, assurant des relations de cause à effet. Ils sont organisés dans le « meilleur ordre dramatique » pour que l’histoire continue de s’ouvrir. Elle le fait à la main.
- Le Plan d’Intrigue : Transformer le plan d’étape en un « plan d’intrigue courant » détaillé, en mode flux de conscience, décrivant chaque scène avec POV, THAD, dialogue, action, etc..
- Écrire le Premier Brouillon : Se concentrer sur « l’art de notre langue ». Elle vise 5 pages par jour et continue d’avancer jusqu’à la fin du brouillon, acceptant les surprises et les nouvelles idées tout en évitant les digressions.
- La Lecture Rapide : Lire une copie papier du brouillon en un minimum de sessions (un ou deux jours), sans faire de changements immédiats. Elle note les faiblesses, les répétitions, les passages peu clairs, les personnages qui n’émergent pas bien, et les moments « OTT » (over the top).
- La Lettre Éditoriale : Écrire une lettre à elle-même, se guidant pour la deuxième ébauche, identifiant les clarifications nécessaires sur les personnages, les sous-intrigues ou la structure pour améliorer le rythme.
- La Deuxième Ébauche : Travailler directement sur la copie papier (pas sur l’écran d’ordinateur pour avoir une vue d’ensemble), en supprimant, ajoutant, déplaçant, coupant et collant. Elle vise environ 50 pages par jour à ce stade.
- Le Lecteur Froid : Une fois la deuxième ébauche tapée et imprimée, elle la confie à un « lecteur froid » (ami, non-écrivain, lecteur assidu, familier avec son travail), auquel elle fournit des questions spécifiques sur ce qu’elle souhaite évaluer.
- La Troisième Ébauche : Si nécessaire, basée sur les retours du lecteur froid.
- Célébrer 🎉 : Le roman est terminé.
Chapitre 16 : La Valeur de la Colle Bum (Bum Glue) 🧘♀️💻
Elizabeth George met en avant le concept de « bum glue » (colle à fesses) de Bryce Courtenay : la capacité de rester fermement assis sur sa chaise pour écrire. Pour elle, c’est la clé de la réussite. Elle a toujours su qu’elle devait écrire, dès l’âge de sept ans. Sa mère l’a encouragée en lui offrant des livres à Noël, l’habituant à la vie d’écrivain. Après un premier roman adolescent et de nombreuses nouvelles, elle a écrit The Glass Pillar au lycée.
Le tournant est venu en 1983, lorsqu’elle a acheté un PC IBM. Face à la question existentielle de regretter de ne pas avoir écrit un roman, elle a décidé d’agir. Elle a écrit son premier brouillon adulte, Something to Hide, en un été. Bien que ce roman ait été rejeté, des éditeurs ont complimenté son écriture, la motivant à continuer.
Son troisième roman, A Great Deliverance, a été rédigé en trois semaines et demie et a été vendu à Bantam Books. Elle a travaillé 8 à 16 heures par jour pour le terminer dans les 42 jours avant de reprendre l’enseignement. Trois convictions l’ont portée :
- Écrire ce que l’on veut, pas ce que l’on pense qui va se vendre : Elle voulait écrire un roman policier britannique dans la tradition de l’âge d’or, le genre qu’elle aimait lire.
- Écrire sur sa passion : L’Angleterre.
- Écrire sur ce qui l’intéresse : La psychopathologie humaine et la psychopathologie de la famille.
La « colle à fesses » est donc un engagement envers soi-même, son rêve et le processus. Les bénéfices de l’écriture incluent les voyages, les rencontres (autres écrivains, lecteurs, éditeurs, libraires, personnalités politiques), la reconnaissance, mais le plus grand bénéfice est la paix intérieure de faire ce à quoi elle était destinée. Elle écrit parce qu’elle y est appelée, parce que c’est ce qu’elle est.
Chapitre 17 : Bribes de Questions-Réponses ❓💡
Dans ce chapitre, Elizabeth George répond aux questions fréquentes des lecteurs et des écrivains.
- Routine quotidienne d’écriture : Elle médite environ 10 minutes, puis lit une grande œuvre littéraire pendant 15 minutes (comme Sense and Sensibility ou Persuasion), avant de commencer à écrire. Son auteur préféré pour la relecture est John Fowles (The Magus), qu’elle admire pour sa prise de risque et sa maîtrise de la langue. Son livre préféré de tous les temps est To Kill a Mockingbird, qu’elle considère comme un roman parfait en termes de POV et de voix narrative.
- Trouver un agent : Elle a interrogé une trentaine d’agents représentant des auteurs de romans policiers avant d’obtenir un « mordillement ».
- Pourquoi écrire des romans britanniques : Elle aime la Grande-Bretagne, ses paysages variés (Lancashire ne ressemble pas au Shropshire), son histoire, ses traditions, sa littérature et sa capacité à critiquer son système de classes et son snobisme.
- Groupes de critique et conférences : Elle a brièvement appartenu à un groupe mais préfère les « lecteurs froids » une fois le livre terminé. Elle met en garde contre les groupes improductifs ou les conférences utilisées comme excuse pour éviter d’écrire.
- Sort de son premier roman adulte : Il a été rejeté, mais elle a beaucoup appris et est passée à l’écriture d’un autre roman plutôt que de le réécrire indéfiniment. Elle insiste sur le fait qu’il faut « créer des personnages attachants et les mettre en conflit », puis « il faut le faire ».
Partie V : Exemples et Guides – Des Outils Concrets 🗺️📚
Chapitre 18 : Donnez-moi une Carte, S’il Vous Plaît – Les Formats d’Intrigue 🗺️📖
Pour les écrivains qui se sentent perdus sans guide, George présente différentes structures narratives.
- La Ligne d’Histoire en Sept Étapes (The Seven-Step Story Line) : Un format qui décompose un roman en sept parties structurelles :
- L’accroche (The Hook) : Capte l’attention du lecteur avec conflit, émotion, excitation, intrigue, suspense, mystère.
- L’incident déclencheur (The Inciting Incident) : L’événement qui met la balle en mouvement.
- L’action montante (The Rising Action) : Le développement des conflits et de la tension.
- Le point culminant (The Climax) : Le point de tension maximale.
- L’action descendante (The Falling Action) : Les conséquences du point culminant.
- La résolution (The Resolution) : Où le lecteur trouve une satisfaction.
- Le dénouement (The Denouement) : Les fils de l’histoire sont noués, les explications données, la conclusion inévitable.
- Le Voyage du Héros (The Hero’s Journey) : Basé sur le travail de Joseph Campbell et Chris Vogler, c’est un autre format d’intrigue qui suit un schéma archétypal (appel à l’aventure, épreuves, récompense, retour).
- La Pyramide de Gustav Freitag : Un diagramme triangulaire illustrant la structure dramatique d’une histoire :
- Exposition : Établissement des relations entre les personnages, leurs désirs, leurs compulsions, et l’émergence des conflits créant une instabilité.
- Complication : L’action monte, la tension et les enjeux augmentent, les personnages sont contraints de prendre des décisions.
- Climax : Le point de non-retour.
- Action descendante : Les conséquences du climax.
- Dénouement : Les personnages ont changé, de nouvelles connaissances ont été acquises.
George insiste sur le fait qu’il n’y a pas de règles rigides, mais seulement des « choix éclairés ». L’important est d’être informé de ces structures pour faire les meilleurs choix. Elle mentionne la possibilité de plusieurs climax ou de faux climax (comme dans Red Dragon de Thomas Harris).
- L’intrigue double (The Double Plot) : Une approche « à l’étage/au rez-de-chaussée » avec une intrigue principale et des personnages centraux, et une sous-intrigue.
Chapitre 19 : Tout est une Question de Caractère (Character Prompt Sheet) 📝🎭
George fournit une feuille d’invite de personnage comme guide pour la phase de création de personnage. Elle ne doit pas être remplie avec des mots uniques, mais utilisée pour stimuler l’écriture libre en flux de conscience, permettant à l’écrivain d’entrer en « mode créatif complet ». Cette feuille contient des catégories pour explorer en profondeur un personnage, comme ses gestes, sa démarche, ses traits de caractère (forts et faibles), ce qui le fait rire, sa philosophie, ses penchants politiques, ses passe-temps, ce que les autres remarquent en premier chez lui, ce qu’il fait seul, une caractérisation en une ligne, si le lecteur l’aimera/le détestera, comment il change, et les événements significatifs de son passé.
Elle donne l’exemple de son analyse du personnage d’Eve Bowen de In the Presence of the Enemy. Eve Bowen est l’antithèse d’une bonne mère, créée pour des raisons politiques, incarnant l’hypocrisie et la prétention. L’analyse inclut des détails sur sa carrière, son ambition, son réseau, et sa relation avec Dennis Luxford. L’auteure souligne des points cruciaux qu’elle met en évidence pour s’en souvenir lors de la rédaction du brouillon.
Elle suggère également d’utiliser la profession ou l’activité secondaire d’un personnage comme indice de sa personnalité (ex: Yasmin Edwards, qui fabrique des perruques pour les victimes de cancer et les femmes abusées).
Chapitre 20 : Transformer les Lieux en Décors 📸📍
Ce chapitre réitère et illustre comment George transforme un « lieu » (une location physique visitée) en un « cadre » (le lieu transformé par les mots dans le roman). Son processus de recherche comprend la lecture préalable, la sélection de sites potentiels, le voyage sur place, la prise de photos et l’enregistrement de commentaires, suivis de transcriptions quotidiennes.
Elle montre comment elle a utilisé des photographies spécifiques pour ses romans :
- Back End Barn, Lancashire, Angleterre (Missing Joseph) : Un lieu découvert au hasard dans les landes, utilisé plus tard comme le lieu du « coup d’éclat » du roman (le « bang within the bang » du climax). Elle a pu ajouter des détails « véridiques » (les projections de la grange) grâce aux photos.
- Pendle Hill, Lancashire, Angleterre (Missing Joseph) : Une colline avec une histoire liée aux sorcières, utilisée comme simple toile de fond dans le roman, juste une « tâche vert-gris ».
- Cotes Hall, Lancashire, Angleterre (Missing Joseph) : Une maison abandonnée découverte sous la pluie, transformée en demeure de l’un de ses personnages. George a changé son nom mais a utilisé les détails réels de son extérieur et de ses jardins, les « liftant du paysage » pour les intégrer au livre.
- Wilton Windmill, Wiltshire, Angleterre (In the Presence of the Enemy) : Un moulin à vent où elle a interviewé le gardien. Ce lieu est devenu le site d’emprisonnement de Charlotte Bowen.
- Canal Kennet et Avon, Wiltshire, Angleterre (In the Presence of the Enemy) : Un site parfait où le corps de Charlotte a été découvert. Elle a essayé trois points de vue pour cette scène avant de se fixer sur celui du jeune détective, soulignant que « aucun effort n’est réellement gaspillé », car une idée non utilisée peut servir plus tard (l’infirmière et le chien coupés de ce manuscrit ont été utilisés dans un roman ultérieur).
- Ancien château de Wardour et château de Farleigh Hungerford (In the Presence of the Enemy) : Amalgamation de deux châteaux pour créer le lieu de détention de Leo Luxford, combinant des éléments fascinants de l’un (la crypte funéraire avec des cercueils en plomb et un système de drainage) avec un autre.
Ces exemples illustrent comment George utilise des lieux réels, les adapte et y ajoute des détails pour les rendre « vrais » et inoubliables dans l’esprit du lecteur.
Réflexions Finales : Le Cœur de l’Écriture 💖✍️
Chapitre 21 : Le Mot de la Fin – Talent, Passion et Discipline ✨💪
Elizabeth George partage sa « formule » pour être publié : talent, passion et discipline. Elle affirme que la discipline seule peut mener à la publication, même sans talent ou passion innée. Cependant, le talent et la passion seuls, sans la discipline, ne suffiront pas. Elle se considère comme disciplinée et attribue son succès à cela.
Elle distingue clairement l’auteur du écrivain. Les « auteurs » sont ceux qui cherchent la richesse rapide et la gloire (couverture de livre, autographes, interviews), écrivent le même roman à répétition et abandonneront s’ils ne sont pas publiés. Les « écrivains », en revanche, écrivent parce qu’ils le doivent, c’est « comme respirer » ; le mystère et la magie de mettre des mots sur le papier sont ce qui compte vraiment pour eux.
Le plus grand bénéfice pour elle n’est pas la célébrité ni les rencontres avec des personnalités, mais la « paix relative de savoir que je fais ce à quoi j’étais destinée ». Elle écrit parce qu’elle a été « appelée à écrire », c’est son essence.
Chapitre 22 : Le Processus en Bref – Un Récapitulatif 🔄✅
Pour ceux qui préfèrent un guide concis, George récapitule les 14 étapes de son processus d’écriture, renvoyant à chaque chapitre pertinent pour des détails supplémentaires :
- L’Idée (et l’Idée Élargie, l’Événement Primaire)
- Peupler le Monde de l’Idée Élargie et de l’Événement Primaire (listes génériques et spécifiques des personnages)
- La Recherche
- Créer les Personnages
- Créer le(s) Cadre(s)
- Le Plan d’Étape (jusqu’à épuisement des possibilités)
- Le Plan d’Intrigue (plan courant)
- Écrire le Premier Brouillon
- La Lecture Rapide
- La Lettre Éditoriale (pour soi-même)
- La Deuxième Ébauche
- Le Lecteur Froid
- La Troisième Ébauche (si nécessaire)
- Célébrer ! Le roman est écrit.
Elle conclut avec un message d’encouragement : « Tout le monde ne peut pas écrire un roman. En fait, très peu de gens peuvent le faire. Mais vous pourriez être l’un d’eux. Il n’y a qu’une seule façon de le découvrir. L’écriture. »
En somme, » confiance à votre « colle à fesses », et qui sait, votre propre roman pourrait bien devenir la prochaine histoire inoubliable ! 🚀📖