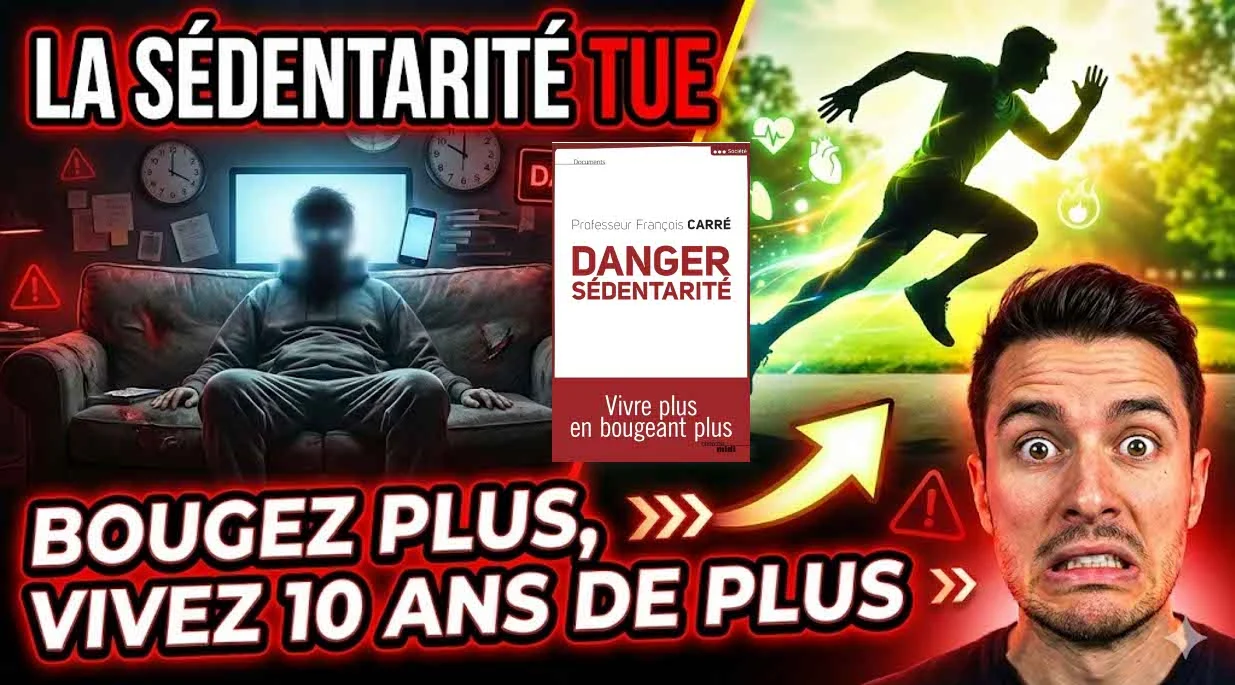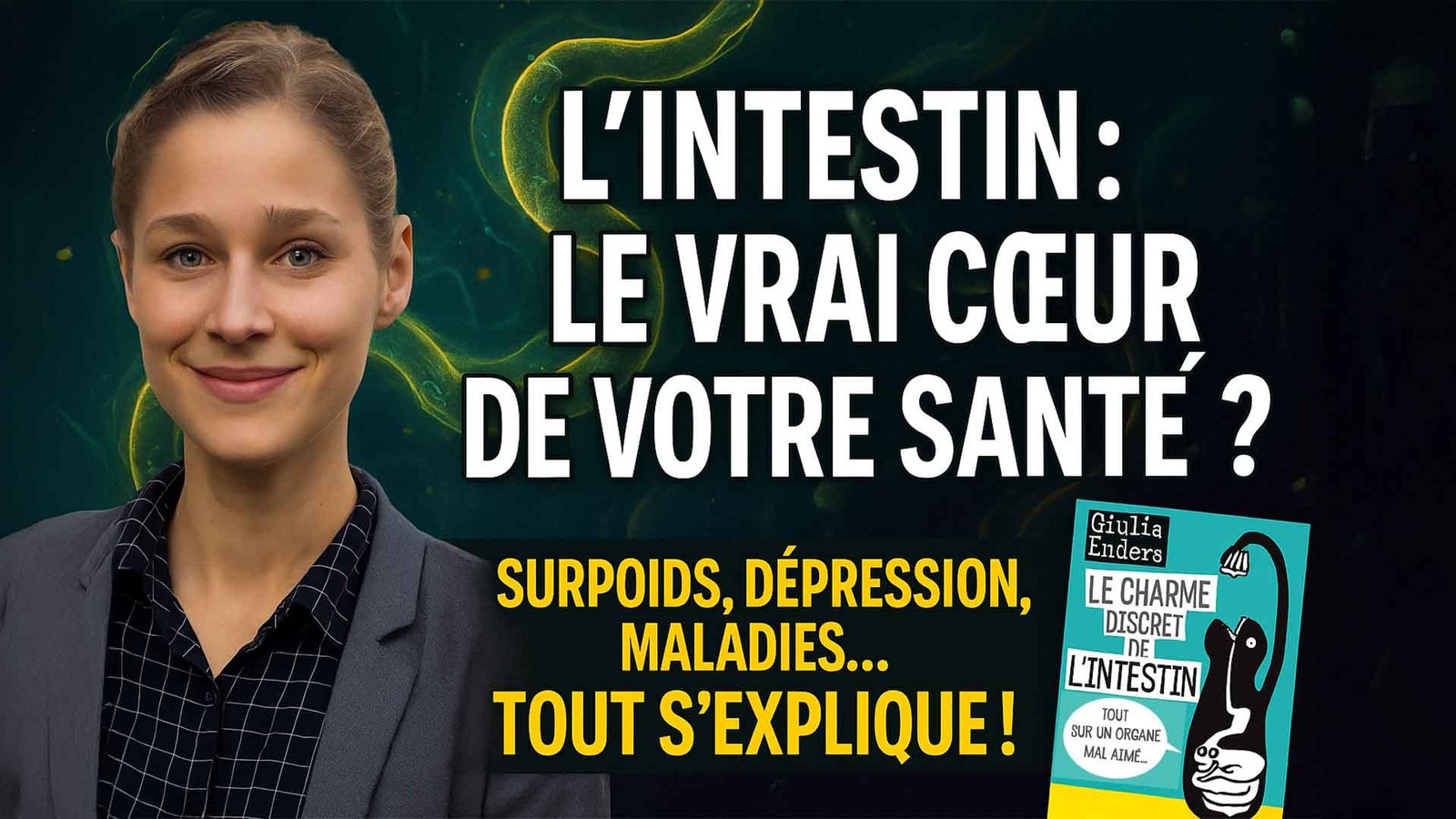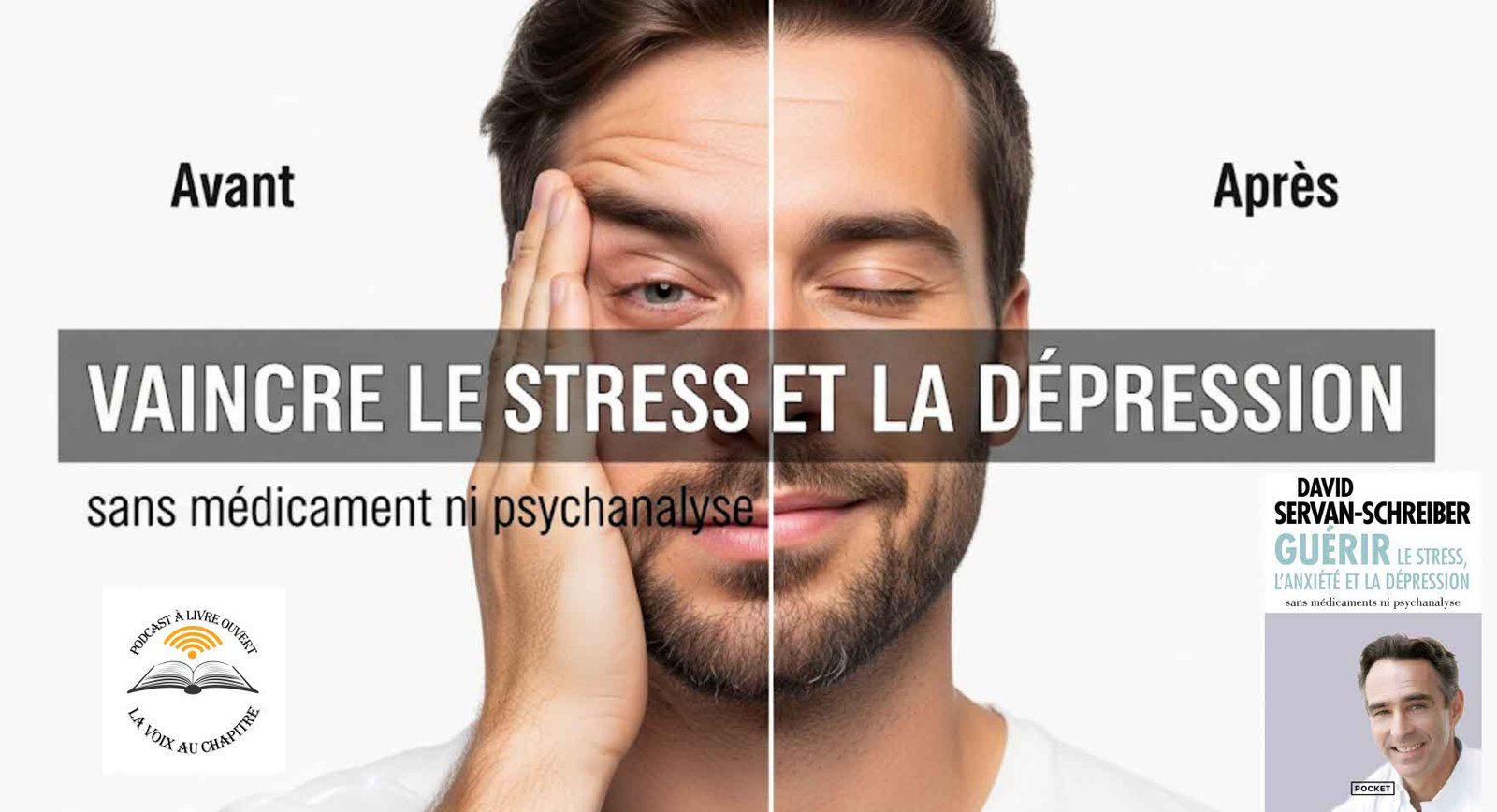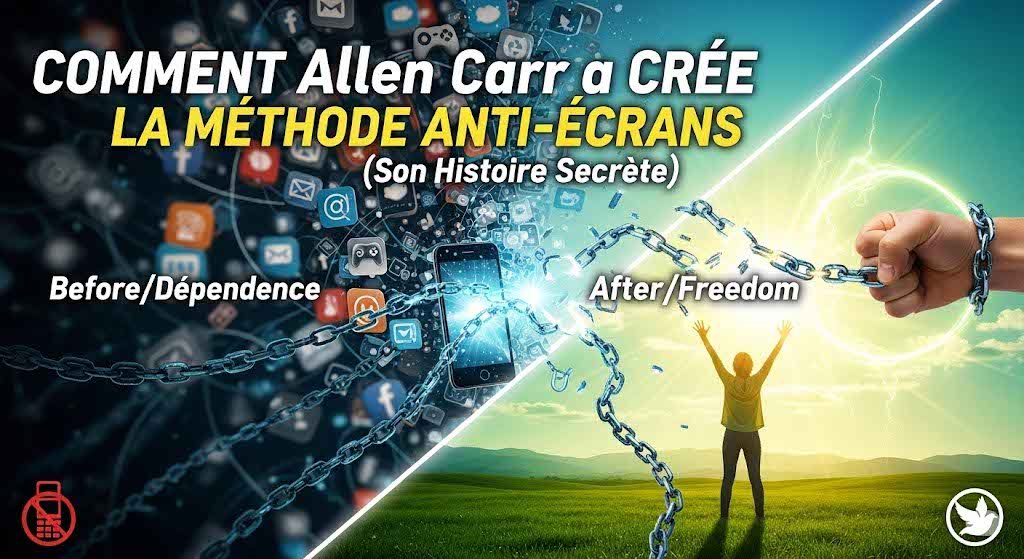Les liens pour vous procurer les différentes versions
📗Lien vers le livre papier : https://amzn.to/4lm9vHj
📕Lien vers l’ebook : https://amzn.to/4kGeZM3
Ozempic et la Quête du Poids Idéal : Une Révolution ou une Illusion ? 💊 🤔
Dans un monde où les taux d’obésité atteignent des sommets alarmants, l’arrivée de nouveaux médicaments amaigrissants comme Ozempic et Wegovy a été accueillie comme un véritable « Saint Graal ». Mais cette « pilule magique » est-elle la solution tant attendue, ou un simple palliatif à un problème bien plus profond ? Johann Hari, l’auteur de l’ouvrage « Magic Pill », explore cette question complexe à travers son propre parcours et une enquête mondiale, révélant des vérités surprenantes sur notre relation à la nourriture, à notre corps et à notre société.
1. Le « Saint Graal » de la perte de poids ? Une introduction à la Révolution Ozempic ✨
L’hiver 2022 a marqué un tournant pour Johann Hari, alors qu’il se sentait « schlubby » après avoir pris 20 livres pendant la pandémie, grâce notamment à Uber Eats. C’est lors d’une fête à Hollywood qu’il découvre un nouveau phénomène : la spectaculaire perte de poids de certaines célébrités, attribuée à un mystérieux « tube en plastique bleu avec une minuscule aiguille ». Il s’agissait d’Ozempic, un nom qui allait bientôt résonner dans le monde entier.
Les experts sont unanimes : cette nouvelle génération de médicaments, agissant de manière inédite, permet aux utilisateurs de perdre entre 5 et 24 % de leur poids corporel. Pour Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres, c’est « le Saint Graal que les gens recherchaient » pour l’obésité sévère. Dr. Clemence Blouet, chercheuse sur l’obésité à l’Université de Cambridge, le qualifie de « premier médicament anti-obésité sûr ». L’impact sociétal de ces médicaments est comparé à l’invention du smartphone, avec un marché mondial potentiel de 200 milliards de dollars d’ici 2030.
Pour l’auteur, cette découverte est d’autant plus fascinante qu’elle s’inscrit dans une histoire millénaire de recherche d’une formule pour rester mince, une quête évoquée dès la Grèce antique. Mais au-delà de l’excitation scientifique et financière, Johann Hari ressentait un profond conflit. Pourquoi ? Parce que si l’obésité et une mauvaise alimentation sont des causes majeures de décès (estimées entre 112 000 et 678 000 vies par an aux États-Unis), et que les solutions traditionnelles comme les régimes et l’exercice ont largement échoué (seuls 20 % des personnes réussissent à maintenir leur perte de poids après un an), ces nouveaux médicaments posent des questions éthiques et sociétales fondamentales. L’auteur s’interroge : s’agit-il d’une solution biologique à un problème social ?
2. Comment ces médicaments révolutionnaires fonctionnent-ils ? 🧪
Le secret de ces médicaments réside dans la manipulation d’une hormone minuscule mais puissante : le GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1). Sa découverte remonte à 1984, lorsque le scientifique canadien Daniel Drucker l’identifie comme un fragment du code génétique du glucagon. Son « moment Eurêka » survient lorsqu’il réalise que le GLP-1 stimule la production d’insuline, ouvrant des perspectives pour le traitement du diabète.
Plus tard, le Dr. John Wilding, un scientifique britannique, découvre que le GLP-1, naturellement libéré dans l’intestin après les repas, pourrait être un signal de satiété, indiquant au corps qu’il est « plein ». En injectant du GLP-1 à des rats, il observe une réduction spectaculaire de leur appétit. Le défi était que le GLP-1 naturel disparaît très rapidement du système (quelques minutes).
La percée majeure vient d’une source inattendue : le monstre de Gila, un lézard venimeux du désert. Un biochimiste, John Eng, découvre que son venin contient une copie du GLP-1 qui dure des heures. Les scientifiques ont alors développé des « agonistes » du GLP-1, des copies synthétiques qui peuvent rester dans le système pendant une semaine entière. Initialement approuvés en 2005 pour les diabétiques, ces médicaments ont non seulement contrôlé leur glycémie, mais ont aussi entraîné une perte de poids significative, même sans changement de mode de vie.
Les essais cliniques, notamment le grand essai de Novo Nordisk sur le sémaglutide (Ozempic/Wegovy), ont montré une perte de poids moyenne de 15 % sur 68 semaines chez les personnes obèses. C’est le médicament amaigrissant le plus efficace de l’histoire.
Cependant, un point crucial est soulevé : pour que le médicament fonctionne, il doit être pris à vie. L’obésité est désormais considérée comme une maladie chronique nécessitant une gestion à long terme, à l’instar du diabète ou de l’hypertension. Les avancées continuent, avec des médicaments comme Mounjaro, qui simulent le GLP-1 et le GIP (une autre hormone intestinale), entraînant une perte de poids moyenne de 21 %, et le « Triple G » promettant jusqu’à 24,2 %. Bientôt, des versions orales (comme Rybelsus) pourraient remplacer les injections.
L’impact économique est déjà visible : les actions des entreprises de restauration rapide et de confiserie baissent, tandis que celles des fabricants de genouillères ou même des compagnies aériennes (moins de carburant pour des passagers plus minces) sont affectées.
Johann Hari lui-même a perdu 21 livres en six mois, passant de la catégorie « obèse » à « poids sain ». Mais cette transformation physique s’est accompagnée d’une sensation d’ambivalence et de malaise, malgré les compliments reçus.
3. Pourquoi avons-nous pris du poids ? L’Ère de la « Frankenfood » 🍔🍟
Pour comprendre le besoin de ces médicaments, il faut se pencher sur la question fondamentale : pourquoi sommes-nous devenus si gros ? L’auteur, né en 1979, souligne que depuis la fin des années 1970, l’obésité a « grimpé en flèche », triplant presque à l’échelle mondiale depuis 1975. Ce n’est pas un changement génétique, mais une transformation radicale de notre société et de notre système alimentaire.
Le livre décrit comment les aliments ultra-transformés (« Frankenfood » ou « substances alimentaires ») sont devenus omniprésents. Joanna Blythman, une journaliste, décrit les usines de production alimentaire non pas comme des cuisines, mais comme des usines chimiques, où des ingrédients « naturels » sont décomposés et reconstitués avec des dizaines, voire des centaines, d’additifs, de colorants et d’arômes artificiels. L’objectif principal : prolonger la durée de conservation et maximiser l’addiction en utilisant des quantités « inouïes de sucre, de sel et de matières grasses ».
Ce nouveau type d’aliments affecte notre corps de manière unique :
- Moins de mastication : Les aliments ultra-transformés sont « très mous », comme de la « nourriture pour bébé adulte ». Mâcher moins interfère avec le signal de satiété, nous incitant à manger plus sans le vouloir.
- Combinaison puissante sucre-graisse-glucides : Cette combinaison, rare dans la nature (hormis le lait maternel), active des réponses primitives, nous poussant à « se gaver ».
- Montagnes russes glycémiques : Contrairement aux aliments entiers qui libèrent l’énergie lentement, les aliments transformés provoquent des pics et des chutes rapides de la glycémie, déclenchant une faim répétée.
- Manque de protéines et de fibres : Notre corps a besoin de protéines, et si les aliments transformés en contiennent peu, nous mangeons davantage pour atteindre notre quota protéique. Le manque de fibres accélère également la sensation de faim.
- Édulcorants artificiels : Des études suggèrent que les boissons « zéro calorie » peuvent en fait entraîner une prise de poids, car le cerveau s’attend à un afflux d’énergie qui ne vient pas, augmentant ainsi la faim.
- Sagesse nutritionnelle brouillée : Les arômes artificiels ont déconnecté le goût de la valeur nutritionnelle, poussant nos instincts à nous diriger vers des aliments malsains.
- Dérèglement du microbiote intestinal : Les aliments ultra-transformés, composés de peu d’ingrédients diversifiés (maïs, blé, soja, viande), appauvrissent la diversité de notre microbiote, essentiel pour le métabolisme et la satiété.
Ces facteurs se combinent pour créer une « tempête parfaite d’obésité », où l’alimentation transformée nous fait consommer en moyenne 500 calories de plus par jour. L’auteur réalise qu’il a « mangé d’une manière qui augmentait sa faim » toute sa vie.
Le lien entre les aliments transformés et les nouveaux médicaments amaigrissants devient alors évident : nous consommons depuis quarante ans des aliments qui minent systématiquement notre satiété, et en réponse, nous demandons des médicaments qui nous redonnent ce sentiment de satiété perdu.
4. Les risques cachés et les doutes de l’auteur ⚠️
L’histoire des médicaments amaigrissants est jalonnée de promesses non tenues et de dangers cachés. L’auteur se demande si Ozempic n’est pas une « fen-phen Mark 2 », en référence à un médicament des années 1990 qui a provoqué des milliers de problèmes cardiaques et de décès avant d’être retiré du marché.
Bien que les nouveaux médicaments soient soumis à des tests plus rigoureux, la question des effets à long terme reste en suspens. Les diabétiques les prennent depuis plus de 15 ans, sans signal de sécurité majeur, mais Max Pemberton, un médecin, souligne que ces patients sont déjà malades, ce qui pourrait masquer certains effets indésirables.
Douze risques potentiels sont identifiés :
- Effets esthétiques : « Ozempic face » et « Ozempic butt », un affaissement du visage et des fesses dû à la perte de poids rapide.
- Cancer de la thyroïde : Une « safety signal » a été émise par l’Agence européenne des médicaments (EMA). Des études françaises ont montré un risque accru de 50 à 75 % de développer ce cancer chez les utilisateurs, bien que son incidence générale reste faible.
- Problèmes pancréatiques : Un risque accru de pancréatite (inflammation du pancréas) est associé à ces médicaments (multiplié par 9 selon une étude canadienne), potentiellement mortel dans les cas extrêmes.
- Paralysie gastrique (gastroparesia) : Le système digestif ralentit, pouvant entraîner des vomissements sévères et une rétention alimentaire. Le risque est multiplié par 3,67.
- Perte de masse musculaire : La perte de poids s’accompagne d’une réduction de la masse musculaire (20 à 30 % pour certains), ce qui peut fragiliser le corps, surtout chez les personnes âgées.
- Malnutrition : Une réduction extrême de l’appétit peut entraîner une consommation insuffisante de nutriments essentiels.
- Problèmes d’accès et contrefaçons : La demande massive a créé une pénurie, privant les diabétiques et les personnes sévèrement obèses. Certains se tournent vers des versions « knockoff » ou « composées » (mélanges faits maison ou par des spas) sans garantie de sécurité ou de dosage.
- « Inconnues inconnues » : Des effets lents et progressifs peuvent n’apparaître qu’après des décennies d’utilisation, comme cela a été le cas pour certains antipsychotiques et la démence.
- Impact sur le système de récompense cérébral (anhedonia) : Si les médicaments agissent en réduisant le plaisir lié à la nourriture, cela pourrait-il s’étendre à d’autres plaisirs de la vie, entraînant un émoussement des émotions ou une « anhedonia » ?.
- Pensées suicidaires et auto-mutilation : L’EMA a soulevé un signal de sécurité à ce sujet, suite à des rapports d’usagers, ce qui est en cours d’investigation.
L’auteur confie que depuis qu’il prend Ozempic, son humeur est « étrangement atténuée », « un peu apathique », ce qui pourrait être lié à l’effet du médicament sur le cerveau.
5. Au-delà du mythe : Régime, Exercice et Psychologie 🧠
Le narrateur se demande pourquoi il ne pourrait pas simplement « perdre du poids à la manière normale » par le régime et l’exercice. Cependant, l’expérience et la science suggèrent que cette approche est « principalement un échec ».
- L’échec des régimes : Traci Mann, professeure de psychologie à l’Université du Minnesota, après avoir examiné plus de 2000 études, conclut que deux ans après le début d’un régime, la personne moyenne ne pèse que deux livres de moins qu’au départ. Les régimes fonctionnent à court terme, mais la plupart des gens reprennent le poids perdu.
- Le « point de consigne » biologique : Notre cerveau a un « point de consigne » (set point) pour le poids. Quand on prend du poids, ce point de consigne s’élève, et le corps « se bat » pour le maintenir. Il active des mécanismes pour nous ramener à ce poids « défendable » plus élevé, comme une baisse du métabolisme ou une augmentation de la faim.
- L’environnement « obésogène » : Nous vivons dans une société où la nourriture « merdique » est bon marché et omniprésente, tandis que les aliments sains sont chers et difficiles d’accès. C’est un environnement qui rend l’obésité facile et la perte de poids difficile.
- L’exercice et la perte de poids : L’exercice est crucial pour la santé (réduction du risque de maladies, amélioration de la santé mentale, augmentation de l’espérance de vie). Mais en matière de perte de poids, il est « rarement efficace » seul. « On ne peut pas compenser une mauvaise alimentation en courant », déclare Tim Spector.
L’auteur réalise que sa « fixation sur la volonté » était trop simpliste. La volonté est un facteur fragile dans un tableau « grand et compliqué ».
En plus des facteurs biologiques et environnementaux, l’ouvrage explore les cinq raisons psychologiques pour lesquelles nous mangeons :
- Pour subsister : La raison la plus évidente, mais pour l’auteur sous Ozempic, elle ne représente qu’une fraction de ses habitudes alimentaires.
- Pour le plaisir : Beaucoup d’utilisateurs d’Ozempic rapportent une perte de plaisir à manger, rendant la nourriture « sans joie et utilitaire ». Cela soulève la question des conséquences imprévues, comme la dépression, si une source majeure de plaisir est retirée.
- Pour se calmer et se réconforter : L’alimentation est un mécanisme d’adaptation omniprésent pour gérer le stress, la tristesse ou la colère. L’auteur lui-même a utilisé la nourriture comme « amortisseur de chocs » face aux événements traumatisants de sa vie. Ozempic supprime cette voie, le laissant « nu face à la douleur ».
- Pour rejouer des schémas psychologiques appris dans l’enfance : Hilde Bruch, une psychanalyste, a montré que les enfants apprennent à manger non seulement quand ils ont faim, mais aussi pour gérer d’autres émotions (anxiété, ennui). L’auteur réalise qu’il a appris à associer la « malbouffe » à l’amour et la nourriture saine à la honte, ce qui le rendait résistant au changement.
- Pour se protéger psychologiquement : L’excès de poids peut servir de « protection sexuelle » ou abaisser les attentes des autres, réduisant la pression sociale. La perte de poids peut alors entraîner une vulnérabilité psychologique.
Le livre établit un parallèle frappant avec la chirurgie bariatrique. Bien qu’elle entraîne d’énormes bénéfices physiques (réduction du diabète, de l’hypertension, du cancer), une minorité significative de patients subissent des effets psychologiques graves :
- Transferts d’addiction : Environ une personne sur dix développe une addiction à l’alcool, au jeu ou au shopping. Le vide laissé par la nourriture comme mécanisme de gestion du stress est comblé par d’autres comportements compulsifs.
- Dépression et suicide : Une minorité (17 %) souffre de dépression et d’anxiété sévères nécessitant un traitement psychiatrique. Le risque de suicide est multiplié par quatre.
Ces constats amènent à se demander si les nouveaux médicaments amaigrissants, en agissant sur le cerveau et en privant les individus de leurs mécanismes d’adaptation alimentaires, n’auront pas des conséquences psychologiques similaires. « Les problèmes étaient là depuis le début », a dit une amie de l’auteur, « Ozempic ne fait que les mettre en lumière ».
6. Stigmatisation, Image Corporelle et leçons du Japon 🇯🇵
L’impact de ces médicaments sur l’image corporelle et la stigmatisation est une préoccupation majeure. L’auteur raconte l’histoire de Shelley Bovey, l’une des premières voix britanniques à dénoncer la cruauté envers les personnes grosses. La stigmatisation, souvent basée sur des préjugés (paresse, gourmandise), est non seulement douloureuse, mais aussi contre-productive, poussant les personnes stigmatisées à manger davantage et à faire moins d’exercice.
Le mouvement « Fat Pride » ou « Fat Acceptance » s’est élevé pour affirmer que l’obésité n’est pas toujours nocive pour la santé, que les formes corporelles varient naturellement et que le BMI est un indicateur imparfait. Cependant, l’auteur, s’appuyant sur les travaux d’experts comme Walter Willett de Harvard, réfute l’idée de « sain à toute taille » comme une généralité fiable. Bien qu’il existe des exceptions, l’obésité « augmente le risque d’un large éventail de maladies ». Les études montrent que la réduction de l’obésité (par chirurgie bariatrique ou Ozempic) réduit drastiquement les risques de maladies, ce qui va à l’encontre de l’idée que l’obésité n’est qu’une corrélation.
La discussion avec sa nièce, qui, étant d’un poids sain, souhaite prendre Ozempic pour avoir une « mâchoire plus définie », choque l’auteur. Il craint que ces médicaments ne deviennent un « carburant pour fusée » pour les troubles alimentaires restrictifs, d’autant plus que les taux de troubles alimentaires ont triplé pendant la pandémie. Les médecins en ligne, moins rigoureux, facilitent l’accès aux personnes ne répondant pas aux critères médicaux. L’auteur s’interroge sur ses propres motivations, confronté par une amie sur sa « vanité » cachée derrière l’argument de la santé.
Face à ce dilemme, l’auteur cherche des alternatives et se tourne vers le Japon, le seul pays développé à être devenu riche sans devenir obèse, et où l’obésité est même en baisse. Le Japon est un modèle fascinant :
- Culture culinaire ancestrale (mais aussi récente !) 🍜 : La cuisine japonaise est axée sur la simplicité, la fraîcheur, les petites portions variées (cinq goûts, cinq compétences, cinq couleurs par repas). C’est une « cuisine soustractive » qui met en valeur les saveurs naturelles, à l’opposé de la cuisine occidentale « ajoutitive ». Les desserts sont rares.
- Aliments fermentés et microbiote sain : La consommation régulière d’aliments fermentés comme le natto favorise une bonne flore intestinale, contribuant à la satiété.
- Système alimentaire sain : Les supermarchés japonais sont dominés par les produits frais, les aliments transformés étant relégués à un coin « pâle et négligé ».
- Éducation alimentaire dès l’enfance 🧑🏫 : Au Japon, chaque école emploie une nutritionniste. Les repas scolaires sont préparés à partir de zéro, nutritifs et variés, sans aliments transformés. Les enfants apprennent la nutrition et même les principes de « triangle eating » (alterner les bouchées entre les différents plats). Résultat : presque aucun enfant n’est en surpoids.
- La Loi Metabo et la pression sociale 📈 : Introduite en 2008, la « Loi Metabo » oblige les entreprises à mesurer le poids et le tour de taille de leurs employés. Si ces mesures augmentent, l’entreprise et l’employé doivent élaborer un plan de santé. Bien que certains trouvent cela intrusif, cette approche collective encourage la responsabilisation et a contribué à la baisse de l’obésité.
Le Japon démontre que l’obésité n’est pas une fatalité pour les pays riches. Ce n’est pas seulement une question de génétique, car les Japonais d’Hawaï, génétiquement similaires, ont des taux d’obésité bien plus élevés. La culture alimentaire japonaise, bien que perçue comme millénaire, a été en grande partie inventée et promue consciemment après la Seconde Guerre mondiale pour améliorer la santé de la population.
7. Quel avenir pour nous et nos enfants ? 🚀
Johann Hari conclut que le choix n’est pas binaire entre l’obésité et les médicaments. Il existe une troisième voie : devenir plus comme le Japon.
Ses convictions finales sont les suivantes :
- Changer radicalement notre système alimentaire 🍎 : La prochaine génération ne devrait pas avoir à se « droguer pour échapper » à la malbouffe. Il n’y a « aucun risque à devenir plus comme les Japonais ». Il exhorte à soutenir les organisations qui luttent pour une meilleure alimentation scolaire et une réforme de l’industrie alimentaire.
- Peser soigneusement les risques personnels ⚖️ : Pour l’auteur, les bénéfices des médicaments (réduction des risques de diabète, maladies cardiaques, cancer, amélioration de l’agilité) l’emportent sur les risques connus (nausées, vertiges, anxiété, risque faible de cancer de la thyroïde, suivi de la masse musculaire). Il conseille de ne pas prendre ces médicaments si le BMI est inférieur à 27, de les prendre si le BMI est supérieur à 35 (sauf antécédents familiaux de cancer de la thyroïde ou grossesse), et d’évaluer la situation pour un BMI entre 27 et 35.
- Protéger les personnes vulnérables 🛡️ : Il est impératif de limiter la prescription de ces médicaments en ligne et d’exiger une consultation en personne avec un médecin formé pour détecter les troubles alimentaires, afin d’éviter qu’ils ne soient utilisés pour l’auto-privation.
L’auteur imagine cinq scénarios possibles pour l’avenir de ces médicaments :
- Fen-phen Mark 2 : Un effet désastreux inconnu se révèle, entraînant un retrait du marché.
- Antidépresseurs chimiques : L’effet s’estompe avec le temps, et les utilisateurs reprennent du poids.
- Médicaments d’élite : En raison de leur coût exorbitant (plus de 1200 $ par mois aux États-Unis), ils restent réservés à une petite élite, tandis que la majorité continue de souffrir d’obésité.
- Statines pour tous : La concurrence ou la régulation fait baisser les prix (potentiellement 40 $ par mois après l’expiration des brevets en 2032), les rendant largement accessibles et révolutionnant la santé publique.
- Le scénario le plus optimiste (et celui pour lequel il se battra) 💪 : Ces médicaments servent de « moment de choc et de compréhension de soi », poussant la société à remettre en question le système alimentaire qui a causé la crise de l’obésité, et à créer un mouvement pour le changer en profondeur, afin que la prochaine génération n’ait pas à se doper.
La mort de son amie Hannah à 46 ans, après une vie d’obésité et de complications de santé, est une motivation constante pour l’auteur. Il refuse d’oublier ce qui l’a tuée.
En fin de compte, l’ouvrage de Johann Hari n’offre pas de réponses simples. Il invite à une réflexion complexe et nuancée sur un problème de santé publique majeur, entre les solutions médicales immédiates et la nécessité d’une transformation sociétale profonde. Le défi est de « réconcilier l’acceptation de la taille et la perte de poids », car « les choses ne sont jamais tout ou rien. Elles sont les deux ».