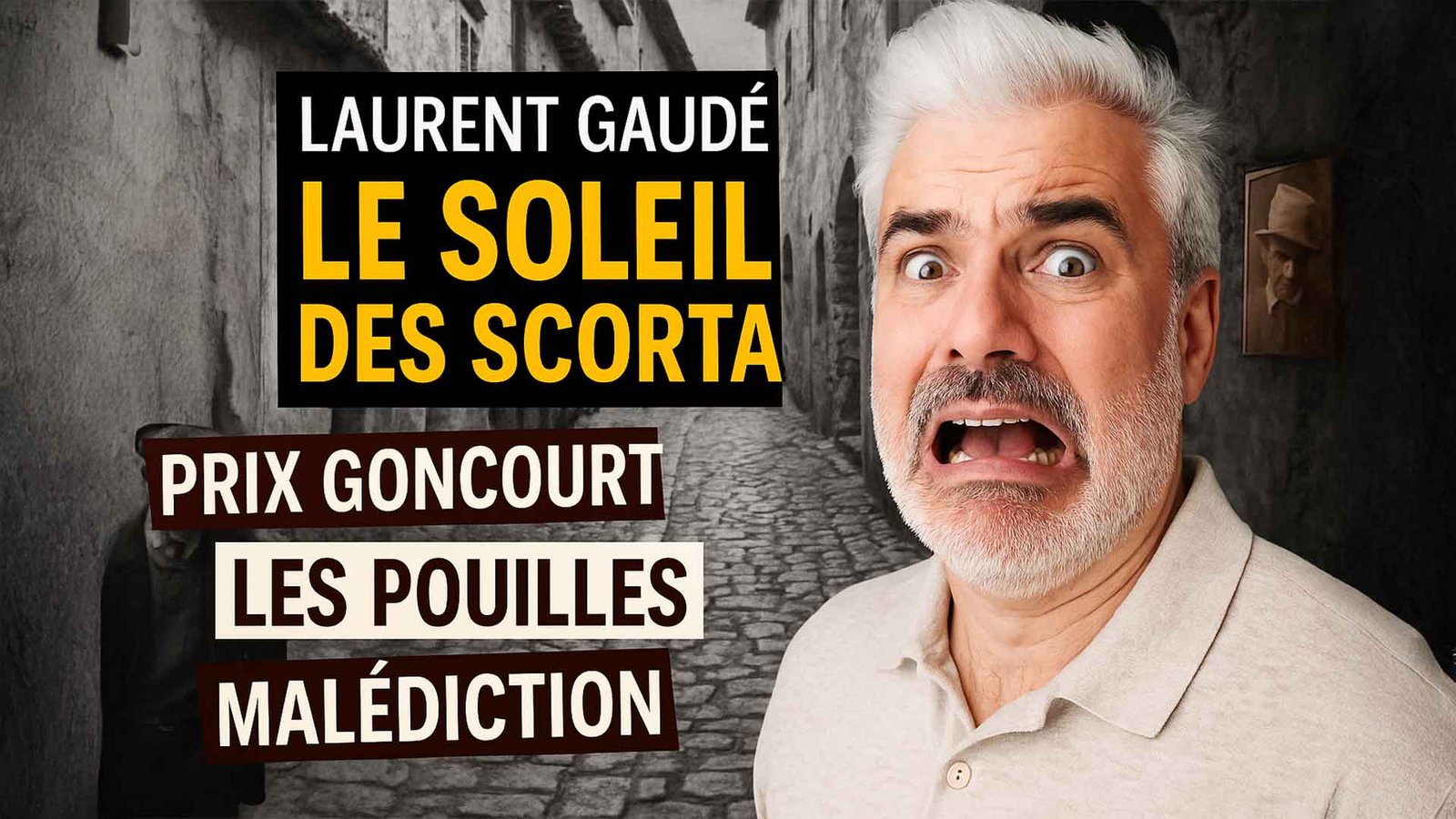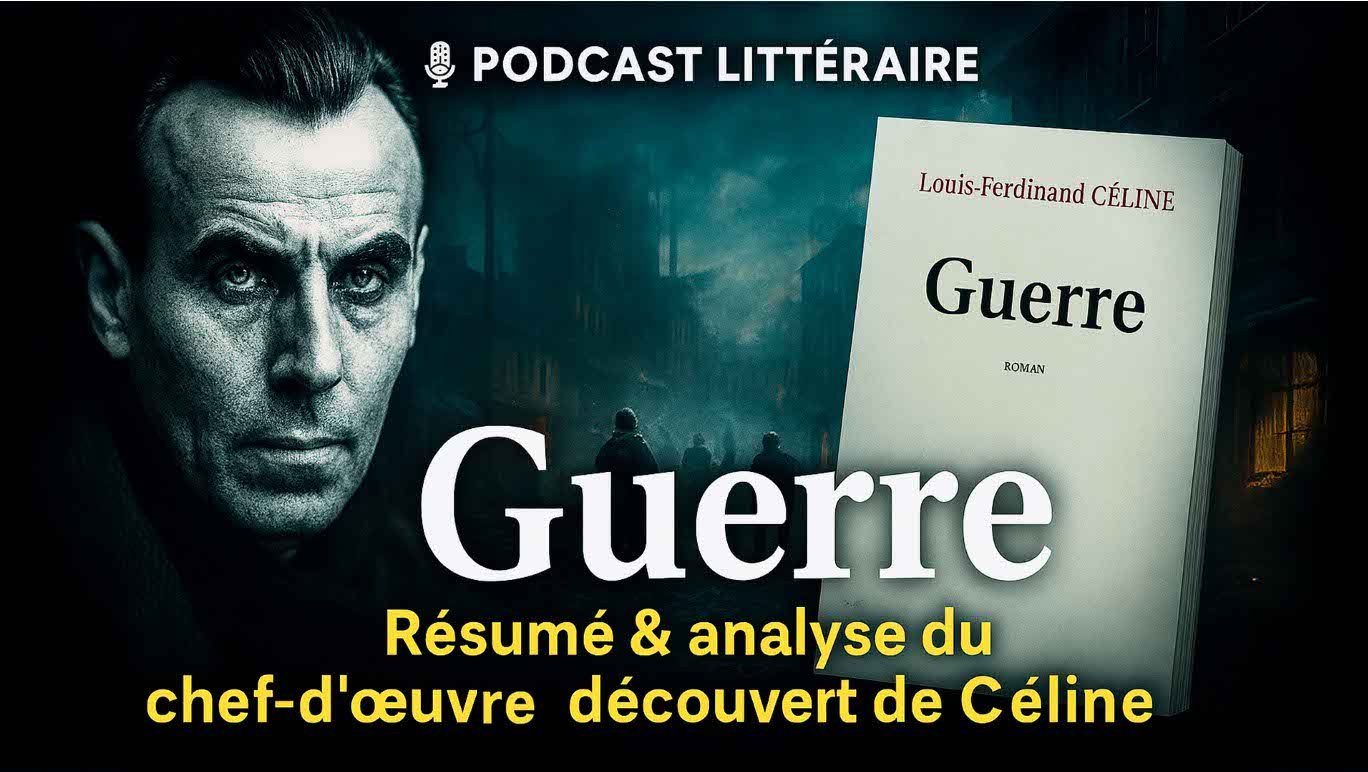Les liens pour vous procurer les différentes versions
📗Lien vers le livre papier : https://amzn.to/4dMuHDm
📘🎧Lien vers le livre audio : https://amzn.to/4dITh7Z
📕Lien vers l’ebook : https://amzn.to/43oDTu3
La Peste d’Albert Camus : Un Roman Intemporel sur le Fléau, l’Exil et la Solidarité 🦠
Publié en 1947, La Peste d’Albert Camus est bien plus qu’une simple chronique d’événements sanitaires. À travers le récit d’une épidémie qui frappe la ville d’Oran dans les années 1940, ce roman explore en profondeur la condition humaine face à l’absurdité, la souffrance et la mort. Préparez-vous à plonger dans une analyse détaillée de ce chef-d’œuvre de la littérature française, basé exclusivement sur les extraits que vous nous avez soumis.
Oran : Une Ville Ordinaire Rattrapée par l’Extraordinaire 🏙️
Pour faire connaissance avec une ville, on peut observer comment on y travaille, aime et meurt. Oran, d’après le narrateur (qui se révélera plus tard être le Docteur Rieux), est dépeinte comme une ville ordinaire et laide, une préfecture française sur la côte algérienne. C’est un lieu où l’on s’ennuie et où l’on cultive les habitudes. Les habitants travaillent principalement pour s’enrichir, s’intéressant surtout au commerce. Les plaisirs simples comme aimer, le cinéma ou les bains de mer sont relégués au week-end.
Oran est présentée comme une ville « sans soupçons », « tout à fait moderne ». L’amour s’y vit « sans le savoir », soit par une rapide « dévoraison » dans l’acte, soit par une longue habitude à deux. Ce qui est peut-être plus original dans cette ville, c’est la difficulté, ou plutôt l’inconfort, qu’on y trouve à mourir. Le climat, l’importance des affaires, l’insignifiance du décor et la rapidité du crépuscule semblent exiger la bonne santé, laissant le malade bien seul face à la mort, pris au piège au milieu d’une population absorbée par ses affaires.
Malgré son aspect banal et son manque de pittoresque, de végétation et d’âme, Oran finit par sembler reposante une fois qu’on y a pris ses habitudes. Elle s’est développée en tournant le dos à une baie magnifique, obligeant ses habitants à chercher la mer. Cette description initiale souligne la banalité de la vie avant que les événements qui font l’objet de la chronique ne viennent bouleverser cet ordre.
Les Signes Précurseurs : L’Invasion des Rats 🐀
Les événements étranges qui marquent le début de la chronique se produisent au printemps. Le narrateur, qui se présente comme un chroniqueur disposant de son témoignage, de celui des autres et de textes, s’autorise à faire œuvre d’historien pour relater ces faits.
Tout commence le 16 avril, lorsque le Docteur Bernard Rieux bute sur un rat mort sur le palier de son immeuble. Ce qui n’est qu’un incident bizarre pour lui devient un « scandale » pour le vieux concierge, M. Michel, qui refuse l’idée de rats dans sa maison. Pourtant, dès ce jour, Rieux observe d’autres rats morts dans les quartiers extérieurs où vivent les plus pauvres de ses clients. Le phénomène s’étend rapidement. Le 18 avril, Rieux découvre une dizaine de rats morts dans les escaliers de son immeuble, et les poubelles voisines en sont pleines.
Le docteur contacte le service communal de dératisation. Le directeur, Mercier, est au courant mais sceptique quant à la gravité de la situation. Rieux insiste sur la nécessité d’intervenir, mentionnant que des centaines de rats morts ont été collectés dans une grande usine.
Dès le 18, la presse s’empare de l’affaire, s’interrogeant sur les mesures d’urgence de la municipalité. Cette dernière, après délibération, ordonne la collecte et l’incinération des rats morts. Mais la situation s’aggrave dans les jours qui suivent. Le nombre de rongeurs ramassés augmente chaque matin. Dès le quatrième jour, ils sortent en groupes pour mourir près des humains, dans les rues, les cours, les halls administratifs, et même sur les places publiques. La ville est souillée par ces cadavres. L’agence Ransdoc annonce des chiffres précis et croissants (plus de 6000 le 25 avril, près de 8000 le 28), semant le désarroi et l’anxiété. Seul un vieil Espagnol asthmatique, patient de Rieux, semble s’en réjouir.
Brusquement, le 29 avril, le phénomène cesse, apportant un soupir de soulagement.
L’Arrivée du Fléau Humain : La Fièvre Inquiétante 🔥
Mais ce même jour, la peste prend un visage humain. Le concierge, M. Michel, est trouvé mal en point, avec des grosseurs douloureuses au cou, aux aisselles et aux aines. Rieux le fait coucher et promet de repasser. Pendant ce temps, un employé de mairie, Joseph Grand, appelle Rieux pour un voisin ayant tenté de se pendre. Ce voisin est Cottard. Rieux constate l’échec de la tentative et gère la situation, notant l’anxiété de Cottard face à la police.
En revenant, Rieux trouve le concierge bien plus mal. Fièvre élevée, ganglions gonflés, taches noirâtres. Le vieil homme délire, se plaignant des rats. Malgré un traitement, son état empire. À midi le 30 avril, la fièvre est à quarante degrés, les vomissements reprennent. Rieux décide de l’isoler à l’hôpital. Le concierge meurt peu après.
Cette mort marque la fin de la période des signes déconcertants et le début d’une autre, plus difficile, où la surprise se transforme en panique. D’autres cas similaires apparaissent rapidement, pas seulement chez les pauvres. La peur et la réflexion commencent. Le Dr. Rieux constate une vingtaine de cas mortels en quelques jours, présentant des symptômes inquiétants. Richard, président de l’ordre des médecins, se montre hésitant et réticent à parler de contagion ou à prendre des mesures préfectorales sans certitude absolue.
Malgré les incertitudes, le mot « peste » est prononcé pour la première fois par le Dr. Castel, un confrère plus âgé, qui a déjà vu des cas similaires en Chine et à Paris. Pour Rieux, comme pour la plupart des habitants, le fléau reste irréel au début ; les gens « ne croyaient pas aux fléaux ». L’histoire a montré autant de pestes que de guerres, mais les gens sont toujours aussi dépourvus. L’humanisme, centré sur soi, rend difficile la prise de précautions face à un mal qui dépasse la mesure de l’homme. La peste « supprime l’avenir, les déplacements et les discussions ».
Rieux, en tant que médecin, a une idée de la douleur et plus d’imagination. Il se remémore les grandes pestes historiques. Mais la raison l’emporte sur le vertige. Il faut reconnaître ce qui est là, chasser les « ombres inutiles », prendre les mesures nécessaires. L’essentiel est de « bien faire son métier ».
L’État de Peste : La Ville Close 🔒
Les chiffres augmentent rapidement. Rieux insiste pour nommer la maladie. Les analyses suggèrent le bacille de la peste, bien qu’avec quelques modifications spécifiques. Rieux, devant la commission sanitaire, presse le préfet et les médecins de prendre des mesures radicales. Il affirme que le microbe est capable de tuer la moitié de la ville en deux mois s’il n’est pas stoppé, peu importe comment on le nomme. Richard s’accroche aux réserves et au besoin de réflexion. Rieux l’interpelle sur la responsabilité.
Des affiches sont posées, annonçant quelques cas de « fièvre pernicieuse » et des mesures préventives modérées (dératisation, surveillance de l’eau, propreté, déclaration obligatoire, isolement des malades, désinfection). Elles cherchent à ne pas inquiéter l’opinion publique.
Malgré la faible ampleur initiale des mesures, le nombre de morts continue de monter (une dizaine par jour). Rieux et Tarrou (que nous rencontrerons plus en détail) organisent des formations sanitaires volontaires. Les sérums commandés tardivement de Paris arrivent, mais en quantité insuffisante si l’épidémie s’étend. Le fléau recule puis remonte brusquement. Le jour où le chiffre des morts atteint à nouveau la trentaine, la dépêche officielle tombe : « Déclarez l’état de peste. Fermez la ville. ».
La ville est fermée. Dès ce moment, la peste devient « notre affaire à tous ».
L’Exil et la Séparation : Une Souffrance Partagée 💔
La conséquence la plus remarquable de la fermeture est la séparation soudaine et imprévue des habitants. Mères et enfants, époux, amants sont éloignés « sans recours », « empêchés de se rejoindre ou de communiquer ». Ce sentiment de claustration forcée et de coupure d’avec les êtres aimés devient la « souffrance principale de ce long temps d’exil ».
Toute communication habituelle est coupée (trains, bateaux, poste). Les lettres sont interdites. Les téléphones interurbains suspendus puis sévèrement limités. Seuls les télégrammes subsistent, réduisant les passions à de simples « formules toutes faites ». La frustration et la stérilité de ces tentatives de communication accentuent le sentiment d’isolement.
L’expérience de la séparation modifie les sentiments. La confiance fait place à la jalousie, la légèreté à la constance. Le souvenir des absents hante les journées. La souffrance est double : la sienne et celle imaginée pour l’autre.
L’exil est ressenti comme un « creux » constant, un désir déraisonnable de revenir en arrière ou de hâter le temps. L’incapacité à spéculer sur la durée de la séparation est une source de « blessures ». Les habitants sont réduits à leur passé, l’avenir étant incertain.
Pour certains, comme le journaliste Rambert, l’exil est double : éloignés de l’être aimé et de leur patrie. Ils errent, regrettant les soirs et matins de leur pays perdu. Pour les amants, la séparation apporte aussi le remords et une « fiévreuse objectivité » sur leur amour passé, le trouvant imparfait face aux exigences du souvenir. La maladie ne fait pas qu’apporter une souffrance injuste ; elle pousse à se faire souffrir soi-même.
Curieusement, durant la première période de la peste, ces exilés sont en quelque sorte « privilégiés » ; leur désespoir centré sur l’attente de l’être aimé les préserve de la panique générale. Leur « égoïsme de l’amour » les sauve.
La Vie Quotidienne sous le Fléau 🛒🎭🔬
La ville close présente un aspect singulier. Le port est désert, le commerce s’est arrêté. La circulation diminue, les magasins de luxe ferment, tandis que des files se forment devant ceux de première nécessité. Paradoxalement, cela donne l’impression d’une ville en congé, ses habitants remplissant les rues et les cafés. Les cinémas projettent les mêmes films, les cafés sont pleins, l’alcool circule abondamment.
Pourtant, cette apparente normalité cache la difficulté à accepter la réalité. Les gens sont agacés par les dérangements, incriminant l’administration. Les statistiques officielles sont d’abord incomprises, puis l’augmentation des décès révèle l’ampleur du désastre.
La peste s’installe. La chaleur coïncide avec un accroissement des victimes. La ville s’abat. Les rues des faubourgs, d’ordinaire animées, se vident, les maisons se barricadent, que ce soit contre la peste ou le soleil. Les gémissements des malades deviennent le « langage naturel des hommes ».
Les bagarres aux portes de la ville, les tirs des gendarmes créent une « sourde agitation ». La peur de la révolte pousse les autorités à renforcer les interdictions de sortir et les patrouilles. Les tirs contre les chiens et chats renforcent l’atmosphère d’alerte. Le couvre-feu plonge la ville dans le silence nocturne, la transformant en une « nécropole ».
La mort devient un élément central de la vie à Oran. Les enterrements sont gérés avec une efficacité froide pour minimiser les risques. Les cérémonies sont rapides, les corps mis en bière et transportés au cimetière à grande vitesse. Au début, ces pratiques froissent, mais la pénurie de ravitaillement détourne l’attention vers des préoccupations plus immédiates.
Avec l’extension de l’épidémie, les cercueils et linceuls manquent, la place au cimetière s’épuise. L’administration organise la réutilisation des cercueils vides à la sortie du cimetière, tandis que les corps attendent dans un hangar. Le narrateur note ironiquement : « c’est le même enterrement, mais nous, nous faisons des fiches. Le progrès est incontestable. ».
Les familles sont progressivement écartées des cérémonies. Des fosses communes sont creusées, séparées par sexe au début. La chaux vive recouvre les corps dénudés. Le personnel pour ce travail est difficile à trouver, mais le chômage massif créé par la peste assure un recrutement constant de volontaires, la misère l’emportant sur la peur. Finalement, le cimetière est saturé, on utilise l’incinérateur, puis des tramways sans emploi sont convertis en corbillards pour transporter les corps au four crématoire en dehors de la ville.
Le narrateur souligne la monotonie des grands malheurs. La peste n’a rien de spectaculaire ou d’exaltant. C’est d’abord une « administration prudente et impeccable ». La grande souffrance est la séparation, mais même celle-ci perd de son pathétique avec le temps. Les habitants ne s’habituent pas vraiment, mais souffrent d’un « décharnement » moral et physique. Ils perdent la mémoire précise des absents, l’imagination s’émousse. L’amour devient une « abstraction ». Ils acceptent la routine et l’indifférence. La peste a « enlevé à tous le pouvoir de l’amour et même de l’amitié », réduisant la vie à des instants. Les valeurs sont supprimées, l’on accepte tout « en bloc ». Le sentiment de séparation devient une « attente butée », comparable aux longues files devant les boutiques d’alimentation.
Les Personnages : Confrontations et Transformations 👥
Le texte nous présente plusieurs figures dont les parcours et réactions illustrent les différentes facettes de la vie sous la peste :
Dr. Bernard Rieux : L’Honnêteté de Faire son Métier 🩺
Le Dr. Rieux est le narrateur et un personnage central. Il est décrit comme un homme de taille moyenne, aux épaules fortes, au visage presque rectangulaire, avec des yeux sombres et droits. Il a l’air d’un « paysan sicilien ». Il marche vite, est parfois distrait au volant.
Dès le début, il est en première ligne face à l’épidémie, diagnostiquant les cas, incisant les bubons. Il incarne la résistance pragmatique et acharnée. Pour lui, lutter contre la peste est une question d’honnêteté. Il ne s’agit pas d’héroïsme, mais de « faire son métier ». Il refuse de se laisser abattre. Son rôle est de « diagnostiquer », « voir, décrire, enregistrer, puis condamner » (isoler). Il n’est pas là pour donner la vie, mais pour faire ce qu’il faut face à la maladie.
Face au Père Paneloux, il exprime son refus d’accepter la souffrance, notamment celle des enfants. Il ne croit pas en un Dieu qui inflige de tels maux. Il lutte contre « la création telle qu’elle était ». Il est fatigué, sa sensibilité s’émousse. Il se réfugie dans le « durcissement ». Son cœur lui sert à « supporter les vingt heures par jour où il voyait mourir des hommes » et à « recommencer tous les jours ».
Sa séparation d’avec sa femme, partie se soigner, est une douleur constante. Il lui envoie des télégrammes. Il finit par apprendre son décès par télégramme, « huit jours » après. Il l’accepte avec calme, sans surprise, car la douleur est continue.
Il est conscient de l’isolement des malades. Il se sent démuni, mais aussi solidaire. Il représente l’effort humble et incessant pour limiter les dégâts du fléau. Sa victoire n’est pas définitive, mais réside dans la lutte elle-même.
Jean Tarrou : La Recherche de la Sainteté sans Dieu 🙏
Jean Tarrou est un étranger récemment installé à Oran. Il est « bonhomme, toujours souriant », apparemment aisé. Il observe la ville et ses habitants avec une curieuse satisfaction, notant les détails insignifiants dans ses carnets. Il est particulièrement fasciné par le petit vieux crachant sur les chats.
Tarrou s’intéresse à la peste dès les premiers signes. Il organise les formations sanitaires volontaires, jugeant l’administration incapable. Il préfère les hommes libres aux prisonniers pour ce travail, car il a une « horreur des condamnations à mort ».
Sa conversation avec Rieux révèle son histoire et sa philosophie. Il se considère comme un « pestiféré » depuis longtemps. Ayant assisté à un procès où son père, avocat général, a requis la mort d’un accusé (« le hibou roux »), il a développé une aversion profonde pour la peine capitale et toute forme de meurtre. Il a fait de la politique pour combattre l’assassinat. Cependant, il a réalisé que même dans la lutte pour un monde meilleur, on prononce des condamnations. L’expérience d’une exécution le marque profondément. Il comprend qu’il a souscrit indirectement à la mort et qu’il n’a « pas cessé d’être un pestiféré ».
Sa recherche est la paix intérieure, la sainteté. Mais une sainteté « sans Dieu ». Il refuse d’être avec le fléau, de justifier le meurtre. Il s’efforce de « parler et d’agir clairement », de se placer « du côté des victimes » pour limiter les dégâts. Il sait que chacun porte la peste en soi et que la lutte contre elle est une « volonté qui ne doit jamais s’arrêter », une immense fatigue.
Il cherche la compréhension, l’amitié. Le bain de mer avec Rieux symbolise un rare moment de liberté et de solidarité loin de la peste. Tarrou est un homme qui « prenait le volant de son auto à pleines mains » et dont le corps était « épais, étendu maintenant sans mouvement », image de vie et de mort.
Il tombe malade vers la fin de l’épidémie. Rieux et sa mère le soignent chez eux, malgré le risque et les règles. Tarrou fait face à la mort avec courage, cherchant à faire une « bonne fin ». Il subit l’agonie avec détermination. Sa mort est décrite avec intensité, un « naufrage » contre lequel Rieux est impuissant. Son « silence de la défaite » est ressenti comme définitif par Rieux.
Joseph Grand : Le Héros Discret de la Bonne Volonté ✨
Joseph Grand est un humble employé de mairie, long et maigre, aux épaules étroites. Il est caractérisé par sa difficulté à trouver les mots justes. Il vit modestement, avec une « vertu tranquille » et des « bons sentiments » qu’il n’a pas honte d’avouer (aimer ses neveux, sa sœur, se souvenir de ses parents).
Son grand projet est l’écriture d’un livre. Il travaille « pour lui », cherchant à atteindre la perfection dans une seule phrase. Il s’épuise dans cette recherche.
Il s’est marié jeune par amour avec Jeanne. L’épuisement du travail, la pauvreté et le silence ont éloigné la passion, et Jeanne est partie en lui écrivant qu’elle était « fatiguée » et qu’on « n’a pas besoin d’être heureux pour recommencer ». Il a souffert de cette séparation. Ce qu’il aurait voulu, c’était « trouver les mots qui l’auraient retenue ». Il pense toujours à elle.
Malgré son manque d’héroïsme apparent, il dit oui sans hésitation lorsqu’on lui demande de l’aide. Il assure le secrétariat et les statistiques des formations sanitaires. Il est le « représentant réel de cette vertu tranquille ». Sa motivation est simple : « Il y a la peste, il faut se défendre, c’est clair ». Le narrateur le propose comme le « héros insignifiant et effacé » de cette histoire, soulignant que l’héroïsme réside dans la « bonne volonté » et l’effort quotidien.
Il tombe gravement malade vers Noël. Dans le délire, il exprime sa détresse, son désir d’écrire à Jeanne, sa fatigue d’avoir toujours dû faire un effort énorme pour être « normal ». Il demande que son manuscrit soit brûlé. Contre toute attente, il survit. Après sa convalescence, il se remet au travail et à sa phrase, ayant « supprimé tous les adjectifs ». Il écrit à Jeanne et est « content ».
Raymond Rambert : Du Bonheur Individuel à la Solidarité 🤔🤝
Raymond Rambert est un journaliste parisien bloqué à Oran par le confinement. Sa seule préoccupation est de retrouver la femme qu’il aime, restée à Paris. Il tente d’abord par les voies officielles, se heurtant à la bureaucratie et à l’indifférence. Il rencontre divers types de fonctionnaires.
Frustré, il se tourne vers les voies clandestines, en passant par Cottard. Il cherche la « complicité » pour s’évader. Il est prêt à payer cher.
Rambert défend son droit au bonheur personnel, refusant les « abstractions » du fléau. Il ne se sent pas d’Oran. Il accuse Rieux de manquer de cœur en ne prenant pas en compte les séparations.
Sa perspective change progressivement. Il est touché par l’effort des formations sanitaires. Il se confie sur son idée du courage et sur son manque d’intérêt pour ceux qui meurent pour une idée plutôt que pour ce qu’ils aiment. Il affirme qu’il « ne croit pas à l’héroïsme », qu’il est « facile » et « meurtrier ». Ce qui l’intéresse, c’est « qu’on vive et qu’on meure de ce qu’on aime ». Rieux lui répond que « l’homme n’est pas une idée ».
Malgré ses plans d’évasion presque finalisés, il décide de rester et de travailler avec Rieux. Il réalise qu’il est « d’ici, qu'[il] le veuille ou non » et que cette histoire les « concerne tous ». Il ressentirait de la « honte à être heureux tout seul ». Il accepte sa « distraction » mise en lui par la peste et retrouve finalement la femme qu’il aime lors de la réouverture des portes. Leur réunion est intense et émouvante.
Cottard : Le Complice de la Peste 🃏💰👮♂️
Cottard est un homme bizarre, représentant en vins et liqueurs. Après sa tentative de suicide, il développe une nouvelle personnalité, cherchant à se concilier les gens, devenant poli et sociable. Il fréquente les lieux de luxe. Tarrou note qu’il semble « grandir » et trouve un certain confort dans le malheur général. La peste le met « dans le bain » avec tout le monde, dissipant son angoisse personnelle (sa peur d’être arrêté). La peste a suspendu les enquêtes et les risques judiciaires pour lui.
Tarrou l’appelle le « complice » de la peste. Cottard se délecte de la peur et des superstitions des autres, qu’il a connues avant eux. Il s’engage dans des affaires de contrebande profitant de la situation, ce qui le rend remarqué.
Son attitude est instable, passant de la sociabilité à la sauvagerie. Il refuse de rejoindre les formations sanitaires, déclarant qu’il se trouve bien « dans la peste » et ne voit pas pourquoi il se mêlerait de la faire cesser. Il se moque des autres qui s’empoisonnent l’existence en attendant la fin.
Lorsque la peste recule, Cottard est consterné. Il s’accroche à l’idée que cela pourrait reprendre. Il est agité, cherchant à savoir si la vie redeviendra « normale » comme si rien ne s’était passé. Sa peur de l’après-peste est palpable. Sa fin est violente : il tire sur la foule lors des célébrations de la libération et est abattu par la police. Le narrateur le décrit comme ayant un « cœur ignorant, c’est-à-dire solitaire ».
Père Paneloux : Foi et Épreuve ✝️🤔✝️
Le Père Paneloux est un jésuite érudit. Il s’est fait connaître par ses conférences sur l’individualisme moderne et sa défense d’un christianisme exigeant. Il est très estimé.
Lors de son premier prêche, en pleine recrudescence de la peste, il présente le fléau comme un châtiment divin, un « coup » asséné aux « orgueilleux et les aveugles ». Il invite les fidèles à « méditer » et à « tomber à genoux », voyant dans la peste l’occasion de retrouver la lumière de Dieu. Il évoque l’ange de la peste frappant aux portes.
Il rejoint les formations sanitaires. La souffrance qu’il voit, notamment celle d’un enfant mourant, le bouleverse. Il prie pour l’enfant. Après cette expérience, il semble changé. Il est tendu, angoissé.
Son deuxième prêche, moins fréquenté, est plus réfléchi. Il parle en disant « nous ». Il ne cherche pas à expliquer la peste mais à en tirer une leçon pour le chrétien. Il confronte la logique divine aux souffrances inexplicables, comme celle d’un enfant. Il insiste sur le scandale de cette souffrance. Face à cela, il faut « tout croire ou tout nier ». C’est une exigence, une « vertu du Tout ou Rien ». La souffrance des enfants est notre « pain amer », qu’il faut vouloir parce que Dieu la veut. Il invite à « être celui qui reste ». Il ne s’agit pas de résignation, mais d’une acceptation « active », en faisant du bien dans la ténèbre. Il faut accepter l’incompréhensible, s’en remettre à Dieu, même pour la mort des innocents.
Paneloux tombe malade quelques jours après son deuxième prêche. Il refuse l’aide médicale, estimant que cela n’est pas en accord avec ses principes. Rieux le trouve gravement malade, sans symptômes clairs de peste, mais l’isole par doute. Paneloux serre un crucifix. Son cas est jugé « douteux ». Il meurt sans lâcher le crucifix.
M. Othon : La Souffrance qui Transforme 👨👦
M. Othon est le juge d’instruction. Il est décrit comme « long et noir », ressemblant « moitié à ce qu’on appelait autrefois un homme du monde, moitié à un croque-mort ». Il est formel, parle poliment mais brièvement. Tarrou le voit comme « l’ennemi numéro un », représentant la loi et la condamnation.
Son fils tombe malade. M. Othon fait appel à Rieux. Il accepte les règles d’isolement, même la séparation d’avec sa famille. Il demande à Rieux de « sauver [s]on enfant ». Son fils meurt.
Après avoir purgé sa quarantaine, M. Othon, amaigri, demande à Rieux de l’aider à retourner volontairement au camp d’isolement. Il veut s’occuper, se sentir « moins séparé de [s]on petit garçon ». Cette demande surprend, montrant un changement en lui, une douceur inattendue dans ses yeux autrefois durs. Sa souffrance l’a transformé. Il meurt de la peste plus tard.
La Lutte Continue : Formations Sanitaires et Résilience 💪
Face à l’épidémie, la réponse n’est pas seulement administrative ou religieuse. Elle est aussi humaine et solidaire. Jean Tarrou, avec l’accord de Rieux, organise des formations sanitaires volontaires. Ces équipes rassemblent des hommes libres qui s’engagent à combattre le fléau.
Le narrateur insiste sur l’importance objective de ces formations. Il refuse de faire l’éloge d’un héroïsme spectaculaire. Le mérite n’est pas si grand car « c’était la seule chose à faire ». L’héroïsme réside dans les efforts « insignifiants et effacés », la simple « bonne volonté ». Ces efforts aident les citoyens à comprendre que la peste est « l’affaire de tous ». La question n’est pas la récompense, mais de savoir si « deux et deux font quatre » face à la mort et à la nécessité de lutter.
Des figures comme le vieux Dr. Castel travaillent sans relâche pour fabriquer un sérum local, adapté au microbe spécifique d’Oran. Joseph Grand, sans être un héros, assure patiemment le travail de secrétariat et de statistiques pour les équipes. Rambert, après avoir renoncé à fuir, met sa « bonne volonté » au service de ces formations. Paneloux les rejoint aussi.
Cette lutte est épuisante. La fatigue gagne les sauveteurs, provoquant une « curieuse indifférence » et une négligence des précautions, les rendant eux-mêmes plus vulnérables. L’administration et le monde extérieur peinent à comprendre et à exprimer leur solidarité face à cette douleur invisible et quotidienne. Rieux comprend que l’honnêteté consiste à « faire son métier », même face à l’épuisement.
Le Recul de la Peste et la Libération 🎉
Après des mois de lutte et de souffrance, la peste montre des signes de recul. Les rats réapparaissent vivants. Les statistiques baissent de façon significative en janvier, notamment grâce au froid et peut-être au sérum de Castel.
Le recul est inattendu. L’espoir, d’abord timide, devient palpable. On commence à parler de la vie après la peste. Les réactions sont contradictoires, entre l’impatience de certains qui tentent de fuir malgré tout et le retour de l’optimisme (baisse des prix, regroupement des communautés séparées).
Le 25 janvier, la préfecture annonce officiellement que l’épidémie est « enrayée ». Les portes restent fermées deux semaines de plus par prudence. La ville s’illumine à nouveau. Malgré le deuil de certaines familles, une « joyeuse agitation » gagne la cité. C’est la « veillée » de la libération.
Le sentiment de séparation, si lourd, touche à sa fin pour beaucoup. Les trains arrivent, les bateaux s’annoncent. Les retrouvailles sur le quai de la gare sont intenses, des bras se referment sur les êtres aimés. Pour Rambert, c’est la joie d’une réunion longtemps désirée, mêlée à la conscience d’avoir changé.
La ville entière célèbre. On danse, les cloches sonnent, les cafés sont pleins. L’égalité, que la mort n’avait pas totalement instaurée, est vécue pour quelques heures dans la joie de la délivrance. Certains « touristes de la passion » revisitent les lieux de leur souffrance passée, affirmant par leur bonheur que la peste et la terreur ont fait leur temps.
La Mémoire et les Leçons du Fléau 🤔✍️
Le Docteur Rieux se révèle être l’auteur de la chronique. Il a choisi un ton objectif, rapportant les faits, les documents et les témoignages. Il s’est efforcé de comprendre ses concitoyens, partageant leurs angoisses, leur amour, leur souffrance, leur exil. Il a tu ses propres épreuves directes, car elles étaient communes à tous. Il a délibérément pris « le parti de la victime ».
La chronique s’achève sur la mort de Cottard, abattu par la police lors des célébrations. Le vieil asthmatique survit, observant la ville et ses habitants. Tarrou, le grand ami de Rieux, meurt de la peste juste avant l’ouverture des portes. La femme de Rieux décède loin de lui. Grand, le héros discret, survit et retrouve Jeanne par lettre. Rambert retrouve la femme qu’il aime. M. Othon meurt de la peste après s’être transformé par la souffrance. Père Paneloux meurt d’une maladie « douteuse » mais liée au fléau.
Rieux, marchant seul au milieu des célébrations, observe les scènes de retrouvailles et l’oubli rapide. Il identifie « l’air de famille » des Oranais pendant la peste comme celui d’émigrants, d’exilés. Tous aspiraient à une réunion, une « vraie patrie » au-delà des murs, dans la nature, la liberté et l’amour.
Rieux constate que ceux qui ont cherché le bonheur dans l’amour humain ont pu être récompensés. Mais ceux qui ont cherché « par-dessus l’homme à quelque chose qu’ils n’imaginaient même pas » n’ont pas eu de réponse. Tarrou a trouvé la paix dans la mort, trop tard.
La chronique n’est pas celle de la « victoire définitive ». C’est un témoignage de ce qu’il a fallu « accomplir » et que les hommes devront « accomplir encore ». L’effort continu « contre la terreur et son arme inlassable » est essentiel.
Le narrateur sait que « le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais ». Il reste latent, attendant patiemment le jour où, « pour le malheur et l’enseignement des hommes », il réveillera ses rats. Cette connaissance modère toute allégresse triomphale. Rieux conclut son récit pour « témoigner en faveur de ces pestiférés », pour laisser un souvenir de l’injustice, et pour dire que, malgré tout, on apprend « qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser ». Ceux qui luttent contre les fléaux, refusant de les admettre, s’efforcent d' »être des médecins », même sans être des saints.
Conclusion : L’Éternel Combat de l’Homme 🕊️
La Peste d’Albert Camus, telle que dépeinte dans ces extraits, est une méditation profonde sur la nature du mal, la condition humaine et la capacité de résilience. À travers l’expérience d’une ville assiégée par un fléau, Camus explore l’absurdité de la souffrance, la fragilité des vies ordinaires et l’importance cruciale de la solidarité.
Les personnages, du pragmatique Rieux au mystique Tarrou, de l’humble Grand au tourmenté Cottard, du dogmatique Paneloux au transformé Othon, représentent diverses réponses face à l’épreuve. Le roman souligne que l’héroïsme ne réside pas dans les grands gestes, mais dans l’effort quotidien, l’honnêteté et la persévérance. La séparation et l’exil révèlent l’attachement profond aux êtres aimés et la soif de connexion humaine.
Le fléau, bien que vaincu temporairement, n’est jamais totalement disparu. La lutte contre le mal est un combat incessant, une vigilance permanente. Le livre nous rappelle que la victoire n’est pas une fin, mais un répit fragile, et que la véritable leçon est l’apprentissage de la compréhension, de l’humilité et de la capacité à admirer la dignité humaine même au cœur du désastre. C’est une œuvre qui résonne encore aujourd’hui, nous invitant à réfléchir sur notre propre humanité face aux crises.
Les Personnages principaux
Docteur Bernard Rieux
Le docteur Bernard Rieux est le narrateur de cette chronique, bien qu’il se présente initialement comme un simple témoin objectif. Il est le personnage central autour duquel s’organise la lutte contre la peste à Oran. Médecin de profession, il est âgé d’environ trente-cinq ans. Son apparence est celle d’un homme robuste et sombre : taille moyenne, épaules fortes, visage presque rectangulaire, yeux sombres et directs, mâchoires saillantes, nez fort et régulier, cheveux noirs très courts, et une bouche arquée aux lèvres pleines et serrées, rappelant un paysan sicilien. Il a un air renseigné et marche vite, avec une certaine agilité, bien que distrait au volant.
La vie personnelle de Rieux est marquée par la séparation d’avec son épouse, envoyée en sanatorium hors de la ville pour une maladie. Sa mère vient alors vivre avec lui et s’occuper de sa maison, offrant une présence silencieuse et rassurante.
C’est Rieux qui découvre le premier rat mort, un événement précurseur des signes déconcertants qui annoncent le fléau. Confronté à la multiplication anormale des rats morts, il alerte les autorités et insiste pour des mesures, bien que l’administration et certains confrères soient lents à réagir ou à reconnaître la gravité de la situation. Il est en première ligne face à la maladie humaine, examinant les premiers cas, dont celui du concierge Michel, et constatant rapidement les symptômes terribles : fièvre, ganglions enflés, taches.
Face à la propagation et au nombre croissant de morts, Rieux plaide avec force pour la reconnaissance officielle de l’épidémie comme étant la peste et pour l’adoption de mesures strictes, se heurtant à la prudence et à l’hésitation des autorités et de certains médecins. Il s’investit sans relâche dans l’organisation des secours sanitaires, ouvrant et dirigeant des hôpitaux auxiliaires, soignant les malades, incisant les bubons, et gérant les aspects pratiques de la lutte. Ce travail l’épuise profondément. Il est confronté quotidiennement à la souffrance et à la mort, supportant la détresse des familles et l’horreur de la maladie. Il développe une forme d’indifférence nécessaire pour continuer, se protégeant de la pitié inutile.
Dans ses discussions, notamment avec Tarrou, Rieux exprime sa philosophie. Il ne croit pas en Dieu mais se bat contre l’ordre du monde tel qu’il est, car il ne peut accepter la souffrance et la mort, particulièrement celle des enfants. Il refuse l’idée de punition collective. Son métier est de soigner, de lutter contre la mort, sans chercher de sens supérieur aux événements. Il voit cette lutte comme une « interminable défaite » mais une tâche essentielle dictée par la « misère » humaine.
Rieux subit de lourdes pertes personnelles pendant l’épidémie. Son ami Tarrou meurt de la peste, un événement qu’il ressent comme une « défaite définitive ». Peu après, il reçoit la nouvelle du décès de sa femme. Ces épreuves le marquent mais ne l’empêchent pas de continuer son travail jusqu’à la fin de l’épidémie.
En tant que chroniqueur, Rieux explique qu’il a voulu témoigner des actes et des souffrances de ses concitoyens, s’identifiant à eux dans leur « amour, la souffrance et l’exil ». Il choisit délibérément de prendre le parti des victimes et de rendre compte de ce qu’il a vu avec objectivité et retenue. Il se définit, ainsi que les autres qui refusent les fléaux et s’efforcent d’être humains, comme des « médecins » plutôt que des saints ou des héros. Il conclut sur la nature permanente de la peste, symbolisant le mal toujours présent et susceptible de resurgir.
Jean Tarrou
Jean Tarrou est un nouveau venu à Oran au début du récit, s’étant installé dans un grand hôtel. Son origine et les raisons de sa présence sont inconnues. Il semble aisé et passe son temps à observer la vie de la ville, qu’il décrit dans des carnets détaillés. Ces notes, souvent concentrées sur des détails apparemment insignifiants, révèlent une capacité d’observation aigüe et une certaine curiosité pour la banalité quotidienne. Il observe la laideur d’Oran, les habitudes de ses habitants, et même des scènes particulières comme celle du « petit vieux » crachant sur les chats.
Lorsque la peste s’installe, Tarrou s’intéresse immédiatement au phénomène, le trouvant « positively interesting ». Il est l’un des premiers à reconnaître l’ampleur de la crise et, constatant l’impuissance de l’administration, il prend l’initiative d’organiser des formations sanitaires volontaires pour lutter contre l’épidémie. Il recrute des volontaires en dehors des voies officielles et participe activement à l’effort, supervisant les équipes et s’occupant des statistiques.
La motivation profonde de Tarrou dans ce combat est son opposition radicale à la peine de mort et, plus largement, à toute forme d’assassinat ou de justification de la mort d’autrui. Il confie à Rieux l’histoire de son engagement passé, où il a milité contre une société basée sur la condamnation à mort. Cependant, l’expérience de voir une exécution et de réaliser que son propre camp prononçait aussi des condamnations au nom d’un idéal futur lui a fait comprendre qu’il était lui-même un « pestiféré » s’il acceptait ces compromis. Dès lors, il a choisi de refuser tout ce qui, de près ou de loin, « fait mourir ou justifie qu’on fasse mourir ».
Tarrou croit que le « bacille de la peste » (le mal) est présent en chaque homme, et que la lutte contre lui est une affaire de vigilance constante contre la distraction qui pourrait nous faire « infecter » les autres. L’homme honnête est celui qui est le moins distrait. Cette lutte pour « ne pas être un pestiféré » est fatigante et mène à l’isolement, mais il la juge nécessaire pour trouver la paix.
Tarrou cherche la paix et se demande s’il est possible d’atteindre la sainteté sans croire en Dieu. Il observe les autres habitants d’Oran et leurs réactions face à la peste avec un intérêt particulier, notamment Cottard, dont il analyse le comportement et la satisfaction apparente face à la détresse collective. Il voit en Cottard un « complice » qui se sent moins seul dans la terreur partagée. Il observe également Paneloux, interprétant son évolution et sa foi confrontée à la souffrance des enfants.
Malgré la gravité de la situation, Tarrou conserve une certaine légèreté et un désir de vie. Il partage un moment de camaraderie et de liberté avec Rieux en nageant dans la mer la nuit, un instant de bonheur loin de la peste.
Vers la fin de l’épidémie, alors que les statistiques baissent, Tarrou tombe malade. Il refuse l’isolement réglementaire pour être soigné par Rieux et sa mère. Il affronte la maladie avec un courage silencieux, luttant jusqu’au bout pour faire une « bonne fin ». Ses derniers moments sont une lutte immobile contre le mal. Il meurt de la peste, et Rieux ne sait pas si, pour finir, il a trouvé la paix qu’il cherchait, mais garde de lui l’image d’un homme de « chaleur de vie et une image de mort ».
Joseph Grand
Joseph Grand est un employé de mairie à Oran. Il est décrit comme un homme d’une cinquantaine d’années, long et voûté, avec une moustache jaune, des épaules étroites et des membres maigres. Son apparence générale est insignifiante ; il porte des vêtements trop grands et a une démarche effacée. Ayant perdu la plupart de ses dents supérieures, son sourire crée une « bouche d’ombre ».
Grand occupe un poste temporaire à la mairie, payé très modestement. Il a accepté ce poste après ses études avec la promesse d’une promotion qui ne s’est jamais concrétisée, une situation qui dure depuis vingt-deux ans. Il n’est pas animé par l’ambition matérielle mais par un désir de sécurité financière pour pouvoir se consacrer à ses « occupations favorites ».
La caractéristique la plus notable de Grand est son combat constant pour trouver les mots justes. Cette difficulté l’empêche de rédiger une lettre de réclamation pour sa situation professionnelle ou de prendre les démarches nécessaires dans la vie courante. Il est excessivement tatillon sur le choix des termes, hésitant longuement sur des mots simples. Paradoxalement, son incapacité à se plaindre lui a permis de s’adapter à sa pauvreté, menant une vie simple, presque ascétique.
Grand est un homme d’une grande bonté et doté de « bons sentiments » qu’il n’hésite pas à avouer, comme son amour pour sa famille ou son affection pour des choses simples comme la cloche de son quartier. Son plus grand désir est d' »apprendre à m’exprimer ». Rieux découvre que Grand consacre ses soirées à écrire un livre, qui se résume pour l’instant à une seule phrase qu’il cherche à perfectionner indéfiniment. Il rêve que son travail soit reconnu pour sa perfection formelle.
Au début de l’épidémie, Grand est impliqué malgré lui lorsqu’il sauve son voisin Cottard d’une tentative de suicide. Face à la peste, Grand adopte une attitude simple et dévouée. Il se porte volontaire pour tenir le secrétariat des formations sanitaires, gérant les statistiques et les enregistrements, un travail qu’il accomplit avec une patience et une diligence exemplaires. Il le fait par simple bonne volonté, considérant qu’il est clair qu’il faut se défendre contre la peste. Rieux voit en lui un représentant de la « vertu tranquille » qui anime les volontaires.
Grand se confie à Rieux et Tarrou sur son passé et son histoire d’amour malheureuse avec Jeanne. Il l’a épousée très jeune, mais le travail et la pauvreté ont eu raison de leur amour, et Jeanne est partie. Il souffre de cette séparation et regrette de ne pas avoir trouvé les mots pour la retenir ou pour se justifier auprès d’elle. Ce souvenir le hante et est lié à sa difficulté à s’exprimer.
Malgré sa fragilité physique, Grand endure le surmenage causé par ses différentes tâches. Il tombe gravement malade de la peste vers Noël. Dans son délire, il pense à Jeanne et demande à Rieux de brûler son manuscrit inachevé. Contre toute attente, il survit à la maladie.
Après sa guérison, Grand reprend son travail comme si rien ne s’était passé. À la fin du récit, il informe Rieux qu’il a finalement écrit à Jeanne et qu’il est content. Il a également recommencé sa phrase, en supprimant tous les adjectifs pour plus de simplicité. Il incarne une forme d’héroïsme modeste et effacé, consacré à son travail et à son idéal.
Raymond Rambert
Raymond Rambert est un jeune journaliste, originaire de Paris, qui se retrouve bloqué à Oran par la quarantaine imposée en raison de la peste. Il est décrit comme un homme de petite taille, avec des épaules épaisses, un visage décidé et des yeux clairs et intelligents. Il a l’air à l’aise dans la vie, s’habillant de façon sportive. Il était venu à Oran pour faire un reportage sur les conditions de vie des Arabes.
La fermeture de la ville le sépare de sa maîtresse (qu’il appelle sa femme) restée à Paris, ce qui devient sa principale source d’angoisse et de motivation. Il ressent la séparation comme un exil personnel et intense. Son unique objectif est de quitter Oran pour la rejoindre.
Initialement, il tente de s’échapper par les voies officielles, sollicitant les autorités administratives. Il plaide son cas en tant qu’étranger à la ville, mais se heurte à la rigidité de la bureaucratie. Il rencontre le docteur Rieux et lui demande de l’aider à partir, mais Rieux refuse, arguant que la situation concerne tout le monde et qu’il doit faire son devoir. Rambert voit l’attitude de Rieux comme abstraite et insensible à son besoin de bonheur individuel.
Face à l’échec des démarches officielles, Rambert cherche des moyens illégaux pour quitter la ville. Il entre en contact avec des passeurs par l’intermédiaire de Cottard et organise un plan pour s’échapper en soudoyant des gardes. Ces tentatives sont jalonnées de difficultés et de délais, lui donnant le sentiment de ne pas avancer et d’être pris dans un cycle infernal.
Au cours de ses efforts, Rambert exprime sa vision de la vie. Il affirme que l’homme n’est pas fait pour l’héroïsme ou les grandes idées, mais pour vivre et mourir de ce qu’il aime. Il trouve de la honte à être heureux seul pendant que les autres souffrent.
Après avoir été confronté de près à la souffrance causée par la peste, notamment en visitant un hôpital avec Rieux, et après avoir longuement réfléchi à la nature du combat mené par Rieux et Tarrou, Rambert connaît un changement. Il décide, juste avant son évasion, de renoncer à partir et de rejoindre les formations sanitaires. Il comprend que, qu’il le veuille ou non, il fait désormais partie de cette ville et que la lutte contre la peste les concerne tous.
Rambert s’engage alors dans le travail des équipes volontaires, se montrant diligent et efficace, notamment en dirigeant une maison de quarantaine. Il trouve un moyen de correspondre clandestinement avec sa maîtresse. Il continue de croire en son droit au bonheur mais choisit de participer au malheur collectif.
À la fin de l’épidémie, lorsque les portes de la ville rouvrent, Rambert est à la gare pour accueillir sa maîtresse. Leurs retrouvailles sont chargées d’émotion, mêlant la joie de la réunion à la douleur de la séparation passée. Il se réunit à la foule en liesse, symbolisant le retour à une vie normale et le triomphe (temporaire) sur l’exil et la souffrance.
Cottard
Cottard est présenté au début du récit comme le voisin de Joseph Grand. Il attire l’attention en tentant de se suicider par pendaison, étant sauvé in extremis par Grand. Il est décrit comme un petit homme rond, au visage massif et creusé, encadré d’épais sourcils.
Après sa tentative, Cottard se montre extrêmement anxieux face à la perspective d’une enquête policière. Il supplie le docteur Rieux de ne pas le dénoncer, craignant d’être arrêté. Devant le commissaire, il attribue son acte à des « chagrins intimes ». On apprend plus tard, par une confidence à Tarrou, qu’il était sous le coup d’une affaire légale passée qui l’avait rendu anxieux et qu’il pensait oubliée. Son suicide était une « bêtise » faite par « affolement ». Il craint d’être séparé de sa maison et de ses habitudes par une peine de prison.
Avant ces événements, Cottard menait une vie solitaire et méfiante. Il était représentant en vins et liqueurs, ses relations se limitaient à quelques clients et des sorties discrètes. Grand a remarqué qu’il semblait apprécier les films de gangsters.
L’arrivée de la peste transforme radicalement le comportement de Cottard. Il devient sociable, cherchant activement la compagnie des autres et s’efforçant de gagner leur sympathie. Il se sent mieux dans la situation générale, déclarant que « tout le monde est dans le bain » avec lui. Selon l’interprétation de Tarrou, la terreur collective causée par la peste détourne l’attention de ses propres problèmes légaux et le fait se sentir moins isolé dans son angoisse. Il profite de la désorganisation pour se lancer dans la contrebande et faire fortune. Il ne souhaite pas que l’épidémie s’arrête car elle « arrange ses affaires ». Tarrou le décrit comme un « complice » qui semble prendre plaisir à la détresse et aux réactions irrationnelles des autres habitants.
Malgré cette apparente satisfaction, Cottard manifeste une grande instabilité d’humeur, alternant entre périodes de sociabilité forcée et repli sauvage. Il s’inquiète de la fin de l’épidémie, craignant un retour à la vie normale et le resurgissement de ses problèmes légaux. Il espère l' »imprévu » qui pourrait empêcher la situation de revenir comme avant.
Lorsque la fin de la peste est annoncée officiellement, Cottard disparaît. Juste avant la réouverture des portes de la ville, il est retrouvé dans son appartement, ayant perdu la raison et tirant sur la foule depuis sa fenêtre. Il est arrêté violemment par la police. Grand le déclare fou. Rieux le décrit comme un homme au « cœur ignorant, c’est-à-dire solitaire », dont le « seul vrai crime » fut d’avoir approuvé la mort et la souffrance causées par la peste. Sa mort ou son sort final ne sont pas explicitement décrits, mais son arrestation marque sa disparition du récit, alors que les autres personnages célèbrent la fin de l’épidémie. Le vieux asthmatique, sans connaître les détails de son arrestation, l’évoque ironiquement comme quelqu’un qui « savait ce qu’il voulait ».