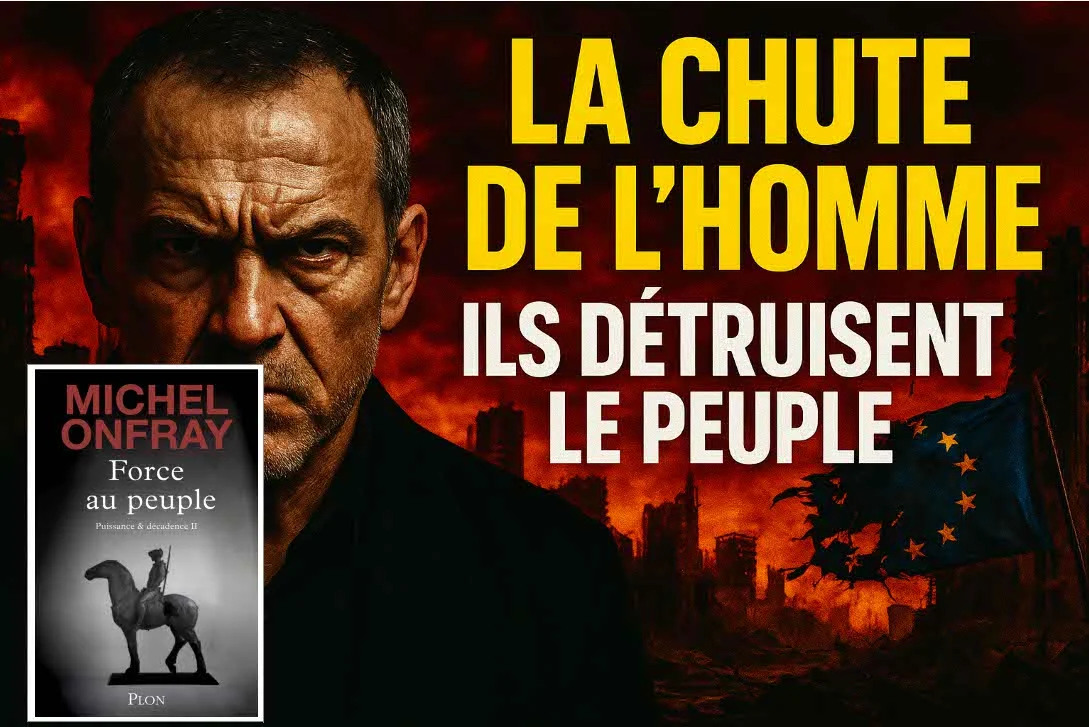Les liens pour vous procurer les différentes versions
📗Lien vers le livre papier : https://amzn.to/4mivLBK
📕Lien vers l’ebook : https://amzn.to/46aQxgn
Où Va Notre Argent ? Une Plongée Inquiétante dans la Gestion Fiscale et Publique de la France 📉
La France, pays des Lumières, de la gastronomie et… de l’overdose fiscale ? Un ouvrage récent lève le voile sur une réalité alarmante : malgré des niveaux record d’impôts et de dépenses publiques, nos services essentiels s’effritent. Ce n’est pas un problème de moyens, mais bien de gestion, de transparence et de redevabilité. Préparez-vous à découvrir pourquoi votre argent, loin de servir à construire un avenir solide, semble s’évaporer dans un système défaillant.
💰 La France, Championne des Prélèvements Obligatoires (et de l’Overdose Fiscale)
L’image d’une France « village Potemkine », avec une façade soignée mais une désintégration interne, est frappante. Le pays est le plus dépensier et le plus taxé de la zone euro, mais ses services publics s’effondrent les uns après les autres. Derrière les « tunnels médiatiques » (Covid, guerre, sécheresse), la « déroute » est dissimulée, et les Français sont « mentis » sur la mauvaise gestion de leur argent.
📊 Un Record de Fiscalité Inédit et Paradoxal
En 2022, la France a atteint un triste record : 45,2 % de taux de prélèvements obligatoires, le plus élevé depuis les années 1990. C’est 1 195 milliards d’euros prélevés, une augmentation de 80 % en vingt ans, deux fois plus vite que l’inflation. Le pays compte 483 taxes et cotisations, et un Code général des impôts de plus de 4 000 pages.
Le discours gouvernemental promet des baisses d’impôts depuis 2017, mais la réalité est tout autre : les impôts n’ont jamais été aussi hauts. L’inflation a joué un rôle majeur, générant environ 62 milliards d’euros de recettes supplémentaires en 2022. La Sécurité sociale a été la principale bénéficiaire (45 milliards supplémentaires), suivie par l’État (34 milliards) et les collectivités (8 milliards). La TVA a connu la plus forte augmentation (18 milliards supplémentaires, dépassant les 200 milliards pour la première fois en 2022), suivie par les cotisations sociales (liées à l’augmentation des salaires), la CSG (+7 milliards), l’impôt sur les sociétés (+12,7 milliards) et l’impôt sur le revenu (+8 milliards).
Malgré des baisses d’impôts marginales comme celle de la taxe d’habitation (2,8 milliards) ou la suppression de la redevance TV (3,2 milliards), elles sont dérisoires face aux 86 milliards d’augmentations. L’exécutif serait tenté de dépenser ces recettes supplémentaires en « chèques énergie » plutôt que de baisser durablement les impôts, et les bases cadastrales, et donc les taxes foncières, devraient encore augmenter de 7 % en 2023. Cette « overdose fiscale » pourrait raviver le « ras-le-bol fiscal » observé en 2018.
🛡️ Qui Protège les Français de la Folie Fiscale ? Un Contrôle Déficient
L’ouvrage s’interroge sur les garde-fous censés protéger les citoyens. Le Conseil constitutionnel, garant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (qui prône une répartition équitable de la contribution publique), semble trop complaisant envers Bercy. Par exemple, il a laissé passer une suppression partielle de la taxe d’habitation, suggérant une suppression totale « à terme » plutôt que de l’imposer immédiatement pour tous les contribuables.
La Direction de la Législation Fiscale (DLF) est pointée du doigt comme le véritable pilote de la fiscalité française. Elle serait responsable de l’élaboration des nouvelles mesures fiscales et de leur interprétation, et aurait ignoré la « courbe de Laffer » qui suggère qu’un taux d’imposition trop élevé peut réduire les recettes en décourageant l’activité et favorisant la fraude. Les ministres de Bercy sont devenus « maîtres » pour justifier les augmentations de recettes par un meilleur recouvrement, cachant la réalité d’une hausse globale des impôts.
Contrairement aux collectivités territoriales qui disposent d’organismes dédiés comme le Comité des Finances Locales (CFL) pour assurer la compensation de leurs charges, il n’existe aucun équivalent pour les ménages et les entreprises. La direction du Trésor ne produirait pas d’indicateurs transparents sur la compétitivité des entreprises ou le pouvoir d’achat des ménages, et s’appuierait sur un modèle macroéconomique « totalement dépassé ». Le bouclier fiscal existant est jugé insuffisant, ne protégeant que les payeurs de l’IFI (ancien ISF) et excluant la fiscalité locale et les contributions sociales.
📉 Le Fardeau Accablant des Ménages et des Entreprises
La pression fiscale en France ne cesse d’augmenter, pesant lourdement sur tous les acteurs économiques.
Pour les Ménages : Un Pouvoir d’Achat Rogné 💸
En 2021, les ménages français ont payé 681 milliards d’euros d’impôts, taxes et cotisations, soit 27,2 % du PIB et une augmentation de 54 milliards d’euros depuis 2017. Le gouvernement a communiqué sur une baisse « officielle » de 28 milliards d’euros, mais cette « baisse » est en réalité une « moindre hausse » calculée par rapport à une tendance de croissance, un « calcul tordu ». L’impôt sur le revenu est passé de 74 à 87 milliards d’euros, la CSG de 99 à 130 milliards, et la TVA de 162 à 204 milliards en 2022.
L’inflation aggrave la situation, car le barème de l’impôt sur le revenu n’est pas revu en temps réel, mais en fonction de l’inflation de l’année précédente. Cela a généré un surplus estimé à 1,6 milliard d’euros pour les ménages les plus aisés en 2021. La fiscalité directe est très inégalement répartie : la moitié est payée par les 10 % des ménages déclarant les plus hauts revenus, qui contribuent également à 70 % des recettes de l’impôt sur le revenu. Il est important de noter que l’on est considéré parmi les 10 % les plus « riches » à partir de 3 328 euros par mois.
Contrairement à l’Allemagne ou l’Italie, la France impose moins les bas salaires, ce qui signifie que seuls les 44 % de ménages imposables bénéficient des baisses d’impôts. L’étude dénonce un « puits sans fond » où une minorité finance les dépenses de la majorité, qui en demande toujours plus car elle ne paie pas.
Pour les Entreprises : Un Boulet Fiscal de 148 Milliards € 💼
Les entreprises françaises supportent un fardeau fiscal bien plus lourd que leurs homologues de la zone euro, estimé à 148 milliards d’euros de prélèvements obligatoires supplémentaires en 2021. C’est près de 6 points de PIB de plus que la moyenne de la zone euro (hors France). L’écart de compétitivité n’a « quasiment pas bougé » depuis 2017.
L’une des principales causes est le poids des cotisations sociales à la charge des employeurs, avec un écart de 84 milliards d’euros par rapport aux autres pays de la zone euro. En Allemagne, les cotisations sont proportionnelles et plafonnées, tandis qu’en France, les cotisations patronales peuvent passer de 12 % à 42 % du salaire brut. Le reste de l’écart provient des taxes sur la production, +49 milliards d’euros de plus qu’ailleurs, même après les baisses et suppressions annoncées. Ces taxes sont particulièrement insidieuses car elles pèsent sur les entreprises, qu’elles réalisent des profits ou non.
L’ouvrage bat en brèche certaines idées reçues : les aides aux entreprises françaises ne compensent pas cet écart (l’Allemagne aide presque autant, tout en imposant 145 milliards de moins par an). De même, le taux de prélèvements obligatoires est croissant avec la taille des entreprises, allant de 26 % pour les micro-entreprises à 31 % pour les grands groupes, contredisant l’idée que les « grosses échappent à l’impôt ».
🏡⛽🚬 Des Taxes Partout et Sur Tout, Vraiment ! L’Inventivité Fiscale Française
L’ingéniosité fiscale française ne connaît pas de limites, frappant chaque aspect de la vie quotidienne.
- La « taxe abris de jardin » (taxe d’aménagement) : Créée en 2012, elle taxe les abris de jardin, vérandas, garages, piscines, panneaux photovoltaïques… tout ce qui nécessite une autorisation d’urbanisme. Ses recettes ont atteint 1,9 milliard d’euros en 2021 et continuent d’augmenter (+8 % en 2023). L’administration utilise même l’intelligence artificielle pour traquer les piscines non déclarées.
- Les taxes environnementales : La France compte une quarantaine de « taxes vertes » pour 61 milliards d’euros de recettes en 2021, dont 40 milliards liés à l’automobile et aux carburants (TICPE). La fiscalité verte française (2,5 % du PIB en 2022) est l’une des plus élevées au monde, tandis que des pays comme la Suède et le Danemark la réduisent. L’ouvrage critique la politique énergétique française, qui, malgré un mix électrique fortement décarboné grâce au nucléaire (4,5 tonnes de CO2/habitant contre 6 tonnes en moyenne dans l’UE), pénalise cette énergie et se fixe des objectifs irréalistes en matière d’énergies renouvelables.
- Les impôts sur les successions : La France est le pays qui taxe le plus les donations et successions (0,7 % du PIB contre 0,2 % en Europe). Le taux peut atteindre 60 % entre non-parents, et la transmission d’une entreprise coûte en moyenne 10 à 17 % de sa valeur. Cette situation est critiquée comme « révoltante » et a conduit à une multiplication par cinq des recettes fiscales liées à la transmission du patrimoine depuis les années 1980. Les sondages montrent que plus de 80 % des Français considèrent ces droits comme « illégitimes ».
- L' »impôt papier » (les normes) : L’inflation normative est dénoncée comme un « mal français ». Le nombre de mots du droit consolidé a augmenté de 87 % en vingt ans (de 22,6 millions en 2002 à 42,45 millions en 2021), et le coût global des normes est estimé à au moins 100 milliards d’euros par an (80 milliards pour les entreprises, 20 milliards pour les collectivités et citoyens). Aucun chiffrage officiel n’existe sur ce coût.
- Les « taxes sur les taxes » : La France est un des rares pays où l’on taxe les taxes. La CSG non déductible, qui est intégrée au net imposable et soumise à l’impôt sur le revenu, coûte 3,5 milliards d’euros. La TVA est appliquée sur les impôts et taxes, notamment sur les produits énergétiques, ce qui représente 12,4 à 14,6 milliards d’euros. Un exemple frappant est la TVA sur la TICPE (taxe sur les carburants), où 14 centimes d’euro sur chaque litre d’essence sont de la TVA sur la TICPE. Ces « taxes sournoises » coûtent entre 16 et 18 milliards d’euros chaque année.
💸 Quand l’État Prive de Pouvoir d’Achat : Les Paradoxes Salariaux et Fiscaux
Le système fiscal français, avec ses prélèvements massifs, a un impact direct sur le pouvoir d’achat des citoyens.
Le Patron Paie 100, le Salarié Touche 47 💶
La France est pointée du doigt pour être le pays de l’OCDE où la part du salaire restant après prélèvements (charges salariales, employeur, CSG-CRDS et impôt sur le revenu) est la plus faible, en moyenne 47 % du salaire super-brut. Cela est dû aux charges patronales les plus importantes de l’OCDE (26,6 % des coûts de main-d’œuvre). Ces charges augmentent avec le montant des salaires, un système « diamétralement opposé » au modèle allemand où elles sont dégressives. Cette situation pénalise le développement des entreprises à haute valeur ajoutée et conduit à moins d’emplois qualifiés en France, contribuant au déclin de l’industrie manufacturière.
L’Iniquité Fiscale et la « Chasse aux Riches » 🎯
Le « jour de libération fiscale » (jour à partir duquel les contribuables commencent à gagner de l’argent pour eux-mêmes) est tombé le 9 août en 2022, contre le 19 juillet en 2019. Mais ce jour varie fortement selon le profil du contribuable, de février à août, illustrant la forte progressivité de l’impôt et une « iniquité française ». Les agents publics, par exemple, bénéficient d’une pression fiscale bien moins lourde que les salariés du privé pour des rémunérations équivalentes.
L’ouvrage dénonce une « haine des riches » profondément ancrée en France et « financée par nos deniers publics », citant Oxfam qui a reçu plus d’un million d’euros de subventions publiques pour publier des rapports critiquant les hauts revenus. Pourtant, la taxation du capital en France (10,7 % du PIB) reste 2,5 points au-dessus de la moyenne de la zone euro. De nombreux pays ont supprimé l’équivalent de l’IFI (ancien ISF) sans voir leur chômage augmenter, et souvent avec une plus grande richesse par habitant. L’ouvrage souligne que les « riches » (à partir de 3 328 euros/mois pour les 10 % les plus aisés) sont une catégorie diverse qui inclut des entrepreneurs, professeurs, scientifiques et même de hauts fonctionnaires. Les non-résidents fiscaux sont également « rackettés », avec des taux de CSG-CRDS plus élevés pour ceux hors UE, tout en ayant moins de droits à la sécurité sociale française que les étrangers en situation illégale.
🏛️ Le Scandale des Dépenses Publiques et des Services à l’Agonie
La deuxième partie de l’ouvrage met en lumière les gaspillages massifs et l’inefficacité criante des services publics, malgré des dépenses toujours plus élevées. L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, stipulant que « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration », est largement ignoré.
📈 Des Dépenses Publiques Hors de Contrôle et Non Contrôlées
Les dépenses publiques ont dérapé de 43 milliards d’euros par an en moyenne entre 2017 et 2022, avec un record de 82 milliards en 2022, soit 1,6 milliard par semaine de dépenses supplémentaires non planifiées et financées par la dette. La « politique du chéquier » (chèques bois, carburant, énergie, rentrée scolaire, etc.) est devenue monnaie courante depuis le Covid. Le FMI a d’ailleurs alerté la France sur le danger du « quoi qu’il en coûte » et la nécessité de « clarifier qui s’occupe de quoi » pour limiter la « duplication des dépenses ».
Le contrôle de ces 1 500 milliards d’euros de dépenses est jugé inexistant. La Cour des comptes est critiquée pour ne contrôler que la légalité des dépenses, et non leur efficience ou la réalisation d’économies. Contrairement au National Audit Office (NAO) britannique qui travaille directement avec le Parlement et mesure les économies réalisées (9 milliards d’euros depuis 2010), le Parlement français n’exploite que très rarement les observations de la Cour. La Cour des comptes elle-même est jugée opaque et réticente à un véritable contrôle, allant jusqu’à s’opposer à la création d’un organe d’audit parlementaire. L’ouvrage suggère même une certaine « complicité » de la Cour dans cette situation.
💰 L’Assistanat et les Retraites Publiques, des Abus Coûteux
Le système d’aides sociales et de retraites est également source de critiques majeures.
Le Scandale des Aides Sociales qui Alimentent l’Assistanat 🔄
La France est décrite comme le « paradis des aides sociales », avec plus de soixante dispositifs représentant un total de plus de 125 milliards d’euros par an. Ce foisonnement, incluant les APL (17 milliards), le RSA (11 milliards), l’AAH (10 milliards) et la prime d’activité (9 milliards), est dénoncé comme « désincitatif au travail ». Un couple handicapé témoigne ainsi que ses amis, en déclarant être parents isolés et en cumulant les aides, peuvent toucher 4 500 euros par mois non imposables, autant que le couple qui travaille.
Un sondage exclusif des Échos de 2022 a révélé que 65 % des Français estiment qu’il y a trop d’assistanat et que le modèle social n’encourage pas les efforts. L’ouvrage déplore que le « devoir de retourner au travail » soit oublié face aux aides, et qu’une partie des allocataires « optimise les aides sociales comme si cela était un dû ». Le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA est très faible (3,9 % par mois), et 42 % y sont encore sept ans après leur entrée. Le nombre de bénéficiaires de l’AAH a doublé depuis les années 1990, et la moitié ne travaillent pas sans obligation de s’inscrire à Pôle emploi. L’ouvrage propose des mesures inspirées de l’Europe, comme la mise en place d’heures de travail en contrepartie du RSA, des sanctions progressives et un plafonnement du cumul des aides sociales au niveau du SMIC mensuel.
Le Scandale des Retraites des Agents Publics : Un Financement par l’Impôt 👴👵
Les retraites sont loin d’être équitables entre le public et le privé. Le calcul de la pension sur les six derniers mois (fonctionnaires) contre les vingt-cinq meilleures années (privé) est un avantage majeur, sans compter les primes des agents qui ne sont pas soumises à cotisations et donc exclues du calcul. 45 milliards d’euros de « cotisations employeur » de l’État sont en réalité des subventions financées par les impôts des Français. Chaque ménage imposable paierait ainsi 200 euros par mois pour financer des pensions publiques qui seraient en moyenne 21 % plus basses si les règles du privé étaient appliquées.
Les réformes des retraites n’abordent jamais ce mode de calcul plus généreux. La réforme Touraine, axée sur l’allongement de la durée de cotisation, a favorisé les agents publics ayant des carrières plus complètes et bénéficiant de « bonifications » ou de « trimestres offerts ». L’opacité des données, due à l’absence de caisse de pension des agents de l’État, rend difficile la connaissance du détail des dépenses. Le déficit réel du système de retraite, si l’on réintégrait les régimes publics, serait de 43 milliards d’euros en 2020, dont les deux tiers imputables aux fonctionnaires. Des « similicotisations » comme la CET et la CEG dans le privé servent également à équilibrer les comptes sans ouvrir de droits à pension. Les régimes spéciaux, comme celui de l’Assemblée nationale, sont également pointés du doigt pour leurs avantages dérogatoires au droit commun, comme la retraite avec jouissance immédiate après quinze ans de service.
💣 La Dette Explose et l’Avenir Compromis : Un Système Dangereusement Fragile
La dette publique française est une bombe à retardement.
Une Charge de la Dette qui Atteint des Sommets 📉
La « charge de la dette » a dépassé les 50 milliards d’euros en 2022, et pourrait atteindre plus de 100 milliards à l’horizon 2027 si les taux d’emprunt dépassent 4 %. Ce risque est aggravé par le fait que 11 % de la dette est indexée sur l’inflation, chaque point d’inflation coûtant 2 milliards d’euros supplémentaires par an aux finances publiques. Dans un scénario catastrophe, la charge de la dette pourrait représenter plus de 5 % du PIB en 2027, menaçant le déficit public de devenir « totalement hors de contrôle ». Cela pourrait entraîner des « ponctions sur l’épargne des Français », le « blocage des assurances-vie », des impôts exceptionnels et, dans le pire des cas, une « tutelle financière de la Commission européenne ou de la BCE ».
Le Sous-investissement Public dans l’Avenir 🏗️
Malgré être le pays de l’UE qui dépense le plus, la France est quinzième sur vingt-neuf en matière d’investissements, consacrant seulement 3,6 % du PIB à l’investissement en 2021. Cela est dû au fait que la dette publique finance principalement des « déficits d’exploitation » plutôt que des investissements futurs. L’enseignement (10 % des investissements, 22e rang européen) et la santé (10 %, 11e rang) sont sous-investis par rapport à d’autres pays. Les investissements militaires ont également été sous-exécutés de 54 milliards d’euros entre 2009 et 2020, les coupes budgétaires touchant le « régalien ». Les pays qui cumulent un fort investissement public et une dépense publique modérée connaissent une forte croissance du PIB, ce qui n’est pas le cas de la France (19e et 20e places sur 23 pays).
Le Scandale des Milliards Gâchés du Nucléaire ⚛️
L’ouvrage dénonce un « gâchis » national concernant l’énergie nucléaire. Des décisions politiques « délétères » ont conduit à la fermeture de plus de 14 gigawatts électriques de capacités nucléaires et thermiques depuis 2010, sans compensation adéquate. La maintenance du parc nucléaire a été quasi stoppée pendant le premier confinement de 2020, menant à l’arrêt de la moitié des réacteurs fin 2022. La fermeture de la centrale de Fessenheim en 2020 est citée comme emblématique de cette « décision historique » mais dommageable.
La France, autrefois gros exportateur, est devenue importatrice d’électricité, avec un impact négatif sur la balance commerciale et l’écologie (électricité importée souvent produite à partir de gaz, charbon). Le développement massif de l’éolien est jugé insuffisant pour compenser, et la construction de six nouveaux réacteurs (47 à 57 milliards d’euros) prendra des années (opérationnels en 2035). En attendant, la France a dû rationner les entreprises et réduire la consommation industrielle de 18 % pendant l’hiver 2022-2023 pour éviter les coupures, creusant le déficit commercial. L’ouvrage conclut que ce sont des « politiques qui, pour des alliances électoralistes, ont oublié que France rime aussi avec nucléaire ».
🚨 Des Services Publics en Détérioration : Moins de Qualité, Plus de Coûts
La dégradation des services publics est un fil rouge de l’ouvrage, démontrant que « plus on paie, et moins ça marche ».
Congés Bonifiés, RATP/SNCF, Personnel Public : Des Avantages Coûteux ✈️🚆
- Les congés bonifiés des agents publics : Ces avantages, dont le coût est « savamment caché » et contesté (entre 75 millions et 600 millions d’euros par an selon les rapports), permettent aux fonctionnaires originaires d’Outre-mer de bénéficier de séjours prolongés avec majoration de salaire (jusqu’à 94 % en Nouvelle-Calédonie) et billets d’avion payés pour la famille. Une réforme de 2020, censée réduire les coûts, pourrait en réalité augmenter le nombre de voyages bonifiés sur une carrière.
- La RATP et la SNCF : Ces entreprises 100 % publiques sont critiquées pour la « gréviculture » qui perturbe les voyageurs, avec 39 % des journées de travail perdues pour grève en 2019. Le « service minimum » est un leurre. Malgré des augmentations de salaire supérieures à l’inflation, les agents défendent leurs régimes spéciaux de retraite, qui ne disparaîtront pas avant 2066 pour les agents actuels. Ces régimes sont massivement subventionnés par l’État (3,3 milliards pour la SNCF, 737 millions pour la RATP en 2022) et offrent des pensions très avantageuses. La ponctualité des trains s’est dégradée, et l’absentéisme est élevé à la RATP, nécessitant même une « prime de présentéisme ».
- Le personnel public : La France dépense 300 milliards d’euros par an pour son personnel public, soit 35 à 40 milliards de plus que le reste de l’Europe. Elle compte 5,6 millions d’agents publics (un emploi sur cinq), avec un taux d’administration de 91,1 agents pour 1000 habitants, contre 60 pour l’Allemagne. L’ouvrage estime à 1 million le nombre de postes en trop dans la fonction publique, soit 40 milliards d’euros de surcoût annuel pour des « fonctions inutiles, des mises au placard, voire des emplois semi-fictifs et des doublons ». Le passage aux 35 heures et les départs à la retraite anticipés (700 000 agents en « catégories actives » peuvent partir entre 55 et 57 ans) contribuent également à ce surcoût. L’absentéisme est « monstrueux » (8 à 10 milliards d’euros par an, équivalent au privé pour 20 % des actifs).
- La « fausse suppression de l’ENA » : L’ENA a été remplacée par l’Institut National du Service Public (INSP) en 2022, mais cette « suppression » est un « maquillage ». Le budget de la nouvelle école a augmenté de 21 %, passant de 31 à 38 millions d’euros en subvention de l’État, avec 454 agents pour le même nombre d’élèves (environ 180). Les promesses de réforme (fusion des corps d’inspection, nominations temporaires, fin du « pantouflage » – la possibilité de travailler dans le privé ou en politique tout en conservant son statut de haut fonctionnaire) sont passées à la trappe. Le système continue, mais « ça coûtera plus cher ».
Des Services Essentiels en Déroute : Justice, Logement, Crèches, Emploi, Santé, Éducation 🤯
- Les files d’attente pour les passeports : La durée minimale pour renouveler un passeport est de trois mois. Les délais s’allongent à cause d’une réorganisation de 2017 (moins de mairies équipées), d’une mauvaise allocation des dispositifs de recueil d’empreintes, de réductions d’effectifs dans les préfectures et de problèmes de production de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS).
- Les délais de la justice : Il faut 637 jours pour obtenir un jugement en première instance en France, contre 237 jours en moyenne dans les pays du Conseil de l’Europe. La justice française est sous-financée (0,21 % du PIB contre 0,35 % en Allemagne) et manque de juges et de personnel non-juge. Les réformes incessantes et mal préparées aggravent la situation. Malgré des augmentations budgétaires, le stock d’affaires non traitées est tel que les tribunaux restent engorgés, et 59 % des peines de prison ne sont pas exécutées.
- L’attribution des HLM : La France dépense 15 milliards d’euros par an pour le logement social, qui bénéficie à 10 millions de personnes. Cependant, plus de la moitié des occupants sont inactifs. Les agents publics bénéficient de quotas, et les préfets ont un droit de réservation de 30 % des logements pour les personnes prioritaires, souvent non issues de la commune et/ou inactives. Les locataires restent longtemps dans leur logement (33 % depuis au moins quinze ans), créant un « droit au HLM à vie » qui est jugé antisocial. La fraude (sous-location illégale) et l’opacité des attributions sont également dénoncées.
- La pénurie de places en crèches : Malgré des dépenses de 15 milliards d’euros par an, la France fait face à une pénurie de places en crèches (10 000 places existantes mais non ouvertes faute de personnel). Les exigences de qualification pour le personnel sont parmi les plus strictes d’Europe, et il n’existe pas de formations courtes pour passer d’une catégorie à l’autre. Les parents qui travaillent ne sont pas prioritaires pour l’attribution des places, car 10 % sont réservées aux parents bénéficiaires de minima sociaux ou en situation de monoparentalité.
- L’accompagnement fantôme par Pôle emploi : Seulement 70 % des appels à Pôle emploi trouvent un agent, et seulement 6 appels sur 410 ont permis une estimation de l’allocation. Malgré une augmentation de 21 % des effectifs entre 2009 et 2021, l’efficacité est jugée faible, avec une durée annuelle de travail inférieure à la durée légale et un fort absentéisme. La fraude détectée est faible (0,6 % des allocations), et le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA est très limité (3,9 % par mois). L’Insee a même confirmé en 2017 que Pôle emploi n’a aidé que 9 % des demandeurs d’emploi à retrouver un travail, le plaçant au même niveau que les petites annonces.
- L’effondrement caché du système de santé : La France est le 4e pays au monde en dépenses de santé (11,3 % du PIB), mais elle a chuté de la 7e à la 20e place dans le classement du Legatum Institute en onze ans. Seuls 71 % des Français sont satisfaits de l’accès à des services de santé de qualité, un taux inférieur à la moyenne européenne. L’ouvrage révèle que 34 % du personnel hospitalier (405 600 personnes) est dédié à des tâches administratives, soit 54 % de plus qu’en Allemagne. L’absentéisme est élevé, et la « gestion kafkaïenne » fait fuir médecins et infirmiers vers le privé ou l’étranger. 30 % des actes médicaux seraient inutiles, et des fraudes sont récurrentes.
- Le délitement de l’Éducation nationale : Avec 102 milliards d’euros dépensés en 2020 (14 milliards de plus que la moyenne de la zone euro), l’Éducation nationale est en crise. La satisfaction des Français est de 71 %, bien en deçà de la moyenne européenne (89 %). Plus de 4 000 postes n’ont pas été pourvus par des titulaires à la rentrée 2022 faute de candidats. Malgré un nombre d’enseignants suffisant, 12 % des effectifs titularisés ne sont pas devant une classe. Les écoles publiques sont critiquées pour leurs performances inférieures aux écoles privées, qui dépensent 30 % de moins par élève pour de meilleurs résultats. Le ministère est accusé de masquer les difficultés et de « contraindre » les établissements privés.
💡 Des Solutions Inspirées d’Ailleurs pour Redresser la France
La situation n’est « pas inéluctable ». L’ouvrage propose vingt mesures concrètes inspirées des meilleures pratiques européennes et internationales pour rétablir une gestion publique saine et transparente.
✅ L’Exemple de la Banque de France : Moins de Dépenses, Plus de Qualité
La Banque de France est citée comme un exemple inspirant de transformation réussie. Grâce à son plan « Ambitions 2020 », elle a réussi à réduire ses dépenses de 18 % depuis 2015, et ses effectifs de près de 25 % (passant de 12 269 à 9 290 équivalents temps plein). Cette réduction a été obtenue sans sacrifier la qualité des services, la satisfaction des usagers ayant même augmenté (87 % en 2021), tout comme la confiance des agents (60 % en 2020). Elle a également investi dans la modernisation et la digitalisation de ses processus. L’ouvrage estime que si l’État français s’inspirait de ce modèle, un objectif de baisse de 5 % des dépenses tout en renforçant le régalien pourrait générer plus de 57 milliards d’euros d’économies par an.
🌍 Vingt Mesures pour une Meilleure Gestion Publique, Inspirées de Nos Voisins
Voici quelques-unes des propositions concrètes pour réformer la France:
- Inscrire le principe du frein à l’endettement dans la Constitution : Comme en Allemagne, pour limiter l’endettement fédéral et des États fédérés, garantissant un équilibre budgétaire.
- Interdire d’indexer la dette sur l’inflation : Une pratique adoptée par les Pays-Bas, le Luxembourg ou l’Autriche pour éviter d’alourdir la charge de la dette en période d’inflation.
- Publier mensuellement la nationalité des détenteurs de la dette publique : À l’image des États-Unis, pour une transparence totale sur qui finance l’État.
- Assurer des comptes sociaux sans déficit : Comme en Allemagne, où l’assurance maladie doit respecter l’équilibre budgétaire dans un cadre d’auto-administration.
- Garantir le système de retraites avec des mécanismes d’ajustement automatique : La Finlande ajuste l’âge de la retraite et le montant des pensions en fonction de l’espérance de vie et des cotisations.
- Renforcer le Parlement comme un vrai contre-pouvoir : À la manière du Royaume-Uni (National Audit Office) et du Canada, où les ministres sont redevables devant le Parlement sur la gestion des deniers publics.
- Rendre chaque ministre responsable de son budget : Comme en Suède, où chaque ministre conçoit et gère son budget selon une trajectoire globale fixée.
- Engager la responsabilité financière des élus : En Italie, les décideurs publics sont responsables des fautes, omissions ou négligences ayant causé un dommage financier, avec des sanctions sous forme de dommages et intérêts.
- Des données sociales transparentes : Le Portugal et le Royaume-Uni mettent à disposition du public des plateformes d’Open Data sur la santé et la sécurité sociale.
- Des collectivités et agences publiques transparentes avec des comptes uniformisés : L’Italie dispose d’une comptabilité analytique harmonisée pour ses collectivités, et le Royaume-Uni exige des rapports annuels consolidés pour ses agences.
- Établir un bouclier fiscal et social : Le Danemark limite le taux marginal cumulé d’imposition globale à 59 %.
- Respecter le principe de subsidiarité et limiter les compétences partagées : L’Espagne a clarifié les niveaux de responsabilité des politiques publiques pour limiter les cofinancements et les doublons.
- Des syndicats transparents qui publient leurs comptes : Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les syndicats sont tenus de publier des rapports d’activité et des comptes consolidés.
- Encadrer le droit de grève pour garantir la continuité du service public : L’Italie interdit les grèves à durée illimitée dans les services essentiels et impose un service minimum strict pendant les heures de pointe et les périodes de vacances.
- Verser des primes aux agents publics pour leur performance et leur présence : Le Danemark octroie des primes à la performance (jusqu’à 20 % du salaire) aux agents publics sous statut de droit privé.
- Évaluer la charge administrative et contrôler les normes : La Belgique et l’Allemagne évaluent et allègent le poids des normes pour les entreprises et les citoyens, avec des mécanismes comme « une charge nouvelle, une charge en moins ».
- Faire voter les citoyens régulièrement sur les enjeux publics : La Suisse consulte ses citoyens plusieurs fois par an via des initiatives populaires et des référendums.
- Mettre les citoyens à contribution : La Norvège applique une franchise annuelle pour le patient dans son système de sécurité sociale.
- Autoriser des classements officiels sur la qualité des services publics : Comme en Suisse, qui propose des classements d’hôpitaux basés sur des données officielles pour informer les patients.
Conclusion : L’Urgence d’une France Transparente et Responsable 📣
L’ouvrage dépeint une France où l’État est « détraqué », « tout dysfonctionne », et « plus rien ne marche ». L’opacité sur les coûts et les résultats des services publics est devenue la norme, favorisant le « piston, le copinage et les combines coupe-file ». Malgré l’augmentation des dépenses, les services publics se dégradent, et les Français, loin d’être dupes, ont une opinion de plus en plus négative de leur qualité.
La situation est grave : la France est « mal gérée » et son argent « mal utilisé ». Les milliards injectés ne produisent pas les résultats escomptés, de l’hôpital à l’école, en passant par la justice et les transports. Les auteurs concluent que nous vivons dans l' »illusion de la gratuité, dans l’illusion de la qualité, dans l’illusion de l’équilibre des pouvoirs ».
Il est urgent d’exiger des comptes sur l’utilisation de nos impôts et de notre argent public, comme le prévoit la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les solutions existent, prouvées et appliquées dans d’autres démocraties. Des garde-fous systématiques sont indispensables pour que la France renoue avec une bonne gestion publique, transparente et au service de ses citoyens. Sans cela, c’est le FMI et d’autres instances internationales qui pourraient, à terme, imposer des réformes que nous n’aurions pas choisies. Il est temps de se réveiller et d’agir.