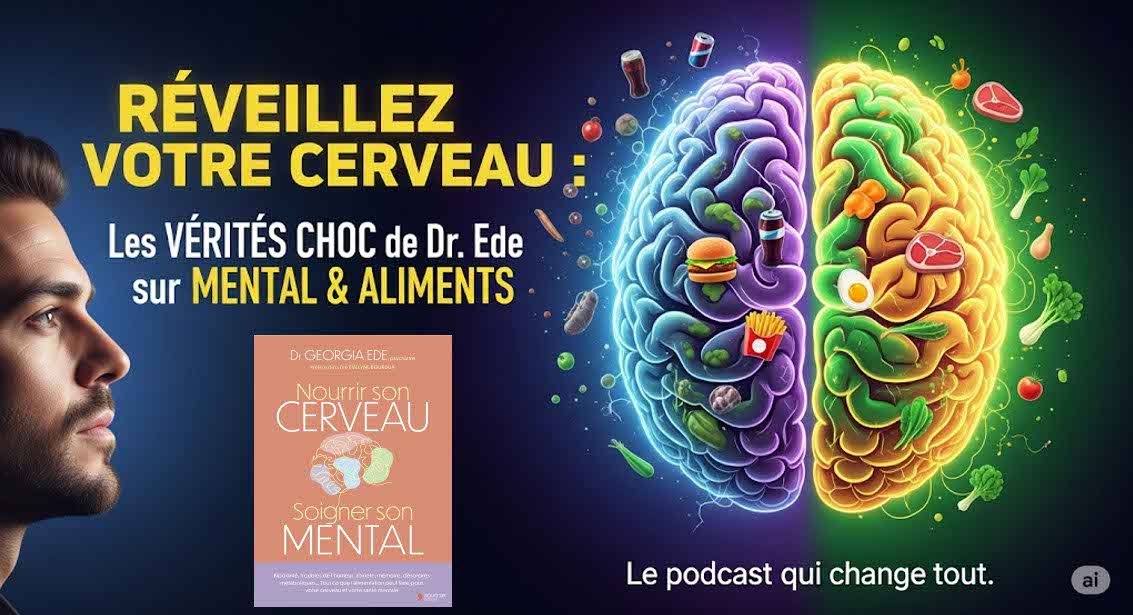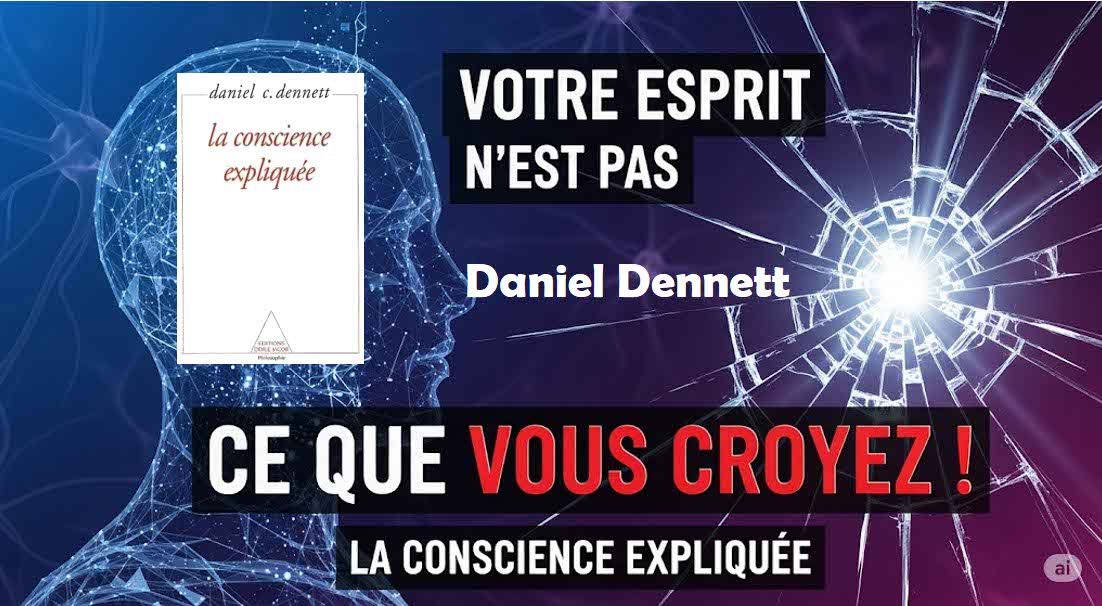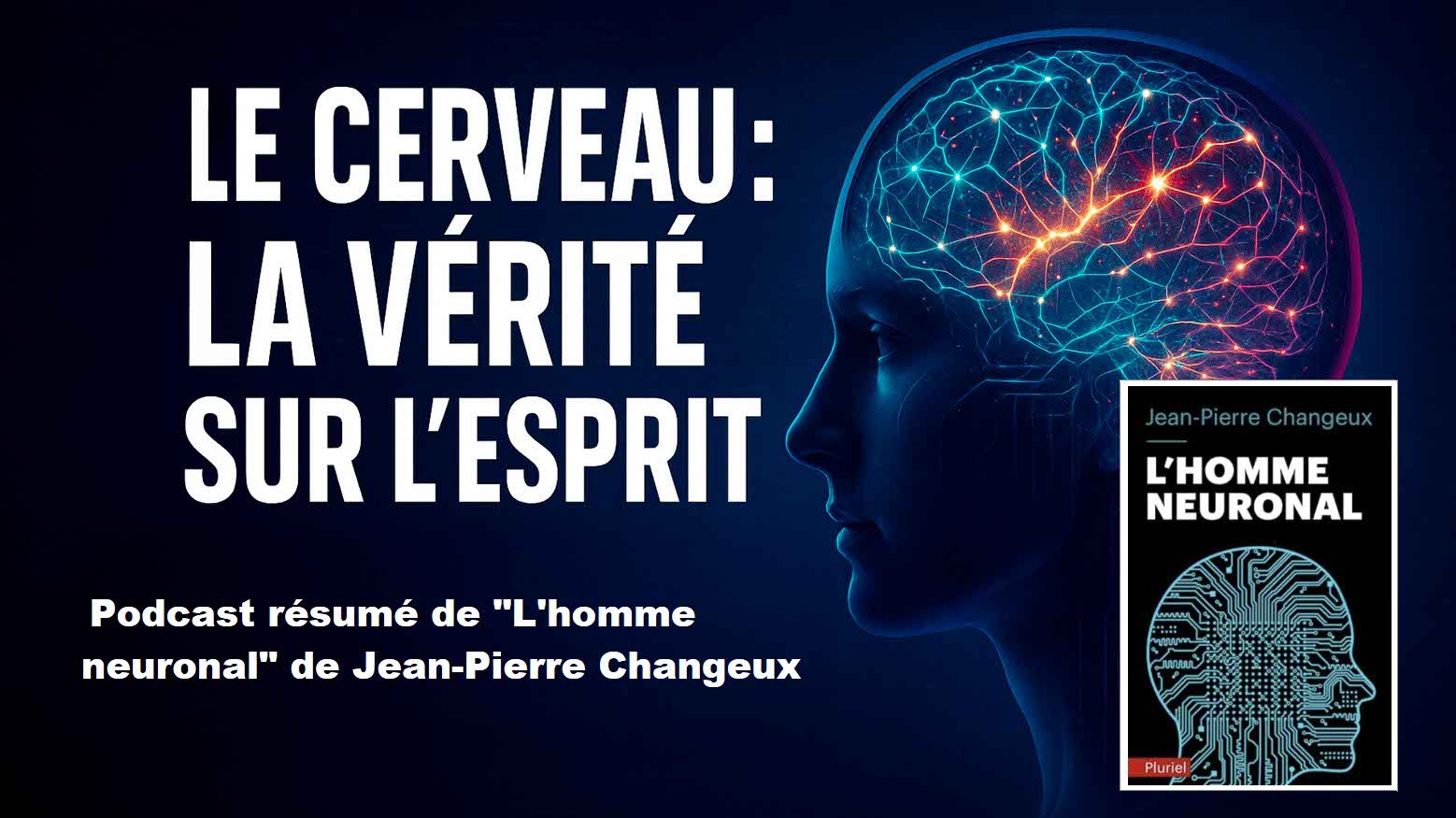Les liens pour vous procurer les différentes versions
📗Lien vers le livre papier poche : https://amzn.to/44Od43a
Georges Canguilhem : Plongée au Cœur de « La Connaissance de la Vie » 📖
Dans un monde où les découvertes scientifiques transforment notre quotidien, mais où leur profondeur et leur signification restent souvent ignorées du grand public, l’œuvre de Georges Canguilhem, La Connaissance de la Vie, se présente comme une contribution essentielle. Publié en 1952 dans la collection « Science et Pensée » dirigée par Ferdinand Alquié, cet ouvrage est bien plus qu’une simple compilation d’articles et de conférences. C’est une prise de conscience du Savoir humain, une quête incessante pour élever l’homme à la hauteur de son propre esprit, en explorant les fondements philosophiques et épistémologiques de la biologie.
Canguilhem nous invite à une réflexion profonde sur la nature de la connaissance biologique, ses méthodes, ses limites et ses implications, en s’appuyant sur une analyse historique rigoureuse des concepts fondamentaux. Il défend une indépendance des thèmes philosophiques face à l’élucidation de la science, tout en cherchant à favoriser une compréhension plus large de ce qui donne son visage à notre monde contemporain. Cet article internet se propose de vous guider à travers les idées maîtresses de cet ouvrage, en décryptant ses critiques, ses propositions et sa vision unique de la vie et de la connaissance.
Contexte et Vision de la Collection « Science et Pensée » 💡
La collection « Science et Pensée », sous la direction de M. Ferdinand Alquié, a pour objectif de rendre les méthodes et les résultats de la science contemporaine accessibles à un public non spécialisé. Alquié souligne un paradoxe moderne : nos vies dépendent des découvertes scientifiques, mais nous en ignorons souvent les voies, le contenu et le sens. Cela conduit à des sentiments allant de la peur panique à l’admiration religieuse envers la science. La collection cherche ainsi à favoriser la prise de conscience de ce Savoir qui façonne notre monde.
La Connaissance de la Vie de Georges Canguilhem, Inspecteur général de l’Instruction Publique, s’inscrit parfaitement dans cette ambition. L’ouvrage rassemble plusieurs textes de dates différentes, mais dont l’inspiration est continue, assurant une certaine unité et originalité à l’ensemble. Parmi les autres titres de la collection, on trouve des sujets variés comme « Humanisme et Surhumanisme », « L’Homme et la Bombe », « L’Amour et les Mythes du Cœur », « Le Principe Vital », ou encore « La Structure des Choses », témoignant d’une volonté d’aborder la science dans ses dimensions les plus larges, y compris ses liens avec la pensée humaine et la société.
L’Expérimentation en Biologie Animale : Au-Delà de la Simple Observation 🔬
Canguilhem débute son exploration de la méthode biologique par une critique approfondie de l’expérimentation, en prenant comme point de départ l’œuvre classique de Claude Bernard, l’Introduction à l’Étude de la Médecine expérimentale.
Une Critique de la Méthode Expérimentale Traditionnelle
Canguilhem reproche à une certaine pratique scolaire de réduire l’Introduction de Claude Bernard à une somme de généralités ou de banalités applicables indistinctement aux sciences physico-chimiques et biologiques, alors que ses deuxième et troisième parties contiennent spécifiquement la charte de l’expérimentation en biologie. L’auteur estime que l’on altère involontairement le sens et la valeur de l’expérimentation biologique, une entreprise pleine de risques et de périls, en n’utilisant que des exemples de portée didactique.
Pour illustrer son propos, il prend l’exemple de la contraction musculaire. L’expérience scolaire montrant qu’un muscle se contracte sans variation de volume n’a aucun sens biologique en soi. Son sens n’apparaît qu’en remontant à Swammerdam (1637-1680), qui cherchait à établir ce fait contre les théories alors en vigueur sur la contraction musculaire, qui supposaient une structure tubulaire du nerf acheminant un fluide au muscle. De même, la ligature d’un nerf, une expérience remontant à Galien (131-200), prend sens lorsqu’on la réinsère dans l’histoire de la pensée, révélant qu’elle était liée à une théorie psychologique ou métaphysique sur le commandement des mouvements.
Les Spécificités de l’Expérimentation Biologique
Canguilhem met en lumière quatre difficultés majeures et originales de l’expérimentation en biologie, qui la distinguent des sciences de la matière :
- Spécificité : Contrairement à l’idée de généralisation universelle, la généralisation logique en biologie est imprévisiblement limitée par la spécificité de l’objet. Le choix de l’animal d’étude est crucial (chien pour réflexes conditionnés, pigeon pour équilibration, drosophile pour hérédité, etc.). Les acquisitions expérimentales ne peuvent être généralisées sans réserves expresses, que ce soit d’une variété à l’autre au sein d’une espèce, d’une espèce à l’autre, ou de l’animal à l’homme. Des exemples frappants sont donnés avec la caféine sur les grenouilles vertes et rousses, les lois de Pflüger sur les réflexes selon le mode de locomotion de l’animal, et la réparation des fractures osseuses chez le chien versus l’homme.
- Individuation : La principale difficulté réside dans la recherche d’individus capables de soutenir des épreuves de comparaison. Assurer l’identité de deux organismes individuels est complexe, car leur naissance (sexualité, fécondation) leur confère une combinaison unique de caractères héréditaires. La production d’organismes de lignée pure (homozygotes intégraux) est artificielle, un « artefact » humain.
- Totalité : Un organisme est un tout intégré, et toute tentative de prélèvement l’altère en tant que tel. L’ablation d’un organe ne conduit pas à un organisme diminué, mais à un tout autre organisme. Les organes sont souvent polyvalents, et tous les phénomènes sont intégrés. Des exemples comme l’animal spinal (section de la moelle épinière) ou la polyvalence endocrinienne chez l’oiseau illustrent comment l’organisme réagit comme un système complexe, où les parties sont interconnectées de manière inattendue.
- Irréversibilité : L’organisme évolue irréversiblement au cours de sa vie, et ses composants séparés peuvent révéler des potentialités qui ne se manifestent pas dans les conditions normales. L’étude du développement de l’œuf (oursin) montre des stades d’indétermination, détermination et différenciation, où l’amputation à un stade précoce peut être compensée, mais pas à des stades ultérieurs. L’organisme adulte présente également une irréversibilité fonctionnelle, rendant difficile la comparaison de lui-même à différents moments. Pasteur (découverte de l’immunité) et Portier et Richet (anaphylaxie) sont cités comme des exemples de découvertes résultant d’erreurs techniques initiales ou d’inadvertances, prouvant que la vie est « une route qui marche elle-même ».
Vers des Techniques Spécifiquement Biologiques
Face à ces difficultés, Canguilhem affirme que la biologie ne peut se contenter de copier les principes et pratiques de la physique ou de la chimie. Le biologiste doit inventer sa propre technique expérimentale. Il doit reconnaître l’originalité de la vie. La pensée du vivant doit tirer du vivant l’idée du vivant. Goldstein soutient que la « connaissance naïve » (celle qui accepte simplement le donné) est le fondement principal de la connaissance véritable en biologie.
Les techniques expérimentales proprement biologiques sont générales et indirectes (modification du milieu) ou spéciales et directes (action sur un embryon). Les transplantations ou explantations de tissus visent à modifier les relations topographiques ou à libérer l’organe des stimulations du milieu intérieur normal, permettant de dissocier des déterminismes globaux. L’exemple de la castration physiologique par transplantation ovarienne illustre comment on peut rompre un cercle d’action-réaction pour dissocier des images morphologiques normales.
Cependant, Canguilhem soulève une question essentielle : dans quelle mesure les procédés expérimentaux (artificiels) permettent-ils de conclure que les phénomènes naturels sont adéquatement représentés par les phénomènes ainsi rendus sensibles ?. L’observation, étant une action, peut troubler le phénomène à observer.
L’Expérimentation sur l’Homme : Un Défi Éthique et Philosophique ⚖️
La question de l’expérimentation directe sur l’homme est inévitable. Il serait pertinent d’expérimenter sur l’homme pour éviter l’écueil des extrapolations animales. Cependant, des normes éthiques (que certains appellent préjugés, d’autres impératifs) viennent heurter ce type d’expérimentation. Le problème se complique par la difficulté de distinguer l’expérimentation à intention strictement théorique de l’intervention thérapeutique ou de la prévention hygiénique/pénale (lobotomie, stérilisation).
Claude Bernard considère les tentatives thérapeutiques et les interventions chirurgicales comme des expérimentations sur l’homme, les jugeant légitimes tant qu’elles ne causent pas de mal. Canguilhem conteste ce critère, car la définition du « bien » peut être subjective et servir à justifier des maux (rappel des exemples historiques récents).
Il est crucial de conserver à la définition de l’expérimentation son caractère de question posée sans préméditation de service immédiat. Une intervention chirurgicale n’est pas une expérimentation si elle n’obéit pas aux règles d’une opération « à froid sur un matériel indifférent ». L’acte médico-chirurgical est aussi un acte humain, face à une détresse à secourir. Seul l’opérateur sait à quel moment l’intention change, comme dans l’exemple de Dandy sectionnant la tige hypophysaire.
Le consentement du patient, souvent invoqué comme critère de légitimité, est également problématique, surtout pour les individus « en marge ». Des exemples de médecins, chercheurs et infirmiers se prêtant volontairement à des expériences sont cités. L’histoire montre aussi l’antiquité de la vivisection humaine, avec Hérofile et Érasistrate pratiquant sur des condamnés à mort. La connaissance des premiers stades de l’œuf humain a bénéficié d’observations faites dans des conditions expérimentales où des gynécologues invitaient des femmes à avoir des rapports sexuels à des dates précises avant une chirurgie, permettant d’examiner des œufs fécondés.
Canguilhem conclut que le problème de l’expérimentation sur l’homme n’est pas seulement technique, mais de valeur. La biologie humaine ne contient pas en elle-même la réponse aux questions relatives à sa nature et à sa signification.
La Théorie Cellulaire : Une Histoire Conceptuelle 🧬
La théorie cellulaire, qui postule que tout organisme vivant est composé de cellules et que toute cellule dérive d’une cellule préexistante, est un pilier de la biologie moderne. Cependant, Canguilhem s’interroge sur son caractère, remettant en question si elle est purement rationnelle ou expérimentale, et explorant son histoire conceptuelle.
Au-Delà de l’Observation : Le Rôle des Idées
Canguilhem souligne que l’honneur accordé à Hooke pour la découverte de la cellule est excessif. Bien que Hooke ait observé la structure cloisonnée du liège et inventé le mot « cellule » (en référence aux rayons de miel et aux petites chambres), sa découverte n’a pas amorcé de mouvement immédiat, et le mot lui-même s’est perdu pour un siècle.
La notion de cellule est surdéterminée affectivement et socialement. L’image de la ruche et des abeilles (le travail coopératif) plane sur son développement. La cellule est à la fois une notion anatomique et fonctionnelle, un matériau élémentaire et un travail individuel subordonné. L’œil armé du microscope voit les êtres composés de cellules, mais l’affirmation que la cellule est le seul composant des êtres vivants et que toute cellule provient d’une cellule préexistante ne vient pas du microscope seul. L’idée préexiste souvent à la vérification.
Les Précurseurs et leurs Visions
Canguilhem retrace la généalogie du concept de cellule à travers des figures et des idées antérieures :
- Linné : Souvent présenté comme le père du fixisme, Linné a pourtant lui-même apporté des corrections à sa conception initiale, notamment face aux « variétés monstrueuses ». Son œuvre permettait de tirer le fixisme, mais aussi « autre chose ». Il cherchait l’unité du plan de composition des espèces, pas un élément plastique commun à tous les vivants.
- Haller : Il voit l’élément vivant dans la fibre (« théorie fibrillaire »). La fibre est pour le physiologiste ce que la ligne est pour le géomètre. C’est une conception systématique où la raison perçoit la fibre comme élément primordial.
- Buffon : Propose la théorie des « molécules organiques« . Pour lui, animaux et plantes sont composés de corps organiques similaires, dont les parties primitives sont perçues par le raisonnement. La vie est dans ces molécules élémentaires, dont l’assemblage et la disjonction expliquent la génération et la destruction. Buffon s’inspire de Maupertuis et de la mécanique newtonienne, expliquant l’agrégation des molécules par attraction. Le concept de « moule intérieur » assure la persistance des formes malgré le renouvellement des atomes vitaux, servant d’intermédiaire logique entre la cause formelle aristotélicienne et l’idée directrice de Claude Bernard. Buffon voyait l’organisme comme un « assemblage physique » plutôt qu’une société concertée, comparant la société des abeilles à un mécanisme cartésien.
- Oken : Appartenant à l’école romantique des philosophes de la nature, Oken a semencé la pensée des fondateurs de la théorie cellulaire. Ses concepts d' »Urschleim » (mucus primitif) et d' »Urbliischen » (vésicule primitive) anticipent le protoplasme et la cellule. Il concevait la génération des organismes comme une agglomération régulière d’infusoires. Mais aussi, et de manière plus profonde, il voyait l’élément comme le résultat d’une libération, d’une dislocation d’animaux plus grands en leurs constituants. L’organisme n’est pas une somme, mais une réalité supérieure où les éléments sont niés en tant que tels, formant une autre individualité. C’est une anticipation de la théorie des degrés de l’individualité.
L’Avènement de la Théorie Cellulaire
La théorie cellulaire, telle que formulée par Schleiden (végétaux, 1838) et généralisée par Schwann (tous les êtres vivants, 1839-1842), s’est imposée avec l’affirmation des deux principes fondamentaux : l’organisme est composé de cellules (élément vital), et toute cellule dérive d’une cellule antérieure (« omnis cellula e cellula » de Virchow). L’œuf lui-même est considéré comme une cellule germinative.
Cependant, Canguilhem note que même au moment de sa proclamation quasi officielle, l’empire de la théorie cellulaire n’était pas intégral. Charles Robin, titulaire de la chaire d’histologie à Paris, refusa d’enseigner la théorie cellulaire jusqu’en 1922. Il admettait la cellule comme élément anatomique, mais pas le seul, et la possibilité de formation de cellules dans un blastème initial.
Le débat sur la cellule comme « citoyen autonome » ou comme partie d’un « état cellulaire » a persisté. Claude Bernard décrivait l’organisme comme un « agrégat de cellules », tandis que Haeckel parlait des cellules comme de « vrais citoyens autonomes ». Canguilhem y voit l’influence d’une philosophie politique sur une théorie biologique. Prenant, Bouin et Maillart, qui introduisirent la théorie cellulaire en France, reconnaissaient que le caractère d’individualité domine la notion de cellule, mais aussi que les cellules sont des « cellules ouvertes« , et que l’individualité peut être à différents degrés, de la partie de la cellule à la société.
Le Débat Continu : Continuité vs. Discontinuité
Canguilhem met en évidence que les critiques et les réticences face à la théorie cellulaire classique se sont intensifiées récemment. Des éléments non cellulaires (substances intercellulaires, lymphe interstitielle) et la formation de cellules à partir de masses protoplasmiques continues (Lepechinskaia) sont de plus en plus acceptés. Lepechinskaia, soutenue par l’idéologie marxiste-léniniste en URSS, a mené des recherches sur l’origine des cellules à partir de matière vivante acellulaire (grains protéiniques de l’œuf de poulet). Cette polémique, au-delà de son aspect scientifique, soulève des enjeux idéologiques majeurs, notamment contre le « dogme » virchowien de « omnis cellula e cellula » et en faveur des thèses de Lyssenko sur la transmission des caractères acquis.
Pour Canguilhem, le sens de la théorie cellulaire est clair : c’est une extension de la méthode analytique à tous les problèmes théoriques posés par l’expérience. Mais sa valeur réside autant dans les obstacles qu’elle a soulevés que dans les solutions qu’elle a permises, en rajeunissant notamment le vieux débat entre le continu et le discontinu. Il n’est pas absurde de penser que la biologie s’achemine vers une fusion des représentations, analogue à la mécanique ondulatoire qui a unifié les concepts d’onde et de corpuscule. Les concepts scientifiques fondamentaux se greffent sur d’antiques images ou mythes (le plasma initial continu comme avatar du fluide mythologique générateur de vie, le « limon de la Bible »).
Canguilhem conclut que la question de savoir si l’individu est une réalité, une illusion ou un idéal, ne peut être résolue par la science seule. L’histoire des sciences révèle des retours de théories qui traduisent l’oscillation de l’esprit humain entre des orientations permanentes de la recherche.
Aspects du Vitalisme : Une Exigence de Vie Face à la Mécanisation 🌿
Le vitalisme est souvent perçu comme une doctrine dépassée. Canguilhem se propose de comprendre la vitalité du vitalisme d’un point de vue philosophique, non scientifique.
La Vitalité du Vitalisme
Le vitalisme est une étiquette appliquée à toute biologie soucieuse de son indépendance face aux ambitions « annexionnistes » des sciences de la matière. De Barthez à Driesch, en passant par Bichat et Claude Bernard, de nombreux penseurs se sont réclamés, à divers degrés, du vitalisme. C’est l’aveu implicite que cette « illusion » a une vitalité propre, et que sa réfutation a obligé ses critiques à reformuler leurs arguments, conduisant à un gain théorique ou expérimental. Marcel Prenant, un biologiste marxiste, a même suggéré que le bergsonisme (vitaliste) était, « en creux, le moule du matérialisme dialectique ».
Pour Canguilhem, le vitalisme, tel que défini par Barthez (médecin de l’École de Montpellier au XVIIIe siècle), se réclame de la tradition hippocratique. Le « principe vital » est la cause des phénomènes de la vie dans le corps humain. C’est une biologie de médecin sceptique face au pouvoir des remèdes, accordant plus d’importance à la réaction de l’organisme et à sa défense qu’à la cause morbide. Le vitalisme médical est l’expression d’une méfiance envers le pouvoir de la technique sur la vie, une confiance du vivant en sa propre identité. Il traduit une exigence permanente de la vie dans le vivant.
Radl a bien perçu que le vitalisme est davantage une exigence et une morale qu’une méthode ou une théorie. Il reflète un sentiment filial envers la nature, une vision de l’univers comme un organisme harmonieux. Le phénomène biologique fondamental pour les vitalistes est la génération, incitant à la contemplation de l’œuf plutôt qu’au maniement d’une machine. Van Helmont, figure typique, était en révolte contre la science mécaniste, considérant la vérité comme une réalité transcendante et la nature comme une infinité de forces hiérarchisées, organisées par des « Archées ». L’hostilité du vitalisme au mécanisme vise la forme technologique autant que théorique.
Vitalisme vs. Mécanisme
Si le vitalisme est vague et informulé comme une exigence, le mécanisme est strict et impérieux comme une méthode. Le mécanisme est lié à la notion de ruse ou de stratagème. L’invention de machines par l’homme est une « ruse de la raison ». La ruse humaine ne réussit que si la nature n’est pas elle-même un art. La théorie cartésienne de l’animal-machine est le reflet de cette ruse.
Cependant, Canguilhem nuance le caractère « chimérique » du vitalisme en soulignant sa fécondité paradoxale. Par exemple, les expériences de Spemann sur les chimères (conjonction de cellules d’œufs d’espèces différentes) ont été interprétées comme un argument contre le vitalisme. Pourtant, si l’action de l’organisateur n’est pas spécifique, son effet est spécifique (un organisateur de grenouille greffé sur un triton induit la formation d’un axe nerveux de triton). La causalité appartient au système organisme-tissu entier, non à une partie sur une autre.
De plus, le vitalisme a contribué à des découvertes authentiques et inattendues. G. F. Wolff (vitaliste) a fondé l’embryologie moderne par des observations microscopiques précises. Von Baer (vitaliste) a découvert l’œuf des mammifères et formulé la théorie des feuillets. L’histoire de la théorie cellulaire compte autant de vitalistes que de mécanistes parmi ses précurseurs et fondateurs. La théorie du réflexe doit probablement plus aux vitalistes (Willis, Prochaska) qu’aux mécanistes.
Canguilhem critique toutefois les biologistes vitalistes qui, en fin de carrière, abandonnent la recherche scientifique pour la spéculation philosophique, s’appuyant sur leur prestige passé de scientifiques pour « apporter à la philosophie des capitaux » qui en réalité ne cessent de baisser.
Vitalisme, Politique et Idéologie
Le vitalisme est souvent accusé d’être non seulement scientifiquement rétrograde, mais aussi politiquement réactionnaire ou contre-révolutionnaire. Cette accusation est liée à son association avec l’animisme (Stahl), qui attribue à l’âme des attributs d’intelligence agissant sur le corps. L’utilisation du vitalisme par l’idéologie nazie, qui a instrumentalisé les théories de la Ganzheit (totalité organique) contre le libéralisme individualiste, a renforcé cette accusation. L’exemple de Driesch, dont l’entelechie est devenue un « Fuhrer » de l’organisme après 1933, est emblématique.
Canguilhem objecte fermement que l’exploitation d’une théorie scientifique par une idéologie (comme le racisme, l’eugénique, l’impérialisme) ne prouve rien contre la qualité des faits expérimentaux et des suppositions raisonnables qui la sous-tendent. Il est absurde de chercher dans la biologie une justification pour une politique d’exploitation de l’homme par l’homme.
En fait, les renaissances du vitalisme traduisent une méfiante permanente de la vie devant sa mécanisation. Le vitalisme est justifié par ce qu’il y a dans la vie de rebelle à sa mécanisation, par sa spontanéité propre, que Claude Bernard exprimait en disant : « la vie c’est la création ». Canguilhem souligne que même certains matérialistes du XVIIIe siècle, comme Diderot, peuvent être considérés comme des « matérialistes vitalistes », se situant « sur le chemin qui va de Leibniz à Bergson ».
Machine et Organisme : Un Renversement de Perspective 🔄
L’assimilation de l’organisme à une machine, longtemps un dogme pour les biologistes matérialistes, est aujourd’hui remise en question. Canguilhem explore ce problème en inversant la perspective habituelle : plutôt que d’expliquer l’organisme par la machine, il cherche à comprendre la construction de la machine à partir de l’organisme.
L’Organisme comme Machine : Une Analogie Problématique
Une machine est une construction artificielle dont la fonction essentielle dépend de mécanismes (configuration de solides en mouvement). Les mécanismes ne créent pas le mouvement, ils le régulent et le transforment. Historiquement, l’explication mécanique de la vie a supposé la construction d’automates, c’est-à-dire de machines capables de transformer une énergie qui n’est pas directement musculaire.
Descartes est une figure centrale de cette assimilation, trouvant des analogies de l’organisme dans les horloges, moulins à eau, fontaines artificielles. Sa théorie de l’animal-machine est indissociable du « Je pense donc je suis » et de la distinction radicale entre l’âme et le corps. Descartes dévalorise l’animal en machine pour justifier son utilisation par l’homme.
Canguilhem soutient que la théorie de l’animal-machine de Descartes implique deux postulats souvent négligés : l’existence d’un Dieu fabricateur et d’un vivant préalable à imiter. Le modèle du vivant-machine est le vivant lui-même. En substituant le mécanisme à l’organisme, Descartes ne fait pas disparaître la téléologie de la vie, mais la concentre au point de départ, l’enfermant dans la technique de production. Une machine est faite par l’homme et pour l’homme, en vue de certaines fins. L’élimination de la finalité anthropomorphique est remplacée par un anthropomorphisme technologique.
Le Renversement du Rapport : L’Organisme comme Modèle de la Machine
Canguilhem met en évidence les propriétés de l’organisme qui contredisent l’analogie avec la machine :
- Auto-construction, auto-conservation, auto-régulation, auto-réparation (contrairement à la machine qui dépend d’une intervention humaine).
- Vicariance des fonctions et polyvalence des organes (ex. : aphasie chez l’enfant, estomac ayant une fonction hématopoïétique, placenta se greffant sur l’intestin). Contrairement à la machine qui a une finalité rigide et univoque, l’organisme a moins de finalité et plus de potentialités.
- Tolérance aux monstruosités : Il n’y a pas de « machine monstre » ou de pathologie mécanique, car la vie tolère et même intègre les monstruosités, qui sont des « essais » de la nature.
Les travaux d’embryologie expérimentale (Driesch, Hörstadius, Spemann) ont conduit à l’abandon des représentations mécaniques, montrant que le germe ne contient pas une « machinerie spécifique ». Les expériences de Driesch sur l’œuf d’oursin (dissociation de blastomères produisant des larves normales, ou conjugaison de deux œufs produisant une seule larve plus grosse) démontrent une indifférence de l’effet à la quantité ou à l’ordre de la cause. L’organisme ne peut être réduit à une somme de parties.
Canguilhem propose d’inverser le rapport cartésien : les composants d’une montre sont des « produits immédiats ou dérivés d’une activité technique aussi authentiquement organique que celle de la fructification des arbres ». L’invention mécanique est une fonction biologique, un aspect de l’organisation de la matière par la vie. Kant, dans la Critique du Jugement, distingue la machine et l’organisme en soulignant que dans une machine, aucune partie n’est produite par une autre, ni aucun tout par un autre tout de même espèce, et qu’il n’y a pas de « montre à faire des montres ». Kant reconnaît l’originalité vitale de la technique humaine, irréductible à la rationalisation.
Les travaux d’ethnographie, notamment ceux de Leroi-Gourhan, montrent que les premiers outils sont des prolongements des organes humains. La percussion, acte technique fondamental, est une « expansion de l’amibe » qui saisit et digère l’objet extérieur. La locomotive elle-même tire ses ancêtres de machines organiques comme le rouet, soulignant l’antériorité de la technique sur la théorie scientifique.
Ce renversement de perspective se confirme dans l’attitude des sociétés industrielles contemporaines face au machinisme. La rationalisation (Taylorisme) visait à mécaniser l’organisme humain, mais la constatation que les mouvements superflus sont biologiquement nécessaires a conduit à un renversement : adapter les machines à l’organisme humain. La technique est un phénomène biologique universel.
Le Vivant et son Milieu : Une Relation Dialectique 🌍
La notion de milieu est devenue une catégorie universelle de la pensée contemporaine en biologie, mais son histoire et ses usages sont complexes.
L’Émergence du Concept de Milieu
Historiquement, la notion de milieu a été importée de la mécanique (Newton et l’éther) en biologie au XVIIIe siècle. Pour Newton, le fluide (éther) est un intermédiaire et un support d’action à distance. Lamarck, influencé par Buffon et Newton, parlait de « milieux » au pluriel (fluides comme l’eau, l’air, la lumière) ou de « circonstances influentes ».
Auguste Comte, en 1838, a érigé « milieu » en notion universelle et abstraite en biologie, le définissant comme « l’ensemble total des circonstances extérieures nécessaires à l’existence de chaque organisme ». Bien qu’il ait eu le pressentiment d’une relation dialectique organisme-milieu (« conflit de puissances », « influence réciproque »), il a subordonné cette action du vivant au milieu au principe newtonien de l’action et de la réaction, considérant l’action du vivant comme négligeable, sauf pour l’espèce humaine collective. La relation organisme-milieu est ainsi réduite à un problème mathématique.
Lamarck vs. Darwin : Deux Visions du Milieu
La publication de l’Origine des Espèces de Darwin (1859) a polarisé le débat.
- Lamarck : Le milieu agit sur le vivant non pas directement, mais par l’intermédiaire du besoin. Les changements de circonstances entraînent des changements de besoins, qui à leur tour développent ou atrophient les organes (usage et non-usage). Le lamarckisme est un vitalisme nu : la vie résiste au milieu indifférent en se déformant pour survivre. L’adaptation est un effort renouvelé, non une harmonie.
- Darwin : Le milieu (climat, nourriture) n’est qu’une cause secondaire de variation. Le rapport biologique fondamental est celui de vivant à vivant (concurrence vitale, sélection naturelle). La variation est un mécanisme de production de différences, et la sélection un mécanisme de réduction et de critique. Le milieu est davantage un milieu biogéographique, marqué par l’interdépendance.
Canguilhem note que la notion de « milieu » a été utilisée de manière déterministe et mécaniste pour dissoudre les synthèses organiques individualisées dans l’anonymat des éléments universels. Les néo-lamarckiens français, en se focalisant sur le conditionnement extérieur, en viennent à la thèse des animaux-machines, où la nature agit en eux par leurs organes.
Le Milieu : Un Déterminisme Humain et une Norme Subjective
Le béhaviorisme (Loeb, Watson) a porté cette vision à son paroxysme, considérant tout mouvement de l’organisme comme forcé par le milieu, réduisant la biologie du comportement à une neurologie et une énergétique. Le milieu est investi de tous les pouvoirs, annulant l’hérédité et la conscience.
Cependant, Canguilhem, s’inspirant de Kant, Claparède, Uexküll et Goldstein, propose un renversement de la relation organisme-milieu. Le propre du vivant est de se faire son milieu, de le composer. L’organisme est un centre qui structure et organise son environnement. Ce que le milieu offre au vivant est fonction de la demande du vivant.
- Von Uexküll : Distingue l’Umwelt (milieu de comportement propre à un organisme), l’Umgebung (environnement géographique banal) et la Welt (univers de la science). L’Umwelt est un ensemble d’excitations ayant valeur de signaux pour le vivant, anticipés par une attitude du sujet. L’exemple de la tique (qui attend 18 ans pour l’odeur spécifique du beurre rance et la chaleur du sang des mammifères) illustre comment l’animal ne retient que quelques signaux de l’exubérance du milieu physique, son rythme de vie ordonnant son temps et son espace.
- Goldstein : Critique la théorie mécanique du réflexe. Le réflexe n’est pas une réaction isolée et gratuite. L’orientation de la réaction dépend de la signification d’une situation perçue dans son ensemble. Un animal en situation expérimentale est dans une situation anormale, imposée, non choisie. L’être de l’organisme, c’est son sens, son pouvoir de rayonner et d’organiser le milieu à partir d’un centre de référence qui ne peut être référé lui-même.
Ce renversement est aussi manifeste en génétique. Les travaux de Mendel, puis Bateson, Cuénot, Morgan, Müller, ont affirmé que l’acquisition de la forme et des fonctions du vivant dépend de son potentiel héréditaire propre, l’action du milieu sur le phénotype laissant intact le génotype. Cependant, les mutations induites par des radiations (Müller) et le regain du lamarckisme (Lyssenko) ont relancé le débat sur l’influence du milieu, notamment avec des implications politiques. Pour Lyssenko, l’hérédité est sous la dépendance du métabolisme et des conditions d’existence, justifiant une action illimitée de l’homme sur lui-même par l’intermédiaire du milieu, et un « renouvellement expérimental de la nature humaine ».
Canguilhem conclut cette section en soulignant que, si la science (particulièrement la physique d’Einstein) cherche à disqualifier les qualités des objets pour construire un univers absolu et « inhumain », l’homme vivant tire un privilège de son propre milieu, un « milieu propre de comportement et de vie » qui est le monde de sa perception et de son expérience pragmatique. La science est l’œuvre d’une humanité enracinée dans la vie, et le milieu propre des hommes n’est pas simplement un contenu dans un contenant universel, mais un centre qui éprouve un besoin et des valeurs.
Le Normal et le Pathologique : La Vie comme Normativité 🌟
Les concepts de normal et de pathologique sont indispensables à la pensée médicale, mais leur définition est ambiguë. Canguilhem s’attache à éclaircir cette ambiguïté, en rejetant une approche purement statistique au profit d’une vision normative de la vie.
Clarifier les Concepts
Le terme « normal » désigne à la fois un fait statistique (moyenne) et un idéal (prototype). Canguilhem, à la suite de Bichat, insiste sur l’instabilité des forces vitales et l’irrégularité des phénomènes vitaux, qui les distinguent des lois physiques. Pour Bichat, le vitalisme est la simple reconnaissance de l’originalité du fait vital.
Le problème est de savoir si le vivant doit être traité comme un système de lois ou comme une organisation de propriétés. La science, en cherchant des lois invariantes, tend à voir le singulier comme une imperfection ou une « aberration ». Canguilhem, reprenant Claude Bernard, reconnaît que la « vérité est dans le type, la réalité se trouve toujours en dehors de ce type ». Pour le médecin, c’est l’individu qui importe, et l’individualité est un « obstacle » à la biologie expérimentale. Canguilhem critique cette vision : l’obstacle et l’objet de la science ne font qu’un.
Individu, Type et Anomalie
Canguilhem propose de voir la vie comme un ordre de propriétés, une organisation de puissances dont la stabilité est précaire, résultant d’un équilibre et de compromis. Dans cette perspective, l’irrégularité et l’anomalie ne sont pas des accidents, mais l’existence même de l’individu. Le « principe des indiscernables » de Leibniz (pas deux individus semblables) est pertinent ici.
Les anomalies ne sont pas des erreurs, mais des « essais » ou « aventures » de la nature. L’embryologie et la tératologie expérimentales (travaux d’Étienne Wolff) voient dans l’étude des monstruosités un accès à la connaissance du développement de l’œuf. Il n’y a pas de formes manquées en soi, car « il y a mille et une façons de vivre ». Les formes vivantes sont des « monstres normalisés« . La génétique moderne, en étudiant les mutations et la fluctuation des gènes, montre que le milieu (la sélection) est tantôt conservateur, tantôt novateur.
Le terme « normal » n’a pas de sens absolu. Le vivant et le milieu ne sont normaux que dans leur relation. L’anomalie n’est pas pathologique en soi, mais seulement si elle est « aberrante par rapport à un type spécifique statistiquement défini ». Le normal peut signifier une moyenne statistique, mais aussi un caractère dont la reproduction révèle l’importance et la valeur vitales, devenant ainsi normatif ou prototypique.
Le Pathologique chez l’Homme : Au-Delà du Biologique
Chez l’homme, le problème de l’anomalie et de la maladie est modifié par l’existence de normes sociales et culturelles. L’homme peut créer de nouveaux milieux, et sa capacité de résistance et d’activité technique le rend unique. Une constante physiologique (tension artérielle, glycémie) n’est pas pathologique en soi, mais le devient lorsque l’existence de l’être est dangereusement troublée, entraînant des « réactions catastrophiques ».
Leriche, qui définit la santé comme « la vie dans le silence des organes », reconnaît que la maladie est un ensemble, une « physiologie nouvelle ». Goldstein insiste sur le fait que l’adaptation à un milieu personnel est une des présuppositions fondamentales de la santé. Les normes de vie pathologiques obligent l’organisme à vivre dans un milieu « rétréci », l’empêchant d’affronter de nouveaux défis.
Canguilhem conclut que le pathologique n’est pas l’absence de normes, mais la présence d’autres normes, vitalement inférieures ou dépréciées. La maladie, en réduisant la capacité à surmonter d’autres crises, est une perte de cette « latitude » ou « jeu » des normes. La santé est la capacité de surmonter des crises pour instaurer un nouvel ordre physiologique, le « luxe de pouvoir tomber malade et de s’en relever ».
En psychopathologie, le malade mental est un « autre » homme, en possession d’autres normes. La normalité en psychologie est souvent une adaptation au réel qui n’est pas absolue, mais liée à des valeurs culturelles. Canguilhem lie la santé au pouvoir normatif de remettre en question les normes physiologiques usuelles, impliquant l’acceptation du risque de maladie. De même, la norme en psychisme humain est la revendication de la liberté comme pouvoir de révision et d’institution des normes, ce qui implique le risque de folie.
Canguilhem termine en affirmant que la biologie humaine et la médecine sont des pièces nécessaires d’une « anthropologie », et qu’il n’y a pas d’anthropologie sans une morale. Le concept de « normal » dans l’ordre humain reste un concept normatif et proprement philosophique.
Conclusion : L’Originalité de la Pensée de Canguilhem ✨
Georges Canguilhem, à travers La Connaissance de la Vie, nous offre une perspective inestimable sur la biologie, qui transcende les débats scientifiques pour toucher aux questions fondamentales de l’existence et de la connaissance. Son œuvre est un appel à la vigilance épistémologique, nous incitant à toujours considérer les fondements philosophiques des concepts scientifiques et à ne pas réduire le vivant à des modèles simplistes.
Il nous montre que la science de la vie n’est pas une simple application des lois de la matière, mais une discipline qui doit reconnaître l’originalité irréductible de la vie elle-même. Que ce soit dans l’expérimentation, la théorie cellulaire, le vitalisme, le rapport machine-organisme, ou la distinction normal/pathologique, Canguilhem nous pousse à voir la vie non comme une entité passive soumise à des lois externes, mais comme une force créatrice et normative, qui façonne son propre milieu et institue ses propres valeurs.
Comprendre Canguilhem, c’est comme apprendre à lire une carte marine complexe : ce n’est pas seulement décoder des symboles, mais comprendre les courants profonds, les marées invisibles et la manière dont le navigateur (le vivant) interagit avec et façonne son propre chemin à travers les vastes étendues de l’existence. Son héritage nous invite à une pensée toujours en mouvement, consciente des risques et des potentialités de la vie elle-même.