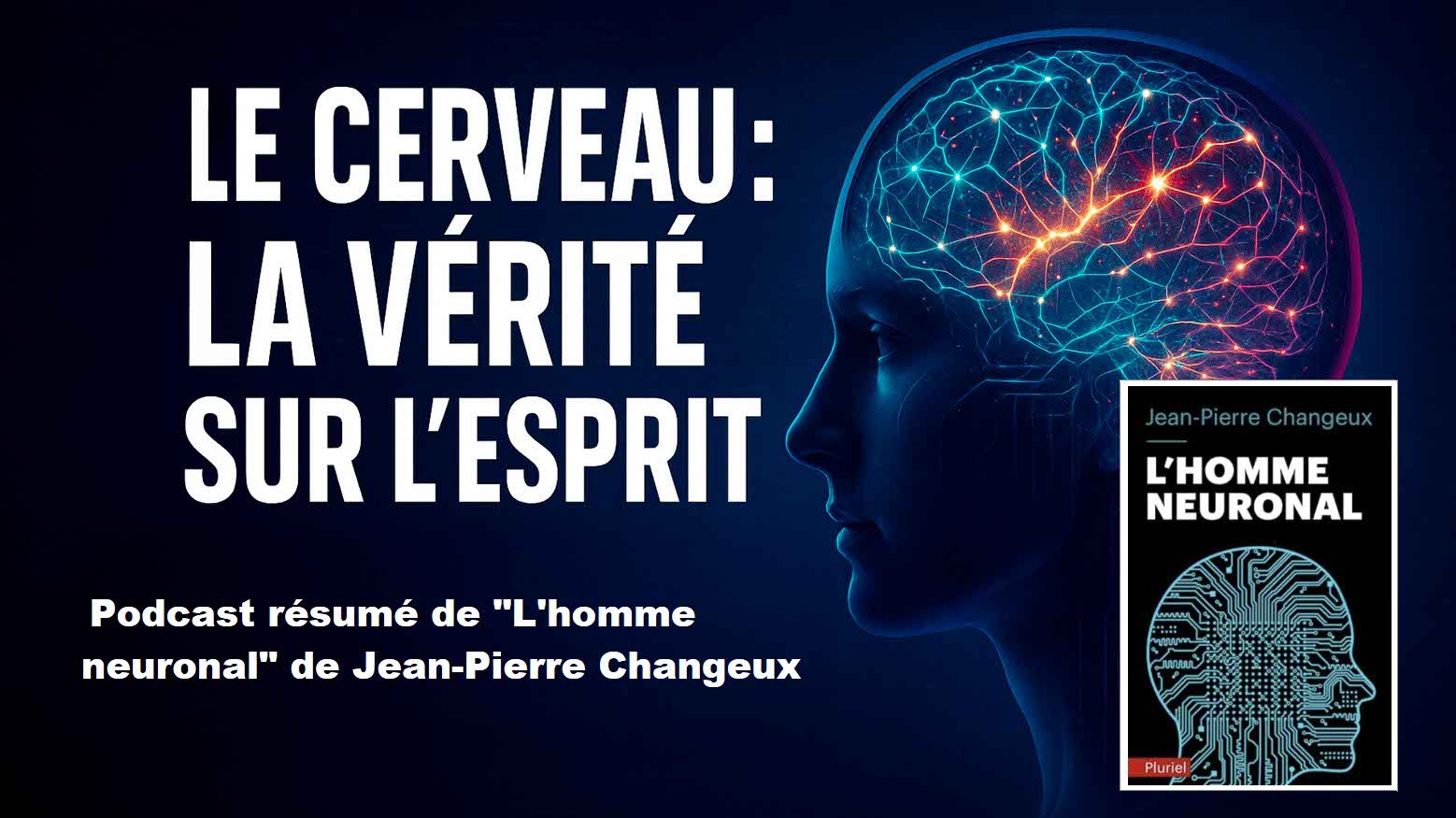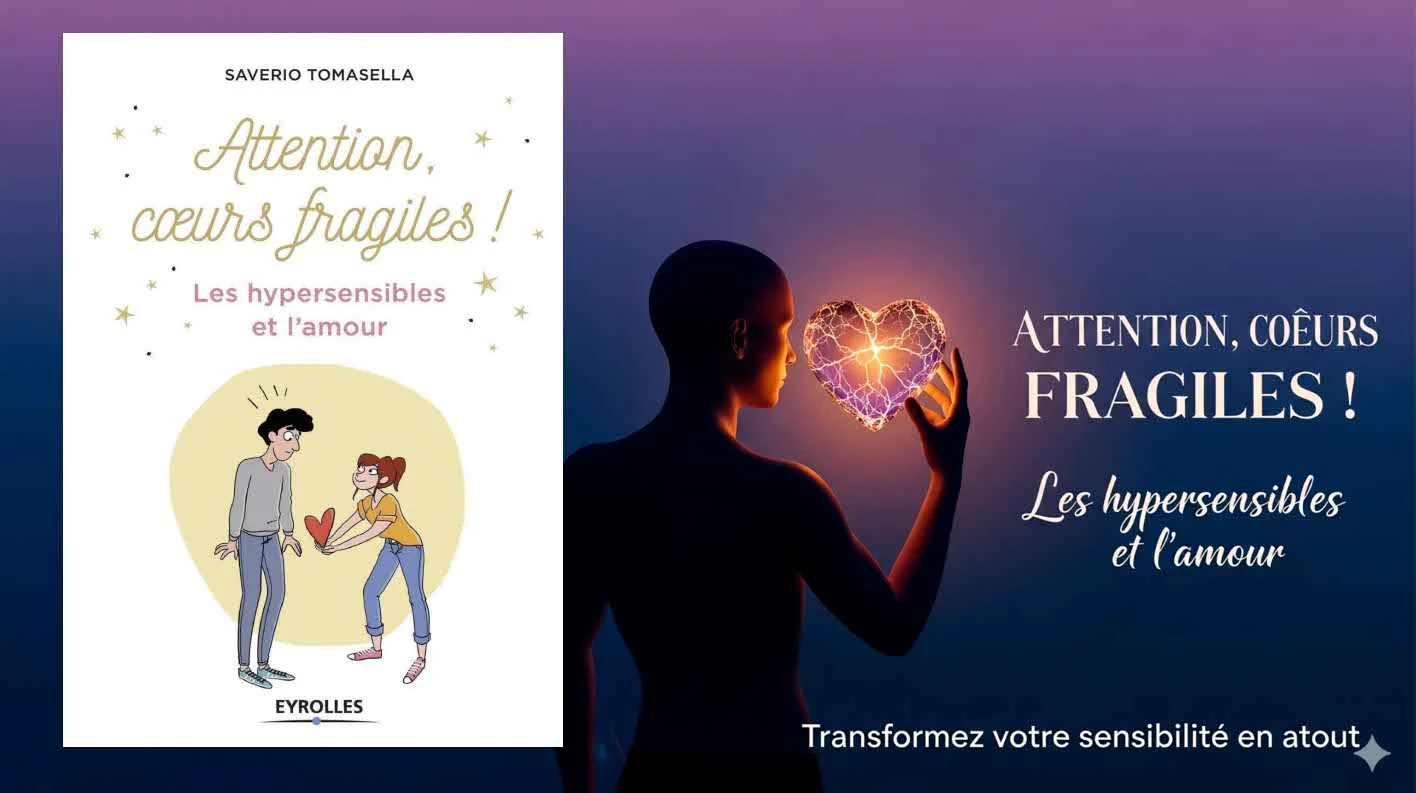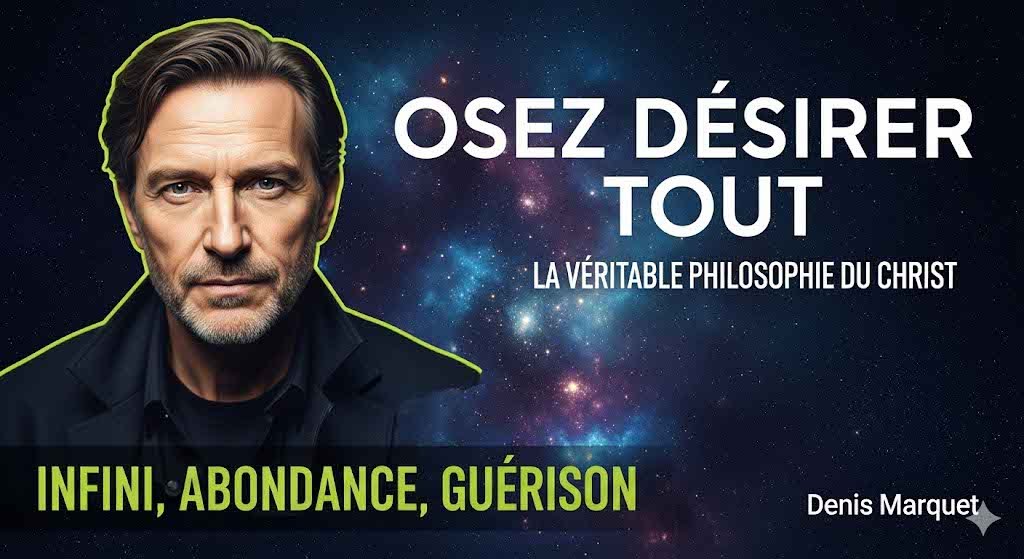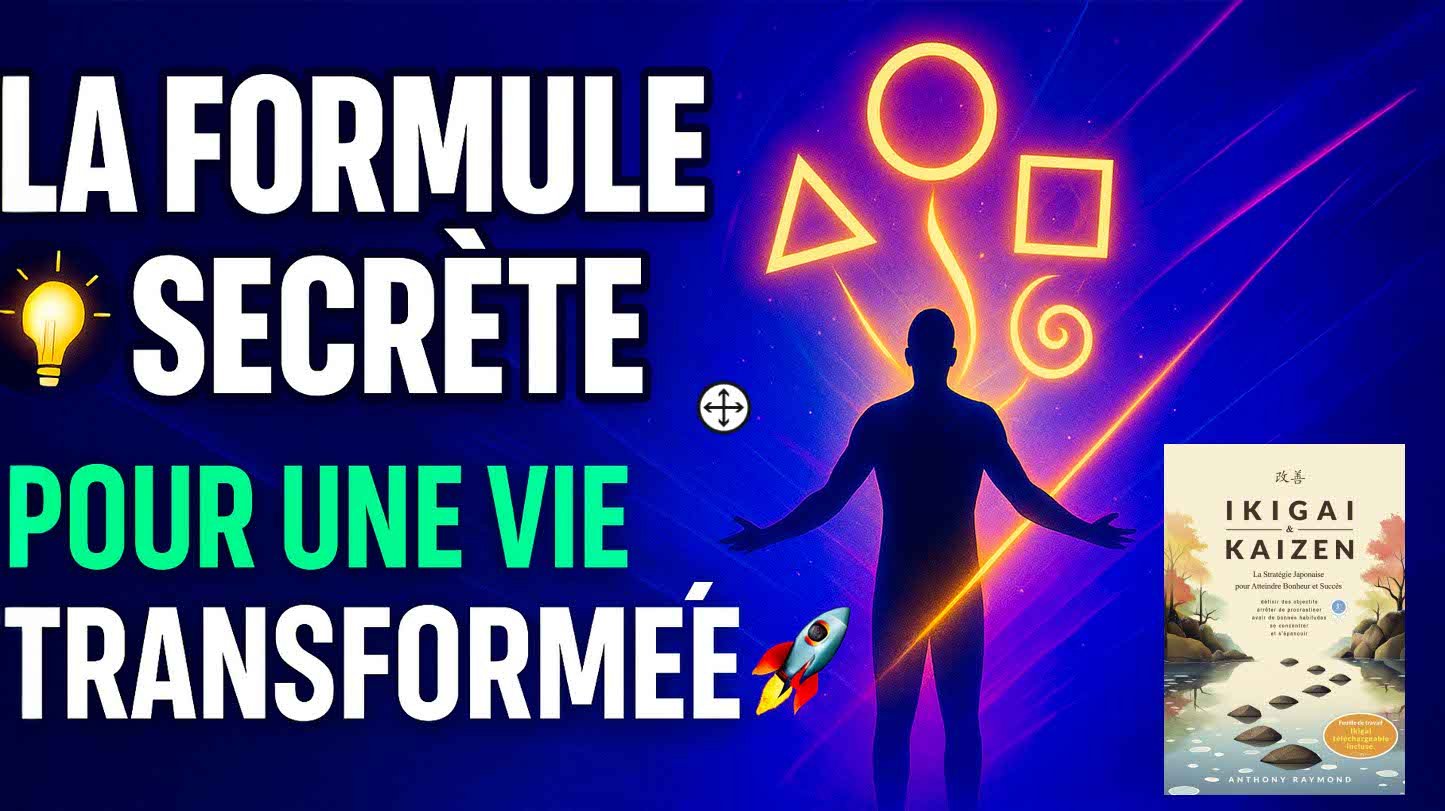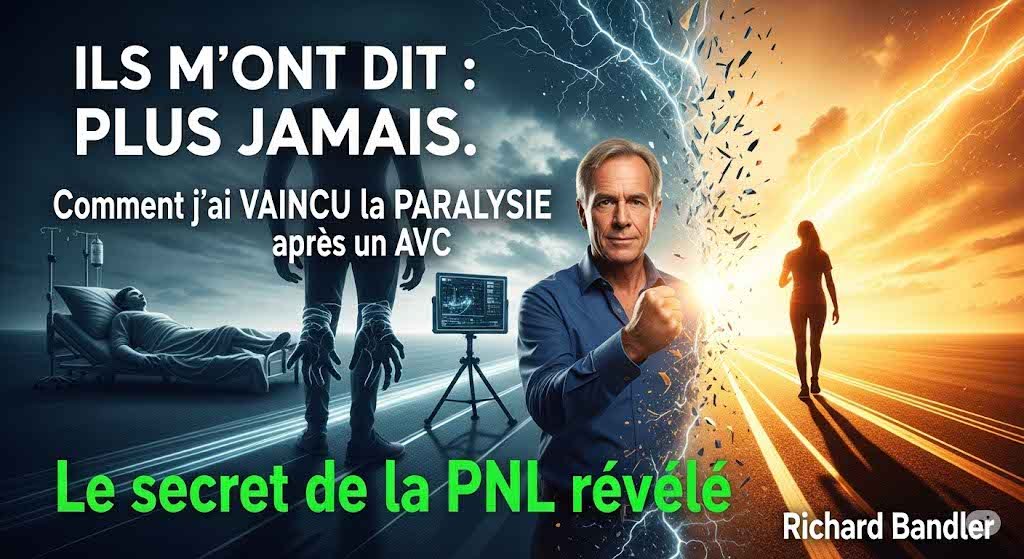Les liens pour vous procurer les différentes versions
📗Lien vers le livre papier : https://amzn.to/4kG1DiJ
📕Lien vers l’ebook : https://amzn.to/4eKdTgJ
Embrasser le Ciel Immense : Une Odyssée Fascinante au Cœur de l’Esprit Humain avec Daniel Tammet 🧠✨
Dans un monde où la complexité de l’esprit humain continue de nous émerveiller et de nous interroger, « Embrasser le ciel immense » de Daniel Tammet offre une exploration profonde et incroyablement personnelle des capacités de notre cerveau. Loin des clichés et des idées reçues, cet ouvrage, traduit de l’anglais « Embracing the Wide Sky » (Hodder & Stoughton, 2009) par Daniel Tammet lui-même et Jérôme Tabet, est une véritable invitation à repenser notre compréhension de l’intelligence, du génie et de la nature humaine.
Daniel Tammet, un autiste Asperger médiatisé et doté de capacités savantes exceptionnelles, nous guide à travers les horizons de l’esprit, mêlant les recherches neuroscientifiques les plus récentes à ses propres réflexions et expériences. Son objectif est clair : montrer que les esprits fonctionnant différemment, comme le sien, ne sont pas si étranges et que chacun peut en tirer des leçons précieuses pour mieux comprendre et utiliser son propre cerveau.
Cet article propose un résumé détaillé et une analyse perspicace de « Embrasser le ciel immense », en mettant en lumière ses concepts clés, ses arguments novateurs et les insights qu’il offre pour une compréhension plus riche et plus humaine de l’intelligence. Préparez-vous à un voyage intellectuel qui promet de transformer votre perception du cerveau et de ses potentialités illimitées.
Daniel Tammet : Un Cerveau Hors Norme, une Perspective Universelle 🌟
Dès les premières pages, Daniel Tammet nous confronte à un événement marquant : un scientifique, médusé, lui demande comment il a pu percevoir qu’une photo avait été prise sans clic ni flash. La réponse de Tammet est simple, mais révélatrice : son cerveau d’autiste, capable de discerner des détails minuscules souvent invisibles pour d’autres, avait détecté une petite lumière rouge de la taille d’une tête d’épingle. Cette anecdote illustre parfaitement le cœur de l’ouvrage : déconstruire les mythes autour des capacités savantes et montrer que l’extraordinaire est souvent une forme extrême du quotidien.
Tammet insiste : il n’a aucune relation télépathique ou pouvoir extrasensoriel. Il déplore la conclusion « fausse, mais communément admise » selon laquelle les individus au cerveau différent l’utilisent de manière fondamentalement différente. En tant qu’autiste savant médiatisé, il a reçu des demandes farfelues, de la prédiction des numéros du Loto à des conseils pour la construction d’une machine à mouvement perpétuel, soulignant à quel point l’autisme et le syndrome d’Asperger restent incompris, même par les experts.
Pour Tammet, l’idée de doter les autistes savants de pouvoirs surnaturels, ou de classer des personnalités comme Mozart, Einstein, Kasparov ou Bill Gates comme ayant des cerveaux radicalement différents, est erronée et dangereuse. Il s’agit d’une injustice qui sépare les aptitudes hors du commun de ce qui fait leur humanité. Au contraire, l’auteur affirme que « Tous les cerveaux sont stupéfiants ». Les neuroscientifiques ont découvert, en étudiant aussi bien les surdoués que des personnes plus ordinaires comme les femmes au foyer ou les chauffeurs de taxi, une compréhension du potentiel humain « beaucoup plus riche et plus sophistiquée que jamais auparavant ». Le succès n’est pas l’apanage de quelques chanceux, mais est accessible à « tous ceux qui ont la passion et le dévouement nécessaires à la maîtrise d’un domaine ou d’un sujet ». Le génie, sous toutes ses formes, ne se loge pas dans une « cavité biscornue du cerveau », mais « vient des qualités essentiellement humaines, dynamiques et chaotiques que sont la persévérance, l’imagination, l’intuition et même l’amour ».
Le livre, « Embrasser le ciel immense », est dédié à « la beauté qui sommeille en chaque esprit ». Tammet y développe ses réflexions personnelles, détaillant ses propres capacités et expériences, avec pour objectif de « clarifier les nombreuses idées fausses concernant les capacités des autistes savants et proposer une nouvelle conception de l’intelligence ». Il promet de démontrer que le cerveau des savants autistes « n’est pas si différent de celui de Monsieur Tout-le-monde ».
L’Esprit Humain : Plus Vaste Que le Ciel 🌌
Le voyage de Daniel Tammet débute par une plongée dans la complexité du cerveau humain. Il décrit notre esprit comme un miracle, fait de « fragiles fils de lumière perlés de rosée » qui s’enchevêtrent pour façonner notre perception du monde. Le cerveau, pesant un peu plus d’un kilo, contient environ 100 milliards de neurones et pourrait atteindre un quatrillion (1 000 000 000 000 000) de connexions – plus que d’étoiles connues dans l’univers ! Cette complexité est un défi pour les neuroscientifiques, mais leurs découvertes récentes ont révolutionné notre compréhension du cerveau.
L’auteur partage son expérience personnelle des tests cognitifs, notamment un scanner IRM (imagerie par résonance magnétique). Il décrit cette expérience insolite, où l’appareil utilise un aimant puissant pour bouleverser l’alignement des atomes dans la tête. Lors de son passage au scanner, Tammet devait mémoriser des rangées de chiffres, ce qui augmentait l’activité métabolique dans les régions cérébrales impliquées dans les activités numériques. Les scientifiques enregistraient cette activité neuronale pour créer des images détaillées de son cerveau et les comparer à celles d’autres personnes. Bien que cette technologie semble « tout droit sortie d’un épisode de la série Star Trek », elle devient de plus en plus courante, offrant des « éclaircissements impensables il y a quelques années ».
L’une des découvertes les plus passionnantes des neurosciences est la neuroplasticité : l’idée que le cerveau est « animé, souple, dynamique, capable de se guérir par lui-même en créant de nouvelles connexions synaptiques ». Cette vision remplace le modèle strict d’un cerveau figé. Les retombées sont immenses pour les patients souffrant de troubles neurologiques et pour tous. Tammet illustre cette plasticité par plusieurs exemples :
- Traitement de la douleur du membre fantôme : Le Dr. V. S. Ramachandran a pu aider un patient, Tom, en stimulant des zones de son visage qui « mappaient » sur son pouce ou index fantôme, grâce à la réorganisation des connexions corticales. La « boîte miroir » peut même apporter un soulagement à long terme en « dupplicating » le membre.
- Développement de nouveaux sens : Des scientifiques explorent la possibilité d’utiliser la plasticité pour développer ou créer de nouveaux sens. La ceinture « feelSpace » de Peter König détecte le champ magnétique de la Terre pour fournir une perception directionnelle. Un appareil stimulant la langue avec 144 électrodes a aidé des patients souffrant de dommages à l’oreille interne à maintenir leur équilibre, et a même été expérimenté pour les malvoyants, transformant leur langue en « œil de substitution » leur permettant de « voir » des formes en 3D et de naviguer dans l’espace.
- Modification du cerveau par la pensée : L’expérience d’Alvaro Pascual-Leone à Harvard a montré que des non-musiciens qui pratiquaient mentalement un air de piano voyaient le territoire cérébral consacré aux mouvements des doigts se modifier, de la même manière que ceux qui pratiquaient physiquement. Visualiser un geste sportif (comme un swing de golf) peut aider à optimiser le mouvement.
- Thérapies cognitives et méditation : La capacité du cerveau à se modifier par la pensée ouvre des possibilités en santé, avec des thérapies qui rééquilibrent les connexions neuronales pour soulager les troubles mentaux. Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) visent à modifier les pensées négatives. Des études sur des moines bouddhistes méditant ont montré une production d’ondes gamma (liées à la perception et la consolidation de l’information) trente fois plus intense que chez des étudiants, signe d’un état de réflexion profonde.
Ces avancées offrent un « nouvel espoir » pour les désordres neurologiques auparavant incurables, transformant notre idée de notre « univers intérieur ». Par exemple, des implants cérébraux composés de puces électroniques sont développés pour prévoir et prévenir les crises d’épilepsie. Tammet souligne également que ces découvertes modifient la perception du public sur les « esprits anormaux », montrant la « grande diversité des formes d’autisme » et la capacité des autistes à mener une vie heureuse et indépendante, à l’instar de personnalités comme Richard Borcherds, Vernon L. Smith, Bram Cohen, Dawn Prince-Hughes ou Satoshi Tajiri.
L’auteur se distingue comme un « savant prodige », dont les capacités surpassent incroyablement sa condition d’autiste, un phénomène estimé à moins de cinquante personnes vivantes dans le monde. Il déconstruit le cliché de l’autiste comme un individu « brillant mais ‘défectueux' », popularisé par le film Rain Man, basé sur des recherches « largement périmées » de plus de vingt ans.
L’Intelligence : Au-delà du QI et des Clichés 💡
« Qu’est-ce que l’intelligence exactement ? » Daniel Tammet avoue ne pas se sentir assez intelligent pour répondre à cette question, soulignant son caractère abstrait, comparable à l’amour. Il conteste l’idée que l’intelligence ne prend sens qu’à travers des preuves concrètes, comme le test de QI, qu’il a lui-même passé pour la première fois à 25 ans.
La Critique du Test de QI : Tammet révèle que son propre QI a été estimé à 150 (sur l’échelle de Wechsler) ou 180 (sur l’échelle Mensa Cattell), des scores qui lui ont valu une invitation à rejoindre Mensa, un club élitiste. Cependant, il critique l’organisation pour son élitisme et l’obsession de ses membres pour les casse-tête, citant Groucho Marx pour exprimer son refus d’y adhérer. Sa critique du QI est fondamentale :
- Trivialité des exercices : Il a été frappé par la trivialité des exercices du test de Wechsler, qui ne sollicitent « aucune véritable réflexion, l’analyse d’une idée ou même la créativité ». Les questions n’ont qu’une seule réponse correcte, refusant les interprétations imagées ou poétiques.
- Origines historiques douteuses : L’auteur retrace l’histoire du QI, depuis la « craniométrie » des XVIIIe et XIXe siècles, qui prétendait lier la taille du crâne à l’intelligence et l’utiliser pour hiérarchiser les races. Des exemples de cerveaux de grands penseurs (Schiller, Tourgueniev, Whitman, Anatole France) ont soit soutenu soit contredit cette théorie, qui fut finalement qualifiée de « ridicule » par Alfred Binet.
- Détournement des intentions initiales : Binet, l’inventeur des premiers tests, les destinait à identifier les élèves ayant besoin d’un enseignement particulier. Cependant, Henry Goddard aux États-Unis a traduit et utilisé le test pour « identifier les ‘faibles d’esprit' » et les empêcher d’avoir des enfants, proposant la stérilisation obligatoire. Lewis Terman, de Stanford, a popularisé le test « Stanford-Binet » avec l’intention de classer les enfants selon des aptitudes innées et de « réduire la reproduction des attardés ». L’utilisation des tests par l’armée américaine a accru leur crédibilité, menant à une industrie de plusieurs millions de dollars et à des conséquences pernicieuses, comme des lois d’immigration strictes et la légitimation de la stérilisation.
- Biais et limites : Le débat sur la validité du QI persiste, comme en témoigne la controverse autour du livre The Bell Curve (1994), qui prétendait établir des différences d’intelligence entre races et classes sociales. Tammet critique les auteurs pour leur mesure « étroite de l’intelligence » et leur corrélation fallacieuse entre intelligence, éducation et succès économique, citant des personnalités talentueuses ayant échoué à l’école (Edison, Chaplin, Van Gogh).
- Critiques fondamentales : Binet lui-même avait mis en garde contre la mesure de l’intelligence comme une longueur et avait protesté contre l’idée d’une intelligence fixe. Walter Lippman dès les années 1920, et Stephen Jay Gould dans La Mal-Mesure de l’homme, ont dénoncé le test de QI comme un outil de classement basé sur la réussite à des problèmes spécifiques, non une mesure d’intelligence, critiquant la « réification » (transformer des concepts abstraits en objets concrets) et la « classification » des informations complexes sur une échelle de valeur.
- Absence de contexte : Les tests ignorent le niveau social et culturel, désavantageant les enfants issus de milieux défavorisés. L’auteur donne des exemples de questions de QI inspirées de la culture aborigène Kuuk Thaayorre, montrant comment les différences culturelles affectent les réponses et invalident la « justesse » d’une mesure unique.
- Failles mathématiques : Le caractère à choix multiples du test Mensa donne un rôle considérable au hasard, permettant des scores élevés par simple chance. La répartition des scores selon la courbe de Gauss impliquerait que des milliards de personnes auraient des résultats identiques, réduisant l’intelligence humaine à une « poignée de résultats chiffrés », une uniformité que Tammet compare à l’astrologie.
Des Intelligences Multiples : Face à cette vision réductrice, Tammet défend l’idée d’une intelligence comme un « phénomène complexe », une synthèse de compétences et de capacités variées. Il cite plusieurs théories :
- Théorie Triarchique de Robert Sternberg : Comprend l’intelligence analytique (analyser, évaluer), créative (nouvelles idées, situations inédites) et pratique (résoudre problèmes quotidiens, bon sens). Les individus conscients de leurs forces dans ces trois domaines possèdent « l’intelligence de la réussite ».
- Théorie des Intelligences Multiples d’Howard Gardner : Propose pas moins de huit formes d’intelligence (linguistique, logico-mathématique, spatiale, corporelle-kinesthésique, musicale, interpersonnelle, intrapersonnelle, naturaliste). Cette théorie a été saluée pour son impact positif dans les écoles, favorisant « une culture de l’effort, du respect et de l’attention ».
- Intelligence Émotionnelle de Daniel Goleman : Popularisée en 1995, elle met en évidence le rôle des émotions dans la pensée et la prise de décision, incluant le contrôle des pulsions, la motivation, l’empathie et la capacité à s’entendre avec les autres. Ce concept, qui peut compléter la pensée rationnelle, a également été utilisé avec succès dans les écoles pour développer l’apprentissage des émotions.
Le Génie : Inné ou Acquis ? Le livre aborde également la controverse sur l’origine du talent et des dons : sont-ils innés ou acquis ? La réponse a des conséquences politiques et sociales importantes.
- L’échec de l’eugénisme : Tammet cite l’exemple de Robert Klark Graham, un opticien millionnaire excentrique qui, dans les années 1970, a créé une « banque du sperme » de Prix Nobel pour « produire une génération de génies » et « sauver le monde du déclin génétique ». Ce projet, malgré les critiques, a « produit » des centaines d’enfants avant sa fermeture en 1999. L’ironie est que Doron Blake, un « enfant modèle » du projet, ne croit pas à la création artificielle de génies, affirmant que « c’est la manière dont l’enfant est élevé et éduqué qui compte ».
- L’importance de l’environnement et de l’entraînement : Lazslo Polgar, un psychologue scolaire hongrois, a prouvé sa théorie selon laquelle « chaque parent peut faire de son enfant un génie » avec un environnement adéquat et beaucoup d’entraînement. Il a élevé ses trois filles (Susan, Sophia et Judit) pour en faire des championnes d’échecs, grâce à une éducation rigide et intensive dès le plus jeune âge, qui a produit des résultats spectaculaires.
- La théorie du travail et de la persévérance : Le psychologue Michael Howe, dans Le Génie expliqué, soutient que le génie est le résultat du travail, de la persévérance et de la chance, et non d’une disposition génétique. Il s’appuie sur des biographies de Mozart, Darwin et les sœurs Brontë, qui ont tous investi des milliers d’heures dans leur domaine. Le professeur K. Anders Ericsson de l’Université de Floride a montré que les plus hautes performances ne sont possibles qu’après une pratique soutenue et systématique, souvent plus de 10 000 heures.
- La nuance biologique : Cependant, d’autres scientifiques critiquent cette « théorie des Cendrillons ». Le neuroscientifique Ognjen Amidzic, après avoir lui-même échoué à devenir joueur d’échecs professionnel malgré un entraînement intensif, a découvert, grâce au scanner, que les grands maîtres utilisaient davantage le cortex frontal et le lobe pariétal (mémoire à long terme), tandis que les joueurs aguerris sollicitaient la mémoire à court terme. Amidzic suggère que les joueurs d’échecs utilisent un certain pourcentage de leur mémoire à court et long terme grâce à des dispositions génétiques, un pourcentage « figé quelle que soit la quantité de travail fournie ».
- La position de Tammet : Pour Daniel Tammet, ses propres frères et sœurs montrent que les talents sont « aussi bien innés qu’acquis ». Ils ont réussi malgré un environnement défavorisé, ce qui suggère que certains dons peuvent être « réveillés » par le travail et le dévouement. Il s’accorde avec le consensus scientifique qui voit la réussite comme le résultat d’interactions complexes de facteurs génétiques et environnementaux, insistant sur l’idée que « ce n’est donc pas la taille de notre cerveau qui importe, mais bien la grandeur de notre âme ».
La Magie de la Mémoire et le Monde des Mots 📚🗣️
La mémoire est un thème central du livre de Daniel Tammet, qui la qualifie de « magie ». Il explique comment son record européen de récitation de la constante pi (22 514 décimales) n’est pas un miracle, mais le résultat de semaines de travail et de discipline, combinées à sa capacité synesthésique de percevoir les nombres comme des formes complexes en 3D, avec couleur et texture.
La Science de la Mémoire :
- Mémoire non photographique des savants : Tammet réfute le mythe d’une mémoire photographique chez les autistes savants, citant l’exemple de Kim Peek (qui a inspiré Rain Man). Peek se souvenait d’informations en les tissant dans un réseau mental d’associations, une façon de penser « basée sur l’association » commune à beaucoup de savants, y compris Tammet. Cependant, la mémoire des autistes savants a aussi ses limites ; Kim ne retient que ce qui l’intéresse, et Tammet a du mal avec les visages, raison pour laquelle il utilise des images mentales fixes. La différence avec la population générale réside dans le contenu des informations enregistrées, pas la manière de procéder.
- La mémoire est une reconstruction : La mémoire est loin d’être une simple « régurgitation du passé » ; elle est une reconstruction complexe influencée par nos émotions, réflexions et connaissances préexistantes. L’expérience de Sophie Calle, demandant à des employés de musée de se souvenir d’un tableau de Magritte, illustre la diversité et la subjectivité des souvenirs. Même nos souvenirs les plus intimes sont des reconstructions complexes, non des instantanés. Cette complexité réfute l’analogie du « cerveau ordinateur ».
- Améliorer sa mémoire : Tammet propose plusieurs stratégies :
- Comprendre plutôt qu’apprendre par cœur : Une mémorisation profonde (encodage sémantique élaboré) est plus efficace. Les acteurs professionnels analysent leurs textes pour mieux comprendre les motivations des personnages.
- Associations : Tammet associe les mots étrangers (ex: « grenouille » avec « citrouille » et « green »). L’anecdote de Jeannette associant « good night » à « gousse d’ail » est un exemple mémorable de cette technique. Associer un nouveau prénom à un ancien camarade portant le même nom aide également.
- Contexte et logique : Pour retenir des listes (rois d’Angleterre, présidents des États-Unis), il est plus facile de comprendre le contexte et les faits sous-jacents (règles de succession, mandats présidentiels).
- Imagination et jeux de rôles : Les jeux de rôles, comme la formation d’un « gouvernement » dans son enfance, ont aidé Tammet à ancrer profondément ses connaissances en les mettant en pratique.
- Anticipation et répétition : La capacité d’anticipation du cerveau est importante pour la mémoire. La répétition modulée (comme dans la musique) et la récitation d’épopées chantes facilitent la mémorisation. L’émotion joue un rôle central, rendant les souvenirs plus vivaces.
- Segmentation et hiérarchisation : Le « nombre magique sept, plus ou moins deux » de George A. Miller (la capacité de la mémoire à court terme) suggère de découper les informations en « morceaux » significatifs pour optimiser la rétention. Ce processus de création de blocs d’éléments (comme des chiffres en groupes, des lettres en mots) produit des hiérarchies d’associations, cruciales pour mémoriser de grandes quantités d’informations, comme les décimales de pi.
- Synesthésie : La perception des chiffres comme des formes 3D et des mots avec des couleurs renforce la mémoire de Tammet. L’étude de Shereshevsky, qui visualisait les chiffres avec des sensations, et une étude canadienne sur une synesthète C. montrent que la synesthésie aide la mémorisation, en particulier lorsque les couleurs des chiffres correspondent à la perception synesthésique. Les propres tests de Tammet ont confirmé l’importance de la « conforme » (tailles et couleurs) à sa synesthésie pour une meilleure mémorisation.
- Sommeil : Une bonne nuit de sommeil est essentielle pour la consolidation des souvenirs.
- Déclencheurs et contexte : Les déclencheurs (odeurs, sons, mots) et le contexte de création d’un souvenir facilitent sa remémoration.
- Déformations de la mémoire : La mémoire est sujette aux déformations. Frederic Bartlett a montré comment les souvenirs d’événements complexes sont influencés par nos croyances et déductions. L’expérience de Roediger et McDermott sur les mots associés au « sucré » illustre comment le cerveau peut « se souvenir » de mots non présents, en activant des catégories générales. Les autistes savants, avec leur perception plus fine des détails, seraient moins sujets à ces généralisations inconscientes. Les études d’Elisabeth Loftus sur les témoins oculaires montrent comment le langage peut altérer les souvenirs (ex: verbes différents modifiant l’estimation de la vitesse d’un accident et la « vision » de verre brisé). Les « faux souvenirs » sont des événements rappelés avec des détails vivaces mais qui n’ont jamais eu lieu (ex: l’histoire d’Anastasia Schanzkowska).
- L’Oubli : Hermann Ebbinghaus a montré que le taux d’oubli est exponentiel : rapide au début, puis il se stabilise. La théorie de la désagrégation est obsolète car elle n’explique pas l’oubli et ignore qu’un souvenir peut réapparaître. La théorie du refoulement de Freud, sans preuves scientifiques, est également sceptique. L’interférence (proactive et rétroactive) est une explication clé de l’oubli, où de nouvelles informations interfèrent avec les anciennes, ou vice-versa. Cependant, l’oubli n’est pas toujours une mauvaise chose ; William James le considère aussi important que le souvenir, aidant à prévenir les informations erronées et à éviter la surcharge. Jorge Luis Borges, dans Funes ou la Mémoire, décrit un personnage incapable d’oublier, dont l’esprit est « encrassé de milliers de détails inutiles » l’empêchant de généraliser ou de penser par lui-même.
- Vieillissement et mémoire : Le vieillissement peut affaiblir la mémoire, mais son impact est inégal. Les personnes âgées peuvent compenser par leurs vastes connaissances et une approche imaginative, surtout si elles reçoivent des indices. Elles excellent souvent en tant que conteurs, transmettant savoirs et idées, comme les tribus amérindiennes. Les ordinateurs sont de « pauvres substituts » de la mémoire humaine, qui est riche en sophistication, contexte et relations. Le souvenir est essentiel à l’humanité, « terreau » du présent et du futur.
Le Monde des Mots : Daniel Tammet se décrit comme un « linguophile », un amoureux des mots et du langage, capable de parler de nombreuses langues pour leur beauté et leur utilité. Il apprécie l’humour et les subtilités lexicales de l’espéranto, et souligne que les langues sont « reliées inextricablement à toutes nos expériences quotidiennes », aidant à comprendre ce que signifie être humain.
- La richesse illimitée du langage : La langue anglaise, considérée comme la plus riche lexicalement, compte environ 300 000 mots différents. Le nombre de mots et de phrases est illimité grâce au pouvoir combinatoire des règles de construction et des affixes. Il cite l’exemple d’une comptine anglaise pour illustrer les phrases « potentiellement infinies ». Malgré cette complexité, la capacité humaine à acquérir et utiliser le langage est un « exploit intellectuel époustouflant » accessible à tous.
- L’instinct du langage : Les psychologues estiment le vocabulaire moyen d’un lycéen américain à 45 000 mots, soit trois fois plus que Shakespeare, acquis à une vitesse impressionnante (7 à 8 mots par jour). L’auteur décrit les stades d’acquisition du langage chez l’enfant (pré-linguistique, un mot, syntaxique), montrant une maîtrise précoce des principes de formation des phrases. Darwin et Noam Chomsky soutiennent l’idée d’un « équipement inné » ou d’une « grammaire universelle » dans le cerveau facilitant l’acquisition du langage. Des cas cliniques, comme l’aphasie de Broca (dommage au lobe frontal gauche affectant la grammaire sans altérer la cognition générale) ou le syndrome de Williams (compétences langagières amplifiées malgré une déficience mentale), corroborent l’existence de zones cérébrales dédiées au langage.
- Universalité des langues : Joseph Greenberg a répertorié 45 « universaux linguistiques » (ordre sujet-verbe-objet, place des adjectifs, genres, termes de couleurs, antonymes, « parler bébé », etc.), montrant des similarités profondes entre des milliers de langues. Donald E. Brown, dans « Les universels humains », a identifié des milliers de caractéristiques comportementales universelles, soulignant que nous devrions chercher ce qui unit les cultures plutôt que ce qui les divise.
- Apprendre une langue étrangère : L’acquisition d’une deuxième langue est souvent jugée difficile. Tammet démystifie l’idée d’une « période critique » biologique pour les langues étrangères ; bien que peu d’adultes atteignent la maîtrise de leur langue maternelle, il existe un pourcentage qui y parvient. Des études montrent que le cerveau adulte peut « se réentraîner » à distinguer de nouvelles sonorités (ex: r/l pour les Japonais). La deuxième langue peut être gérée par une zone différente du cerveau si elle est apprise à l’âge adulte. Les personnes bilingues ont un « avantage flagrant » sur les monolingues, avec une meilleure abstraction, concentration et mémoire à court terme.
Clés du succès multilingue :
- Sons (phonétique) : S’entraîner avec des phrases répétitives, chanter des chansons dans la langue cible, et maîtriser l’accent tonique.
- Mots (morphologie) : Étudier la façon dont les sons s’assemblent en syllabes et mots. Comprendre la « théorie de la cohorte » (le cerveau anticipe les mots à partir des premiers sons).
- Vocabulaire : Les listes des 100 mots les plus courants sont insuffisantes car ils apportent peu d’information. Tammet propose :
- Apprendre des onomatopées.
- Utiliser le symbolisme phonétique (sons associés à un sens spécifique, ex: « gl- » pour lumière en anglais).
- Établir des associations entre mots (grappes de mots, similarités avec la langue maternelle). Attention aux « faux amis ».
- Apprendre des paires de mots indissociables (expressions).
- Mots composés (ex: islandais « járnbraut » pour « chemin de fer »).
- Système des affixes (préfixes, suffixes).
- Apprendre les mots avec plusieurs définitions selon le contexte.
- Gérer les genres (associer l’article, ou nom + adjectif).
- Phrases (syntaxe) : La lecture est essentielle pour apprendre les mots dans leur contexte et construire ses propres phrases, évitant l’apprentissage mot à mot « artificiel et fragmentaire ».
Langues Oubliées : Des Voix qui Disparaissent : Tammet exprime sa tristesse face à la disparition de près de la moitié des six mille langues parlées dans le monde, certaines n’étant parlées que par une dizaine de personnes. On estime que 90% des langues pourraient disparaître ce siècle, une « perte catastrophique » comparable à la perte de la biodiversité. La mort de Marie Smith Jones, la dernière locutrice de l’eyak, est un exemple poignant. Ce déclin est dû à la perception des langues minoritaires comme inférieures, à l’oppression politique et à la propagation des médias électroniques. Bien que certaines disparitions soient naturelles, Tammet souligne l’importance morale et pratique de préserver ces langues car elles sont des « moyens de transmission de la culture », de savoirs uniques sur la nature, et de « cultures orales riches ». Il est optimiste, citant la renaissance réussie du mannois, du cornique et surtout de l’hébreu. Pour Tammet, « la disparition des langues fait partie d’un phénomène plus général dont le monde souffre : la fin de la diversité ».
L’Instinct des Nombres et la Pensée Mathématique 🔢💡
Daniel Tammet est fasciné par la beauté, l’ordre et la complexité des nombres, qu’il perçoit comme des figures complexes interagissant pour donner des résultats de calcul. Il propose l’hypothèse que la plupart des individus naissent avec un instinct inné des nombres, analogue à l’instinct du langage. Il rejette la comparaison des capacités numériques des autistes savants au fonctionnement d’un ordinateur, arguant qu’elles sont une variante d’un calcul mental que chacun exécute quotidiennement.
Tout le monde sait compter :
- Bébés compteurs : Les recherches de Karen Wynn ont montré que des bébés de 5 mois savent compter et faire la différence entre des quantités (8 et 16 points), réfutant l’idée d’un cerveau « vierge » à la naissance. Elizabeth Spelke a étendu ces résultats, suggérant un « système spécifique » du cerveau dédié aux nombres, distinct des capacités de raisonnement général.
- Cas cliniques : La signora Gaddi, devenue acalculique après une crise cérébrale mais capable de fonctionner normalement, et « Monsieur Bell », atteint de maladies dégénératives mais conservant ses facultés de calcul, corroborent l’idée d’un instinct inné des nombres.
- Subitisation et particularités linguistiques : L’humain a une capacité universelle à reconnaître instantanément de petites quantités (1 à 4 objets), appelée « subitisation ». Beaucoup de langues traitent différemment les premiers chiffres (ex: en gaélique d’Écosse, en islandais, en anglais avec « first », « second », « third »). Cela suggère que le cerveau perçoit les petites quantités comme des caractéristiques « spécifiques et palpables » des groupes d’objets.
- Preuves historiques et anthropologiques : Des symboles de comptage sumériens et babyloniens (3000 av. J.-C.) et des inscriptions bâtonnets sur des os/grottes (30 000 av. J.-C.) indiquent que l’instinct des nombres est aussi ancien que le langage et la créativité. Des tribus (ex: Kuuk Thaayorre, Oksapmin en Papouasie-Nouvelle-Guinée) ont des systèmes de comptage variés, utilisant des parties du corps, prouvant l’universalité de cet instinct. L’étymologie de mots comme « four », « five » (doigts) ou « ten » (deux mains) dans les langues européennes soutient cette idée.
- Systèmes de comptage : Les mots européens pour compter de 11 à 19 et les dizaines peuvent entraver la compréhension précoce du système décimal par rapport aux langues asiatiques. Le système décimal (base 10) est lié à nos dix doigts, mais d’autres systèmes (duodécimal, vigésimal, mayas) ont existé, indiquant une invention spontanée de méthodes de calcul à travers le monde.
Des chiffres plein la tête : Comment les chiffres sont-ils représentés dans le cerveau ? Tammet explore l’idée d’associations spécifiques.
- Ligne numérique mentale : Robert Moyer et Thomas Landauer ont découvert en 1967 que les adultes mettent plus de temps à comparer des chiffres proches (5 et 6) que des chiffres éloignés (2 et 9), suggérant une « ligne numérique mentale » dans le cerveau. Cette ligne compresse les grands nombres dans un espace réduit. Stanislas Dehaene a identifié le « phénomène de spatialisation numérique » (SNARC effect), montrant que cette ligne va de gauche à droite, mais dépend de la culture (ex: Iraniens lisant de droite à gauche).
- Représentations synesthésiques : 10 à 15% des gens ont une ligne numérique mentale, et une plus petite proportion perçoit les nombres avec des couleurs, textures ou une personnalité. Francis Galton a été le premier à documenter ce phénomène en 1880, révélant une grande variété de représentations. Ces lignes peuvent même aider au calcul, comme pour une femme qui visualise des lignes de chiffres pour compter sa monnaie.
Comment Daniel Tammet calcule :
- Critique des théories alternatives : Tammet rejette « l’hypothèse de Sacks » (comptage instantané des points/allumettes), car aucune expérience scientifique n’a pu le prouver, y compris les tests de Snyder avec la stimulation magnétique transcrânienne (TMS). Il critique aussi la théorie plus spéculative de Diane Powell et Ken Hennacy sur la « mécanique quantique » et le « niveau quantique de conscience », la jugeant sans preuves concrètes. Pour Tammet, comme pour le philosophe Peter Slezak, les capacités des savants sont comparables à la complexité du langage que chacun utilise instinctivement.
- L’analogie langage-mathématiques de Tammet : Sa propre explication s’inspire de l’analogie entre mathématiques et langage. Ses capacités numériques sont liées à la région cérébrale responsable de l’organisation syntaxique (formation des phrases).
- Proximité des zones : Le lobe pariétal gauche (nombres) et le lobe frontal gauche (langage) sont côte à côte. Ses capacités de segmentation et manipulation de formes numériques mentales sont analogues à celles des mots et groupes de mots pour créer des phrases.
- Ses capacités linguistiques : Il parle une douzaine de langues, en acquiert rapidement (islandais en une semaine), et crée même sa propre langue (le mänti). Cela suggère un lien sous-jacent entre ses habiletés linguistiques et numériques.
- Rapidité et inconscience : Ses calculs sont rapides, intuitifs et largement inconscients, comme les « calculs » syntaxiques du cerveau pour produire des phrases.
- Syntaxe numérique : Pour Tammet, les nombres ont des images mentales et des « relations sémantiques » avec d’autres nombres, contrairement à la plupart des gens. Ses images mentales de nombres ont des tendances (ex: 1 est brillant, 11 est rond et brillant), et son cerveau utilise des perceptions synesthésiques et des capacités combinatoires pour générer des milliers de formes numériques, comme les langues génèrent des mots à partir de lettres et de sons.
- Calcul au-delà du vocabulaire : Il explique comment il résout des calculs avec des nombres supérieurs à son « vocabulaire numérique » (10 000) en les découpant en morceaux connus, comme on déduit un mot inconnu (« agedness ») à partir de ses composantes (adjectif « aged » + suffixe « ness »). Par exemple, 37 x 469 est découpé en [37 x 169] + [37 x 300].
- Factorisation et nombres premiers : Il a une capacité essentielle de factorisation (trouver les nombres premiers diviseurs), qu’il voit comme une segmentation de formes numériques sémantiques (ex: 6253 = 13 x 13 x 37). Il peut reconnaître des nombres premiers de cinq à huit chiffres intuitivement, comme on reconnaît l’appartenance d’un mot inconnu à une langue. Il admet que son intuition n’est pas infaillible et qu’il peut faire des erreurs, contrairement au mythe des savants.
La beauté des mathématiques : Les nombres sont un refuge pour les autistes, un « univers intérieur de logique, d’ordre et de beauté » dans un monde souvent chaotique.
- Nombres premiers : Il existe une infinité de nombres premiers, qui, bien que « distribués au hasard », peuvent former des motifs, comme la Spirale d’Ulam. Les nombres premiers sont utiles en cryptographie (système RSA pour les cartes bancaires en ligne).
- Théorie des réseaux (« Small-World Phenomenon ») : Décrite par Frigyes Karinthy, cette théorie suggère que chaque individu sur Terre est relié par l’intermédiaire de cinq connaissances à un autre. L’expérience de Stanley Milgram a montré que le nombre moyen d’intermédiaires est de cinq ou six. Des calculs simples prouvent que six degrés de séparation suffisent à couvrir la population mondiale actuelle. Le « Small World Project » de l’Université de Columbia a confirmé que le nombre moyen de liens entre deux personnes est effectivement de 6. Ce phénomène se retrouve dans divers réseaux (électrique, internet, cerveau, génome). Steven Strogatz et Duncan Watts ont montré qu’un petit nombre de raccourcis suffisent à relier des grappes d’éléments, comme des acteurs de cinéma (Hitchcock à Demi Moore en 3 étapes) ou des neurones. Le monde est « beaucoup plus petit et plus numérique qu’il en a l’air ».
La Pensée Critique et la Consommation de l’Information 🤔🌐
Dans une ère où l’information prolifère comme jamais auparavant, Daniel Tammet nous invite à développer une pensée critique. Il cite H.G. Wells, qui prédisait que la pensée statistique serait « un jour aussi nécessaire au citoyen que savoir lire et écrire ». L’incapacité à comprendre les chiffres est un « handicap aussi profond que l’analphabétisme ».
Les Statistiques : Une Gymnastique de l’Esprit :
- L’Innumératie : John Allen Paulos définit l' »innumeracy » (inaptitude au calcul) comme « l’analogue de l’analphabétisme », qui « nous prive de la compréhension et nous rend incapable de prendre de bonnes décisions ».
- Exemples d’erreurs statistiques : Tammet déconstruit une affirmation sur le doublement annuel des blessés par armes à feu depuis 1950, montrant qu’une simple projection mène à des chiffres absurdement supérieurs à la population mondiale, prouvant que la donnée est fausse. Il propose d’associer les grands nombres à des images concrètes (romans, bibliothèques) ou au temps pour mieux les comprendre.
- Moyenne, médiane, mode : Il explique ces trois concepts clés des statistiques, illustrant avec un exemple de salaire comment la « moyenne » peut être trompeuse et comment la « médiane » ou le « mode » peuvent être plus honnêtes.
- Biais d’échantillonnage : L’exemple du sondage présidentiel américain de 1936 par Literary Digest vs. George Gallup est frappant. Le magazine, malgré un énorme panel, a prédit la mauvaise victoire car son échantillon était biaisé (lecteurs riches et conservateurs, possesseurs de téléphone). Gallup, avec un échantillon plus petit mais représentatif, a eu raison. La controverse autour de l’échantillonnage lors du recensement américain de 2000, motivée par des enjeux politiques, est un autre exemple.
- Corrélation vs. Causalité : Il met en garde contre la confusion entre corrélation et causalité, comme dans l’exemple du petit déjeuner et des bonnes notes, où d’autres liens ou l’absence de lien peuvent exister.
- Probabilités et intuition : Les résultats des probabilités sont souvent contre-intuitifs. Il cite « l’illusion du joueur » (penser qu’un événement rare est plus probable après une série), le paradoxe de l’anniversaire (23 personnes dans une pièce, plus de 50% de chances que deux aient le même anniversaire), et la victoire successive d’un général (le hasard peut produire des séries impressionnantes).
- Loterie : L’histoire d’Evelyn Adams, gagnante deux fois au Loto, montre que la probabilité est beaucoup plus élevée si l’on considère les millions de joueurs et de tirages. Les chances de gagner au Loto sont extrêmement faibles (moins de 1 sur 14 millions), bien moins probables que d’être foudroyé ou tué par une piqûre d’abeille. L’auteur déconseille les jeux d’argent car le retour sur investissement est misérable. Il donne des conseils pour maximiser le montant du gain (pas la chance de gagner) en évitant les combinaisons populaires (dates d’anniversaire, suites de chiffres).
- Système électoral américain : Il analyse l’élection présidentielle de 2000 (Bush vs. Gore) pour défendre le système du Collège électoral. Malgré le vote populaire en faveur de Gore, Bush a gagné grâce aux grands électeurs. Tammet défend ce système comme un compromis historique qui « rééquilibre le pouvoir de chaque individu » en donnant plus de poids à un vote au niveau de l’État qu’au niveau national.
- Raisonnement fallacieux : L’auteur met en garde contre la simplification excessive. Il corrige la mauvaise interprétation du principe d’Occam (« entre plusieurs explications, la plus simple est toujours la meilleure »), qui ne s’applique que si les théories mènent aux mêmes conclusions. Il critique les croyances basées sur l’émotion plutôt que sur le calcul.
- Prévisions et séries : Il déconstruit les peurs de la surpopulation mondiale, citant l’histoire (Euripide, Malthus) et montrant que la croissance exponentielle ne peut se poursuivre indéfiniment, avec des taux de natalité chutant et des prévisions révisées à la baisse. La planète est assez vaste pour tout le monde, et les avancées médicales expliquent l’augmentation de la population, non un manque de contrôle.
- « Effet Jeane Dixon » : Il explique comment les prévisions (ex: voyante Jeane Dixon pour JFK) peuvent sembler justes par un mécanisme de sélection des succès et d’oubli des échecs. Le hasard ne semble pas toujours hasardeux.
- Biais de publication : Les scientifiques peuvent être sujets à des « publications biaisées », où ils rejettent des données contredisant leurs recherches antérieures pour obtenir des résultats positifs. Les médias accentuent cette tendance en privilégiant le drame.
- « Dessin intelligent » : L’erreur de supposer que l’ordre de l’Univers ne peut pas surgir par hasard. Il cite le nombre pi (série infinie de chiffres aléatoires contenant des motifs impressionnants comme « 999999 » ou « 12345678 »), et la « théorie de Ramsey » qui montre que des motifs existent toujours dans des séries aléatoires suffisamment importantes.
- Logic et Pensée Critique : Tammet termine par l’importance de la logique. Il utilise un problème de Lewis Carroll pour montrer comment déduire une conclusion valide à partir de prémisses. Il applique cette méthode à une proposition sur les régimes, montrant qu’une prémisse fausse invalide toute l’argumentation. Il énumère des « raisonnements fallacieux » courants : ad populum (appel à l’émotion), ad hominem (attaque personnelle), l’homme de paille (caricaturer l’argument), fausse analogie, raisonnement circulaire. Carl Sagan encourage la « science qui nous permet de détecter les idioties », en se fiant aux arguments clairs et précis plutôt qu’aux conclusions plaisantes. La logique ne coupe pas de l’amour ou de la foi, mais aide à « garder les pieds sur Terre ».
La Consommation de l’Information et l’Avenir de l’Esprit 🚀✨
Notre « corps a besoin de nourriture », notre cerveau d' »informations ». À l’ère d’Internet, de la publicité omniprésente et de l’actualité en continu, le « trafic entre notre monde intérieur et le monde extérieur n’a jamais été aussi intense ».
La Saveur des Mots :
- Langage et pensée : Les mots sont des « atomes du savoir » qui peuvent aiguiser ou calibrer notre imaginaire. Orwell, dans 1984, a imaginé la « Newspeak », une langue propagandiste visant à « réduire l’éventail de la pensée » en censurant des mots, croyant que si une chose ne peut être dite, elle ne pourra plus être pensée. Le « Basic English » (850 mots) de Charles Ogden était une tentative réelle de simplifier la langue, mais a échoué. Orwell critiquait l’anglais moderne pour ses « métaphores à l’agonie » et ses « prothèses verbales », affirmant que « si la pensée corrompt le langage, le langage peut aussi corrompre la pensée ». Ses six règles pour une bonne écriture sont intemporelles.
- Verbiage et euphémismes : Alan Sokal critique le « verbiage » de certains intellectuels, comme Jacques Lacan, dont les textes sont souvent abscons. L’euphémisme, utilisé pour adoucir des propos, est courant en politique (« croissance négative » pour récession, « dommages collatéraux » pour civils tués). Geoffrey Nunberg met en garde contre les mots simples et inoffensifs, plus difficiles à décrypter. Diane Ravitch dénonce la « police du langage » dans les publications scolaires, qui, par excès de prudence, aboutit à des textes fades et simplistes.
- Le cadrage linguistique : George Lakoff montre comment certaines expressions, comme « bouclier fiscal », créent inconsciemment une histoire avec des rôles (héros, victime, méchant) qui influencent notre perception. Lakoff est pessimiste sur l’importance de la réalité face à la perception, critiqué par Steven Pinker pour son « relativisme cognitif ». Michael Silverstein souligne que le langage est efficace s’il est porté par un « vrai message » et une conviction, comme le discours de Lincoln.
Les Fast-foods de la Pensée :
- Commérage et légendes urbaines : Tammet, qui ne pratique pas le commérage, s’interroge sur son utilité. Robin Dunbar compare le bavardage humain à l’épouillage chez les primates, y voyant un moyen de souder la communauté. Les recherches montrent que les ragots sont majoritairement positifs et stimulent la mémoire. Cependant, il existe des formes nuisibles comme les « légendes urbaines » (ex: alligators dans les égouts de New York), des histoires douteuses mais présentées comme véridiques, reflétant les peurs de l’époque.
- Mythes populaires et désinformation : Tammet déconstruit le mythe des « 10% du cerveau » (réfuté par les maladies neurologiques et l’évolution). Plus grave, la rumeur non fondée liant le vaccin ROR à l’autisme, propagée par Andrew Wakefield, a conduit à une augmentation des cas de rougeole en Angleterre, illustrant les « conséquences terribles de la diffusion à grande échelle d’une information trompeuse ou erronée ».
- La propension à croire : Une étude par IRMf (Harris, Sheth, Cohen) a montré que le cerveau évalue plus rapidement les déclarations considérées comme vraies, confirmant la théorie de Spinoza : nous considérons tacitement toute affirmation comprise comme crédible, le rejet demandant un effort conscient. Nous acceptons les apparences « jusqu’à preuve du contraire ». L’esprit critique demande un « effort de remise en cause permanente ».
Dépasser l’Écœurement de l’Information :
- Surcharge informationnelle : L’abondance d’informations (magazines, TV, e-mails, blogs) a des avantages, mais « l’excès en tout est un défaut ». Cette surcharge « ronge lentement la vigueur et la rigueur de notre vie mentale », entraînant insomnie, mauvaise concentration, irritabilité, erreurs, et distraction (ex: 15 minutes pour se reconcentrer après une interruption d’e-mail). Le coût financier de la perte de productivité est estimé à 650 milliards de dollars par an.
- Stratégies d’adaptation :
- Technologiques : Utiliser des filtres anti-spam, ne pas répondre aux e-mails inconnus, protéger son adresse.
- Lifelogging : Gordon Bell archive son existence sur ordinateur, le considérant comme un « cerveau de substitution ». Tammet critique cette approche, insistant sur l’importance de l’oubli pour pardonner et l’impact négatif sur la mémoire humaine (moins de 40% des jeunes se souviennent des dates d’anniversaire, un tiers de leur propre numéro de téléphone). La comparaison du cerveau aux systèmes de stockage informatiques « appauvrit la compréhension de l’humain ».
- Personnelles : Établir des frontières entre vie privée et professionnelle (éteindre son téléphone après le bureau, consulter les e-mails moins souvent).
- Recherche méthodique : Utiliser des guillemets dans les moteurs de recherche pour des requêtes précises.
- Retour aux bibliothèques : Les bibliothèques, avec leur « classification décimale de Dewey », offrent une information organisée de façon claire et intuitive, favorisant une architecture spatiale cohérente du savoir.
- Information vs. Idée : La confusion entre ces deux concepts est problématique. Selon Theodore Roszak, l’esprit pense avec les idées, non les informations. Les idées « définissent l’information, lui donnent sens et la génèrent », et les plus fondamentales (comme « tous les hommes sont égaux ») sont issues d’une « sensibilité humaine innée ». Richard Feynman illustre cela en montrant qu’énumérer les noms d’un oiseau dans différentes langues ne remplace pas une compréhension réelle de l’oiseau lui-même. Il est vital de considérer chaque information comme une pièce d’un puzzle géant, non comme une fin en soi. « On ne vit pas pour être informé ».
L’Avenir de l’Esprit Humain : Optimisme et Réalisme 🚀✨
Le dernier chapitre de « Embrasser le ciel immense » se tourne vers l’avenir, interrogeant les prédictions des « futurologues » sur les avancées médicales et technologiques. Tammet évalue leur souhaitabilité et leur réalisme, tout en partageant ses propres idées sur le futur de la compréhension, des sentiments et de l’imagination humaine.
Le « Casque des Génies » (TMS) :
- Théorie de Snyder : Allan Snyder, avec son casque TMS (stimulation magnétique transcrânienne), prétend que cette invention permettrait aux individus « lambda » d’acquérir temporairement des capacités savantes en ralentissant l’activité de l’hémisphère frontal gauche, qui filtre les calculs sensoriels bruts. Cela donnerait un « accès privilégié » à des processus habituellement inaccessibles.
- Critiques de Tammet : Tammet trouve cette théorie « problématique ». Elle n’explique pas la créativité des savants de haut niveau (Gilles Tréhin et sa ville utopique, Matt Savage et ses compositions jazz originales). Ses propres capacités mathématiques sont le résultat d’une hyperconnectivité cérébrale, une caractéristique souvent présente chez les autistes, et qui pourrait être la clé d’autres capacités savantes, réfutant l’idée d’un simple mécanisme d' »équipartition ».
- Doutes scientifiques : Les expériences de Young et Ridding (2000) n’ont montré des améliorations temporaires que chez 2 des 17 volontaires, et les capacités étaient mineures (dessin d’animaux, détection de coquilles, comptage de points), sans complexité ou créativité. Des neurologues comme Eric Wassermann et Darold Treffert (expert du syndrome savant) sont sceptiques, affirmant qu’aucun « génie soudain » n’a jamais été révélé par la TMS, et que la probabilité d’émergence de capacités savantes significatives après 10 ou 20 minutes de stimulation est « égale à zéro ».
- Promesses médicales : Cependant, la TMS reste prometteuse pour le traitement de maladies neurologiques comme l’épilepsie et la schizophrénie, réduisant la fréquence des crises et les hallucinations auditives.
Les Stimulants du Cerveau (« Pilules de l’Intelligence ») :
- Un marché gigantesque : Des compagnies travaillent sur des médicaments pour améliorer la mémoire et les compétences mentales, avec un marché potentiel de millions de patients atteints d’Alzheimer, de déficiences cognitives légères ou de déclin de mémoire lié à l’âge. Les ventes de compléments comme la vitamine B12 ou le ginkgo biloba, dont l’efficacité est scientifiquement faible, dépassent déjà le milliard de dollars.
- Questions éthiques et efficacité : Leon R. Kass, directeur du Conseil présidentiel de la bioéthique, s’inquiète de l’utilisation banalisée de ces traitements à des fins non médicales, considérant que « l’excellence est le fruit de l’effort, du talent et de la discipline ; avaler un médicament [pour réussir] équivaut à de la tricherie ». Steven Rose critique les tests sur des rats (qui pourraient juste augmenter la motivation de l’animal) et les rares tests sur des humains (petits groupes, évaluation subjective, facteurs secondaires comme la réduction de l’anxiété). Une étude de 1998 a montré que la caféine était aussi efficace que le Modafinil (une « pilule de l’intelligence ») pour maintenir les facultés cognitives après 40 heures de veille.
- Dangers et éthique : Les chercheurs s’inquiètent des dangers à long terme et des effets secondaires potentiels de ces produits (ex: patch de nicotine efficace pour la cognition mais trop dangereux pour les effets secondaires). L’utilisation de drogues pour augmenter les performances n’est pas nouvelle (café, tabac, amphétamines, bêta-bloquants par les musiciens). Eric Kandel, prix Nobel, est consterné par l’idée que des étudiants utilisent ces substances pour les notes, insistant qu’elles sont destinées aux maladies graves et que les risques pour les individus sains ne valent pas la peine.
Des Cerveaux Hybrides (« Cyborgs ») :
- Fusion homme-machine : L’histoire de Johnny Ray, capable de contrôler un curseur d’ordinateur par la seule pensée grâce à un implant, le transformant en « premier Cyborg du monde » selon certains, illustre la possibilité de connecter l’esprit à la machine. Des singes contrôlent des flippers numériques mentalement, et des appareils permettent d’allumer des lumières par des ordres mentaux. Des roboticiens comme Kevin Warwick fantasment sur la fusion homme-machine pour « mettre à jour » l’humanité, citant son expérience de transmission télépathique avec sa femme via Internet. Ray Kurzweil, « cyber-gourou », prédit la gravure de personnalités sur des disques durs pour une « immortalité virtuelle ».
- Critiques du transhumanisme : Les prédictions de Warwick et Kurzweil sont vivement critiquées. Inman Harvey les qualifie de « charlatan » et de « ridicules ». Tammet et d’autres doutent de la vraisemblance du « téléchargement de l’identité » car l’esprit est trop complexe et influencé par l’émotion pour être réduit à des « données informatiques ».
- La cognition incarnée : Michael Chorost, auteur d’une autobiographie sur son implant cochléaire, critique le « techno-optimisme prétentieux ». Son implant l’a rendu plus humain, non l’inverse, car il a compris que la communication humaine va au-delà de l’échange de données, intégrant sentiments et croyances. La cognition incarnée souligne comment notre corps et nos gestes (ex: manipulation de lettres au Scrabble, processus d’écriture) structurent la pensée. Être pourvu d’un corps « sensible et vulnérable » nous engage à réfléchir aux conséquences de nos choix. Tammet est « scandalisé » par l’idée de « mettre à jour » son humanité imparfaite, doutant qu’une machine puisse reproduire la richesse de l’intelligence humaine. Ces visions « fantaisistes » sont, selon lui, le produit de « l’angoisse » plutôt que de l' »ambition ».
Un Futur Plus Humain : Tammet envisage un futur où les avancées médicales et technologiques continueraient d’améliorer nos vies sans effacer la frontière entre l’homme et la machine.
- Nouveaux traitements : De nouveaux traitements intelligents et efficaces pour les maladies neurologiques (épilepsie, schizophrénie, Alzheimer, autisme, dépression) sont en développement. La réalité virtuelle aide déjà les enfants autistes à apprendre des tâches quotidiennes et à traverser la route. Un vaccin contre Alzheimer, stimulant le système immunitaire pour éliminer les plaques cérébrales, est une piste prometteuse. La « LifeShirt » surveille les mouvements et données physiologiques pour diagnostiquer les troubles bipolaires et la schizophrénie.
- Cartographie cérébrale : L’IRMf permet de visualiser l’afflux sanguin dans le cerveau, aidant à cartographier les régions impliquées dans les processus mentaux. Des programmes informatiques analysent ces données pour comprendre comment les activités neuronales fusionnent pour créer notre perception du monde. Jack Gallant et son équipe ont pu « lire » quelle image des sujets regardaient à partir de leur activité cérébrale, espérant l’appliquer à l’attention, l’imagination ou le rêve.
Tammet conclut en insistant sur l’importance d’un « changement des mentalités » par rapport à la « différence ». Il déplore que les autistes savants aient été considérés comme des « curiosités » ou des « ordinateurs-robots », des « aberrations de la nature », alors que c’est leur « humanité qui rend possibles de telles capacités ». Il exprime l’espoir que les « idées fausses, déformantes et péjoratives » disparaîtront, permettant à « tous les esprits, quelles que soient leurs différences, de se rencontrer et de bâtir ensemble l’avenir ».
En Bref : La Richesse Infinie de l’Esprit Humain 🌟🧠
« Embrasser le ciel immense » n’est pas seulement le récit fascinant des capacités hors du commun de Daniel Tammet, mais une véritable déclaration d’amour à l’esprit humain dans toute sa diversité. À travers ses propres expériences, les dernières découvertes neuroscientifiques et une analyse rigoureuse des concepts d’intelligence, de mémoire et de créativité, Tammet déconstruit les mythes et les préjugés.
Il nous rappelle que le génie ne réside pas dans une élite de quelques cerveaux « différents », mais dans la capacité de chacun à cultiver la passion, la persévérance, l’imagination et l’intuition. Le livre est un plaidoyer vibrant pour la pensée critique, la curiosité et l’ouverture d’esprit face au flot incessant d’informations de notre monde moderne. En fin de compte, Daniel Tammet nous encourage à embrasser notre propre singularité et à utiliser notre cerveau non pas comme une machine, mais comme un organe vivant et dynamique capable d’imaginer un « futur fécond pour nos esprits si différents les uns des autres ». Un chef-d’œuvre qui, comme le cerveau, est « plus vaste que le ciel » et « plus profond que la mer ».