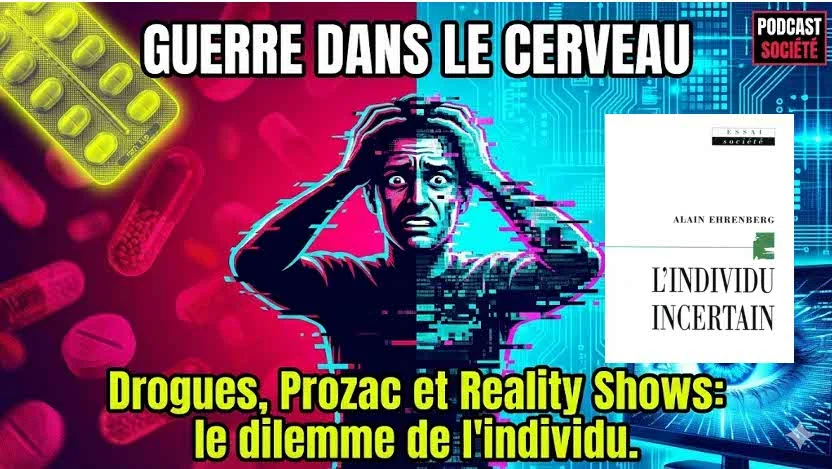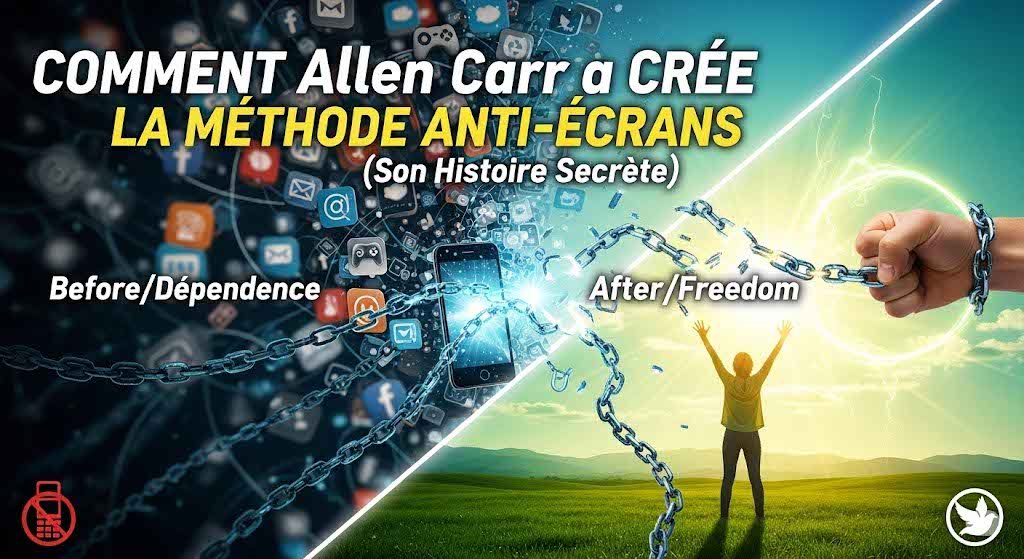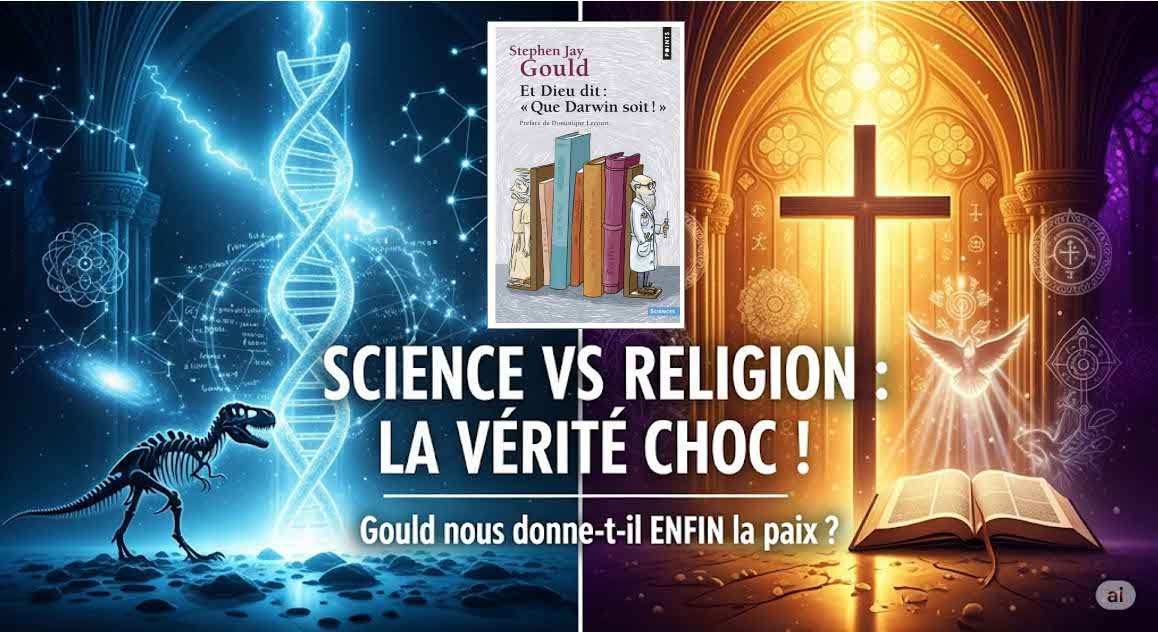Les liens pour vous procurer les différentes versions
📗Lien vers le livre papier : https://amzn.to/3HWhFrr
📕Lien vers l’ebook : https://amzn.to/3HZqoch
La Culture Nous Sauvera : Un Plaidoyer Urgent pour l’Âme de la France 🇫🇷
Dans un monde en constante mutation, où les repères semblent parfois s’effacer, un ouvrage audacieux, « La culture nous sauvera », signé par Christophe Tardieu et David Lisnard, s’impose comme un manifeste vital pour la France. Ce livre ne se contente pas de dresser un constat alarmant des multiples fractures qui traversent la société française – morales, sociales, économiques, identitaires, territoriales, numériques – mais propose aussi une voie de salut inattendue : la culture. Plus qu’une simple activité économique, la culture est présentée comme le trésor caché que nous pourrions découvrir « chaque fois que [nous en avons] besoin », un élément consubstantiel à notre pays, à notre peuple et à notre nation. Ce résumé et cette analyse vous plongeront au cœur de ses arguments, soulignant pourquoi ce message est plus pertinent que jamais.
Un Trésor National en Péril et une Solution Oubliée ✨
La France est en crise. Un mal-être profond, psychique et social, ronge la société. Le pays est décrit comme « archipellisé », confronté à une France périphérique en souffrance durable, et un sentiment de guerre civile latente. Les institutions républicaines semblent se déliter, menaçant nos droits, nos devoirs et notre force spirituelle collective. La nation est fragilisée, témoin d’attaques sectaires contre l’histoire, la langue et la transmission du savoir, sous l’étendard de la « cancel culture ». Face à ce tableau sombre, les auteurs proposent une solution, souvent méconnue et sous-estimée : le secteur culturel.
L’Impact Économique Méconnu de la Culture 💰
Contre toute attente, la culture est un poids lourd de l’économie française. Qui sait que le PIB des industries culturelles en France atteint 2,3 % du PIB national ? Que son chiffre d’affaires (45 milliards d’euros) est supérieur à celui de l’industrie automobile et pharmaceutique ? Que le secteur emploie 620 000 personnes directement, et le double si l’on inclut les revenus liés aux activités culturelles ? Le tourisme culturel est également un pilier : près des deux tiers des 90 millions de touristes annuels avant le Covid-19 avaient effectué au moins une visite culturelle, dépensant 42 milliards d’euros. Les biens culturels français affichent une croissance à l’exportation deux fois supérieure à celle des autres biens de consommation.
La France possède des atouts culturels « gigantesques ». Le ministère de la Culture, créé en 1959 par de Gaulle et confié à André Malraux, fut l’un des premiers au monde. Le pays abrite les plus importants établissements publics culturels de la planète :
- Le Louvre, premier musée universel mondial avec près de 10 millions de visiteurs par an.
- Versailles, le château le plus visité.
- Le musée d’Orsay, avec une des plus belles collections impressionnistes.
- Le musée du Quai Branly, plus grand lieu dédié aux arts premiers de l’hémisphère nord.
- L’Opéra de Paris et le Centre Pompidou, parmi les cinq premiers mondiaux.
- Un « nombre vertigineux » de salles de théâtre, de danse et d’Opéras en région.
Dans les industries culturelles, la France brille :
- Cinéma français, troisième mondial (derrière les États-Unis et l’Inde qui ne produit que pour son marché national), avec le plus grand réseau de salles en Europe et des Français « le peuple le plus cinéphile ».
- Production audiovisuelle en forte progression à l’exportation.
- Édition de livres et de musique : Hachette Livre est le troisième groupe d’édition mondial, Universal Music le premier éditeur de musique avec 30 % de part de marché mondial.
- Festivals renommés : Cannes (cinéma), Avignon (théâtre francophone), Aix-en-Provence (art lyrique), Clermont-Ferrand (courts-métrages), Annecy (animation).
- Formations d’excellence : L’École des Gobelins, avec des élèves recrutés avant la fin de leurs études par les plus grands studios américains.
Malgré ces succès mondiaux, les auteurs dénoncent une « totale indifférence » de l’État et de l’Europe. Pour eux, la culture nous enrichit personnellement, nous élève, nous fait comprendre l’âme humaine, nous procure rire, pleurs et réflexion. Elle est « émotion et raison ».
L’Éducation Artistique et Culturelle : Le Ciment de la Nation 🧑🎨
Face à un supposé « ensauvagement » de la société, la culture est présentée comme le moyen de rétablir la « civilité » et de construire notre civilisation. L’éducation artistique et culturelle (EAC) est la « mère de toutes les batailles » pour insuffler cette civilité. Elle vise à :
- Offrir à chaque jeune des connaissances culturelles communes.
- Permettre la rencontre physique avec des artistes et la découverte d’œuvres.
- Renforcer la société, stimuler l’émancipation individuelle et rassembler au-delà des particularités identitaires.
- « Déghettoïser » les esprits, ouvrir l’horizon des connaissances, donner confiance en soi et en la société, et transmettre un patrimoine intellectuel commun.
De Beaux Discours Nationaux… et des Actes Qui Ne Suivent Pas 📜🚫
La législation française affiche une ambition nationale forte pour l’EAC, avec des lois comme celle du 26 juillet 2019 ou du 8 juillet 2013, qui prévoient l’acquisition d’une culture générale pour tous, la promotion de l’épanouissement individuel et l’égalité d’accès à la culture. Cependant, les auteurs soulignent un « puissant décalage entre les objectifs et la réalité ». La France est championne des textes officiels, mais « l’art d’exécution » fait souvent défaut.
L’État, malgré ses discours ardents, est « particulièrement absent dès qu’il s’agit de prendre des initiatives et de dégager des moyens ». Un exemple frappant est le refus de l’exécutif de sortir les dépenses d’EAC des plafonds imposés aux collectivités territoriales, les empêchant de faire de l’EAC une priorité locale.
Le « 100 % EAC » et Autres Initiatives Locales Inspirantes 🌟
Heureusement, des collectivités territoriales montrent la voie. Cannes est la première ville française à avoir été labellisée « 100 % EAC » dès 2017. Tous les élèves cannois, de la maternelle au supérieur (environ 18 000), reçoivent un enseignement culturel annuel et rencontrent des artistes. Les retombées sont positives : implication des familles, fréquentation accrue des institutions culturelles. Cette politique, principalement financée par la municipalité (85%), est un outil essentiel de cohésion sociale, d’égalité des chances et de civisme.
D’autres initiatives remarquables incluent :
- Le dispositif Démos de la Philharmonie de Paris, offrant un instrument de musique et des cours à 4 500 jeunes de 7 à 12 ans dans les quartiers défavorisés, inspiré d’El Sistema au Venezuela.
- Le programme « Dix mois d’école et d’Opéra » de l’Opéra national de Paris, améliorant les résultats scolaires et redonnant fierté et confiance aux jeunes des zones d’éducation prioritaire.
Ces initiatives sont des « gouttes d’eau » face à l’ampleur du défi, mais elles prouvent l’efficacité de l’EAC lorsqu’elle est mise en œuvre de manière volontariste.
Obstacles et Réticences 🚧
Le ministère de l’Éducation nationale (Rue de Grenelle) est critiqué pour sa « réelle réticence » à la concrétisation du 100 % EAC, ses « présupposés idéologiques » et la faiblesse des moyens financiers consacrés. La formation des enseignants est minimale, sans CAPES ni agrégation dédiés à l’histoire de l’art. Un rapport de l’inspection générale de 2017 est cité pour son « enthousiasme très modéré », déconstruisant l’intérêt de l’EAC et soulignant l' »extrême difficulté d’évaluer des effets de l’EAC ».
Les auteurs insistent sur la nécessité de former les enseignants à la transmission culturelle, pour préparer les élèves à « recevoir » une œuvre. Sans cela, les actions culturelles risquent de renforcer les fractures plutôt que de les réduire. Il ne suffit pas de « mettre l’art dans la rue », l’explication et le débat sont indispensables. Une « politique culturelle de la demande », centrée sur la formation du public, est la clé pour sortir de l’échec de la démocratisation culturelle.
Vers une Épreuve Obligatoire d’EAC au Baccalauréat et une Liste d’Œuvres Majeures 🎓📚
Pour mobiliser l’Éducation nationale, les auteurs proposent d’instaurer une épreuve obligatoire d’EAC au baccalauréat, dans toutes les sections. Cela exigerait de définir les « connaissances culturelles essentielles » à transmettre à tous les élèves. Ils plaident pour l’élaboration d’une liste de cinquante à cent œuvres majeures du patrimoine national (littéraires, théâtrales, musicales, picturales, architecturales, etc.) qui auraient « survécu à leur auteur et résisté au temps ». Cette démarche vise à ressouder la nation autour d’un patrimoine commun, lutter contre le relativisme et le nihilisme postmoderne qui déconstruit toute hiérarchie des œuvres.
L’épreuve pourrait être orale, portant sur une œuvre étudiée, et inclure un volet pratique pour les élèves impliqués dans des activités artistiques (orchestre, théâtre, film). Les auteurs s’appuient sur Hannah Arendt, qui voyait l’éducation comme un moyen de préserver ce qui est « neuf et révolutionnaire dans chaque enfant » en restaurant l’autorité et la tradition.
La Culture Artistique au Service de la Culture Scientifique 🔭🔬
La culture scientifique est également une « nécessité démocratique » pour former des citoyens avertis, capables de résister à l’immédiateté numérique et aux biais cognitifs. Des expériences pédagogiques ont montré que l’accès à la culture scientifique peut être facilité par l’art, comme le projet « Art et Science » de l’Université Côte-d’Azur, liant l’œuvre d’Edmond Vernassa à des concepts mathématiques et physiques. Sciences, arts et philosophie sont trois piliers à lier pour prémunir les citoyens des maux de notre époque et sauver notre démocratie.
Le Patrimoine Français : Un Trésor à Sauver 🏰
La France est incroyablement riche en patrimoine, avec 44 000 monuments historiques, dont la moitié appartient à des particuliers et 43 % aux communes. Ce patrimoine est « le fruit de siècles de travail, de trésors de connaissance, de tant de douleurs et de drames » et nous « oblige pour l’avenir ». Cependant, 20 % de ces monuments sont dégradés et 7 %, soit près de 3 000, sont en péril.
Le Drame Financier et les Difficultés d’Entretien 📉🔥
L’État consacre seulement 320 millions d’euros au patrimoine, soit moins de 10 % du budget du ministère de la Culture, ce qui équivaut à un peu plus de 7 200 euros par an et par monument. Cette « étonnante pingrerie » est compensée par les collectivités locales et les propriétaires privés, mais reste insuffisante.
Les difficultés d’entretien sont majeures, souvent dues à l’absence de plans d’entretien courant et à une organisation administrative inadaptée. Le risque d’incendie est aussi « très mal appréhendé », comme l’ont montré les drames de la cathédrale de Nantes et de Notre-Dame de Paris, où des défaillances matérielles ou humaines ont eu des conséquences « criminelles » et des coûts astronomiques.
Des Solutions Existent et des Initiatives Prospèrent 💡
Les auteurs appellent à faire de la protection du patrimoine une « cause nationale », avec des moyens financiers à la hauteur. La préservation du patrimoine est un investissement :
- Elle crée de l’emploi non délocalisable et préserve les métiers d’art (ébénistes, charpentiers, tailleurs de pierre).
- Elle génère de l’attractivité touristique et des revenus indirects (restauration, commerces).
Des solutions concrètes sont proposées :
- Les « paradores » espagnols : Des hôtels de luxe installés dans des monuments historiques, dont les revenus financent la rénovation. Ce modèle pourrait être répliqué en France.
- Accès payant aux cathédrales et églises insignes : Inspirée des pratiques étrangères (Cordoue, Venise, Rome, Westminster), cette mesure pourrait générer près de 100 millions d’euros par an rien qu’à Paris, sans affecter l’accès aux fidèles.
- Contribution sur les nuitées hôtelières et taxes sur les plateformes comme Airbnb : Une taxe d’environ un euro par nuitée, intégrée à la taxe de séjour, pourrait être affectée aux monuments historiques de proximité. Airbnb, profitant d’une « passoire fiscale européenne », devrait également contribuer financièrement sur chaque nuitée passée en France pour alimenter l’entretien du patrimoine bâti.
- Décentralisation culturelle accrue : Confier davantage de compétences aux Régions, qui ont les moyens financiers et l’expertise.
- Mécénat : La loi Aillagon de 2003 est saluée, mais la réduction récente de l’avantage fiscal pour les dons de plus de 2 millions d’euros est critiquée comme un « signal désastreux ». Il faudrait relever le plafond de mécénat pour les PME à 1% du CA pour encourager le mécénat local.
La Vitalité Culturelle des Territoires : Finir avec le Jacobinisme 🗺️
Si Paris est une capitale culturelle majeure, « l’avenir de la culture en France passera d’abord par les territoires ». La province est aujourd’hui le lieu du dynamisme culturel, générant développement économique, emploi non délocalisable, fierté locale et identité territoriale.
De Très Grandes Réussites Locales 🚀
Trois exemples sont mis en avant pour illustrer la spirale positive que peut générer une activité culturelle :
- Angoulême : Victime d’une désindustrialisation, la ville s’est transformée grâce à son Festival de la Bande Dessinée (créé en 1972). Le pôle Magelis, créé en 1997, a permis l’installation d’une centaine d’entreprises (animation, jeux vidéo), 30 studios d’animation, 200 auteurs, 12 écoles spécialisées (dont l’École nationale du jeu, référence mondiale). La Cité internationale de la BD et de l’image attire 200 000 visiteurs par an. Angoulême est devenue un pôle mondial de l’animation et du jeu vidéo, attirant des productions (Wes Anderson y a tourné son dernier film).
- Marciac (Gers) : Ce village de 1 250 habitants accueille depuis plus de 40 ans le festival Jazz in Marciac, attirant 250 000 visiteurs et générant 20 millions d’euros de retombées pour un budget de 3 millions. Le collège du village propose des ateliers d’initiation au jazz à toutes les classes, menant une action éducative et culturelle fondamentale.
- Lussas (Ardèche) : Ce village de 1 000 habitants organise le Festival européen du film documentaire depuis 1989, réunissant près de 5 000 personnes. Le « village documentaire » de Lussas abrite des équipements (coworking, salles de montage), Ardèche Images (base de données de 17 000 films, école documentaire), et la plateforme Tënk, générant une quarantaine d’emplois.
Ces succès prouvent que des initiatives locales, souvent sans le soutien de l’État (sauf le CNC pour certains événements), peuvent créer des écosystèmes culturels et économiques durables.
Pour un Girondisme Culturel et la Vertu des Événements 🎭🎬
Les auteurs critiquent un « jacobinisme culturel exacerbé » où Paris monopolise l’excellence. Ils appellent à une meilleure circulation des œuvres des musées parisiens vers la province et regrettent l’arrêt du « Centre Pompidou mobile ». La démocratisation de l’accès à la culture peut aussi passer par la diffusion d’opéras ou ballets filmés dans les 2 000 salles de cinéma en France.
Ils proposent un moratoire sur l’installation de nouveaux équipements culturels par l’État à Paris et la création d’un Musée de l’Histoire de France avec des antennes en région, pour que les jeunes générations et tous les Français connaissent mieux leurs racines et leur histoire.
Les événements culturels sont des « catalyseurs de création à l’année » pour un territoire, générant des écosystèmes complets (formations, entreprises, muséographie). Le Festival de Cannes est un exemple de cette spirale vertueuse, transformant un village de pêcheurs en centre mondial du cinéma, avec le développement d’une cité universitaire et d’un musée international du Cinéma. Le Hellfest à Clisson est également cité comme un exemple de succès entièrement privé, générant 48 millions d’euros d’impact financier positif en 2019.
Le Ministère de la Culture et la Scène Internationale : Entre Crise et Influence 🌍
L’Europe a longtemps ignoré le secteur culturel, le traitant comme une « marchandise ordinaire ». Le traité de Lisbonne de 2007 n’évoque la culture qu’en termes « très prudents ». Pourtant, la France est un « leader naturel » en matière culturelle en Europe.
L’« Exception Culturelle » Face à l’Impérialisme Américain 🇺🇸 vs 🇫🇷
La France, avec des alliés du Sud de l’Europe, défend la nécessité d’une régulation forte pour préserver l’agriculture et la culture de l’envahissement des concurrents extra-européens, contrairement à l’Europe anglo-saxonne. L’impérialisme culturel des États-Unis a constamment tenté de libéraliser le secteur audiovisuel et cinématographique européen. La France a mené avec succès la bataille pour exclure le cinéma et l’audiovisuel des accords de libéralisation du commerce (Uruguay Round en 1993-94, AMI en 1995, traité transatlantique en 2013), donnant naissance à l’« exception culturelle » (désormais « diversité culturelle » selon l’Unesco).
Une Rue de Valois en Crise et des Établissements Publics Performants 🏛️
Le ministère de la Culture (Rue de Valois) est en « profonde crise existentielle ». L’instabilité ministérielle (onze ministres depuis l’an 2000, trois en trois ans pour Macron) empêche la mise en œuvre d’une vision cohérente. Le ministère peine à se réformer et à s’adapter à la montée en puissance des établissements publics.
Le succès des établissements publics culturels (Louvre, Versailles, Beaubourg, Orsay) est « considérable ». Créés sur le modèle du Louvre en 1992 pour une autonomie financière et administrative, ils ont vu leur fréquentation exploser, leur mécénat croître et leurs politiques des publics se professionnaliser. Ils sont devenus de « véritables machines de guerre ». Cependant, le ministère « peine à comprendre ces évolutions » et à exercer une tutelle stratégique plutôt que tatillonne.
Un Périmètre à Revoir et l’Urgence de l’Action pour la Francophonie 🗣️
Le périmètre du ministère est « trop grand et il s’y noie », couvrant des sujets aussi différents que l’archéologie préventive et la bande mégahertz. Les auteurs suggèrent de :
- Rapprocher le ministère de l’Éducation nationale et la Rue de Valois, ou recréer un poste de ministre de l’Éducation nationale et de la Culture, à condition d’une feuille de route claire et d’une administration obéissante.
- Détacher la partie « communication » pour créer un secrétariat d’État ou un ministère délégué aux Industries culturelles et numériques, rattaché à Matignon. Cela permettrait de concentrer la Rue de Valois sur les « Beaux-Arts » et de positionner les industries culturelles au cœur de l’exécutif, facilitant les échanges avec Bercy et le Quai d’Orsay.
L’action pour la francophonie est une « ardente nécessité ». La langue française, parlée par plus de 300 millions de personnes et qui pourrait atteindre 700 millions en 40 ans (principalement en Afrique), est une « arme pacifique d’une formidable puissance ». Le Centre national du cinéma, du livre et de la musique devraient consacrer une part conséquente de leurs soutiens au développement de la francophonie.
Faire Confiance au Terrain et Décentraliser le Spectacle Vivant 🤝
Les collectivités territoriales (communes, intercommunalités, départements, régions) jouent un rôle « essentiel », finançant près de 9 milliards d’euros pour la culture, bien plus que l’État. Les auteurs dénoncent le « jacobinisme culturel très fort » de l’État et des acteurs culturels qui ont longtemps préféré l’argent de l’État.
Ils appellent à une nouvelle étape de décentralisation culturelle, notamment pour le spectacle vivant, en cessant la politique des « labels nationaux » jugée obsolète et en créant des « maisons de production et de diffusion » sur tout le territoire. Ces structures seraient multidisciplinaires, ouvertes aux scolaires et au public, avec des programmations approuvées par des professionnels et une présence minoritaire d’élus.
Enfin, la politique de l’offre culturelle doit être complétée par une politique de la demande. Les expérimentations de gratuité dans les musées n’ont pas démocratisé l’accès à la culture, profitant surtout aux habitués. C’est à l’école, via l’EAC, que tous les jeunes Français doivent avoir accès aux richesses culturelles.
Le Numérique : Opportunités, Dangers et Régulation Impérative 💻
La « révolution du numérique » ouvre des horizons d’activités « étourdissantes » mais aussi des « périls proportionnels » d’uniformisation, de conformisme et de « bad buzz ».
Les Nouvelles Frontières et le Marché de l’Art Digital 🖼️🌐
Les opportunités du numérique pour la culture sont évidentes, y compris pour le privé, comme l’illustre Google Arts et Culture qui numérise des millions d’œuvres en haute définition. Le projet Micro-folie du ministère de la Culture, coordonné par l’Établissement public de la Villette, permet l’accès à de grandes œuvres via des « micro-musées numériques » sur le territoire.
Le marché de l’art contemporain est bouleversé par ces nouveaux modes d’exposition et de valorisation numériques, avec l’émergence de plateformes comme Instagram (65% des utilisateurs y accèdent à des contenus artistiques) et de nouvelles entités utilisant la blockchain pour l’authentification et la vente. Cela fluidifie la relation entre créateur et acquéreur, et un « deuxième marché de l’art » se développe pour des œuvres moins chères.
La Révolution de la Diffusion et l’Ardente Nécessité d’une Régulation 🎶🎬
Le numérique a entraîné un bouleversement complet des modes de diffusion de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel :
- Dématérialisation : Fin des supports physiques.
- Révolution des usages : Accès au contenu « ce que je veux, où je veux, quand je veux, et sur l’écran de mon choix ».
- Profusion : Catalogues illimités (Netflix, YouTube, Spotify), où la quantité prime sur la qualité éditoriale.
- Mondialisation des diffuseurs : Nécessité d’opérer à l’échelle mondiale pour amortir les investissements colossaux.
Cette révolution est une « chance historique » pour l’accès aux contenus culturels, mais elle nécessite une régulation pour éviter la concentration exclusive des richesses et la destruction des producteurs de contenus.
Liberté et Responsabilité des Réseaux Sociaux ⚖️📱
Les auteurs dénoncent le rôle « délétère » des réseaux sociaux (modèle économique basé sur le trafic et les données) et l’incapacité de la justice française à appliquer la loi pénale (incitation au terrorisme, insulte, haine, diffamation). Ils critiquent le « mirage » de l’irresponsabilité des plateformes, qui se considèrent comme de simples hébergeurs. Ils proposent d’assimiler les réseaux sociaux à des organes de presse, les obligeant à avoir un directeur de publication pénalement responsable des contenus. Cela impliquerait des moyens technologiques et humains pour la modération. L’exemple de la censure de Donald Trump sur Twitter et Facebook est cité comme un « coup politique particulièrement cynique ».
La Lutte Sans Fin Contre le Piratage 🏴☠️
Le piratage est qualifié de « vol » et de « fléau », spoliant les créateurs et coûtant cher à l’industrie (1,2 milliard d’euros par an pour la France, 2 000 emplois perdus, 400 millions d’euros de taxes non perçues). Il a mis à genoux l’industrie musicale dans les années 2000.
Les tentatives de lutte contre le piratage ont été des « désastres politiques » en France (loi DADVSI, Hadopi). L’Hadopi, initialement conçue pour suspendre les abonnements Internet des pirates, a été affaiblie par une censure du Conseil constitutionnel et par des décisions ministérielles. Les auteurs suggèrent de s’inspirer du modèle allemand d’amende transactionnelle, qui a prouvé son efficacité. Une autre piste est de pénaliser les plateformes de piratage, en autorisant les fournisseurs d’accès et les moteurs de recherche à « couper et déréférencer les sites pirates » via une ordonnance judiciaire.
Pour l’Équité dans l’Univers des Plateformes, au Service de la Création 🤝🎬
Les grandes plateformes internationales de vidéo par abonnement comme Netflix ou Amazon Prime bénéficient d’une optimisation fiscale agressive, payant des impôts « bien peu » au regard de leurs chiffres d’affaires réels en France. Les auteurs insistent : ce sont aux sociétés étrangères de s’adapter aux systèmes français, pas l’inverse.
Le cinéma français, avec près de 300 films par an, a survécu grâce à une politique publique habile, le système du CNC, financé par une taxe sur les billets d’entrée (TSA) et des contributions des chaînes de télévision et fournisseurs d’accès. Ce système soutient la production de manière automatique et sélective.
Des avancées ont été faites : l’Allemagne et la France ont instauré le principe d’une taxation des plateformes dans le pays de destination (là où le client est installé), principe validé par la Commission européenne via la directive SMA. Cela devrait générer des dizaines de millions d’euros pour la création française via le CNC.
Le prochain combat concerne les obligations d’investissement dans la production française imposées aux plateformes. Le projet de décret prévoit 20 à 25 % du chiffre d’affaires français des plateformes pour la production nationale, ce qui est « convenable ». Un point délicat est le partage entre cinéma et audiovisuel (risque de privilégier les séries au détriment du cinéma). Il est aussi crucial que la majorité de ces investissements se fassent en préachat ou coproduction pour permettre la réalisation des œuvres, et que les droits demeurent entre les mains des producteurs indépendants français.
Enfin, une réforme de la chronologie des médias est « systémique ». La fenêtre d’exclusivité de 4 mois pour les salles est excessive ; une période de 2 mois, modulable en cas de succès, est proposée, suivie de deux fenêtres courtes (9 mois) pour les opérateurs payants puis gratuits.
Faire Respecter le Droit d’Auteur par les GAFA 📝🛡️
Le droit d’auteur, une invention française, doit être défendu face au copyright anglo-saxon et aux tentatives européennes de le « briser ». Le président Macron a clairement posé le principe que « la valeur créée par celui qui crée vraiment » doit être rémunérée.
La directive européenne sur le droit d’auteur, après une bataille acharnée contre le lobbying des GAFA (Google aurait dépensé plus de 30 millions de dollars), a finalement été adoptée en 2020. Elle inclut :
- L’article 11 : Des droits voisins sur les articles de presse repris par les moteurs de recherche (inspiré de la loi allemande), pour rémunérer les auteurs et organes de presse.
- L’article 13 : Les plateformes diffusant des œuvres protégées doivent souscrire des contrats de licence et mettre en place des outils de reconnaissance pour rémunérer les ayants droit.
Ces victoires sont vues comme un signal que l’Europe peut résister à la « puissance excessive » des GAFA, qui pourrait mener à leur démantèlement à l’avenir.
Veiller à un Partage Équitable de la Valeur sur Internet 📈
Le numérique permet une diffusion mondiale, mais la valeur créée est souvent mal partagée. Les auteurs dénoncent la « faiblesse de la rémunération pour les artistes » sur les plateformes musicales (YouTube : 0,0007 $ par écoute, Spotify : 0,0044 $, Deezer : 0,0064 $). Les plateformes tentent d’imposer des rémunérations forfaitaires plutôt que proportionnelles au succès de l’œuvre, à leur seul avantage. Il est « plus important de comprendre comment fonctionnent ces algorithmes afin de s’assurer que ces derniers ne sont pas des pièges à diversité ou n’orientent pas les consommateurs vers les œuvres que les plateformes auraient intérêt à mettre en avant ».
La Culture, Pilier de notre Civilisation et Avenir de la France 🌟
En guise de conclusion, les auteurs réaffirment que « la culture domine tout, elle est la condition sine qua non de notre civilisation ». Face à la crise permanente et aux fractures de la société, la culture est une force thérapeutique et fédératrice.
La France possède des talents immenses et le secteur culturel peut être un formidable vecteur de croissance, non seulement économique, mais aussi porteuse de sens et de civilisation. La force de la France réside dans :
- Son tissu de TPE et PME agiles, fondé sur l’économie du prototype.
- Des activités culturelles non délocalisables, bénéficiant d’une longue tradition d’excellence.
- Des structures de formation excellentes et une image culturelle « incontestable et incontestée ».
- Une politique publique réussie de développement des établissements culturels et d’investissement massif des collectivités territoriales.
- Des mécanismes innovants de financement qui ont permis de sauvegarder le cinéma et l’audiovisuel français face à l’impérialisme culturel.
La France doit continuer à lutter contre tous les impérialismes culturels, notamment celui des GAFA, dont l’emprise sur nos vies et leur refus de toute régulation représentent un problème économique et sociétal majeur. Le couple franco-allemand doit rester uni pour mener ces combats nécessaires en Europe.
La culture n’est pas une marchandise, mais un « formidable outil d’influence ». Elle est source d’émotion, aide à la réflexion et fait grandir. Pour cela, il faut réorienter les actions culturelles vers tous les publics, par une instruction artistique systématique des jeunes, la formation continue, et la stimulation de la curiosité.
La politique de l’offre culturelle française doit être complétée par une vaste politique de la demande. Les piliers de cette politique incluent le développement de l’EAC, l’encouragement des dynamiques locales, la stimulation des initiatives privées, l’utilisation judicieuse du numérique, les collaborations public-privé, la rémunération juste des artistes, l’optimisation de l’audiovisuel public et la participation populaire à la valorisation du patrimoine.
Chaque Français doit se sentir « légitime face aux offres culturelles et en mesure de vivre les joies artistiques ». C’est la voie du renouveau civique, car « la culture est source de liberté et de responsabilité. Il suffit d’en avoir conscience, la culture sauvera la France« . Ce livre est un appel retentissant à un « sursaut culturel pour le renouveau du pays ».