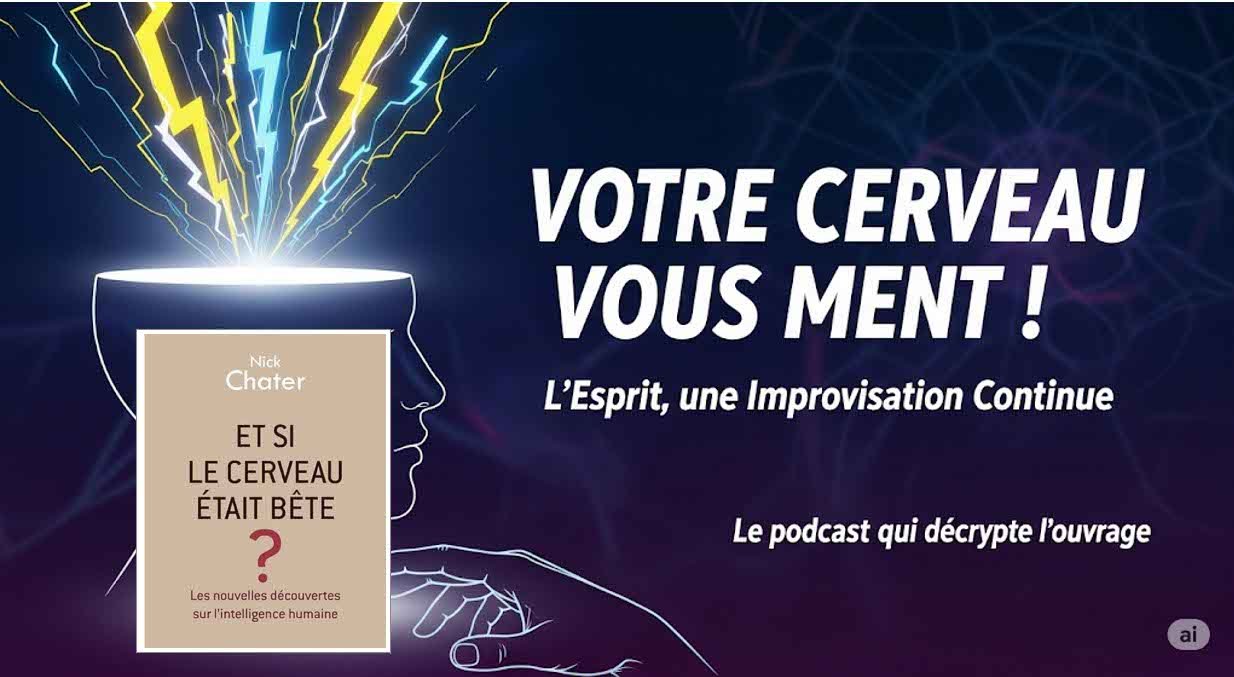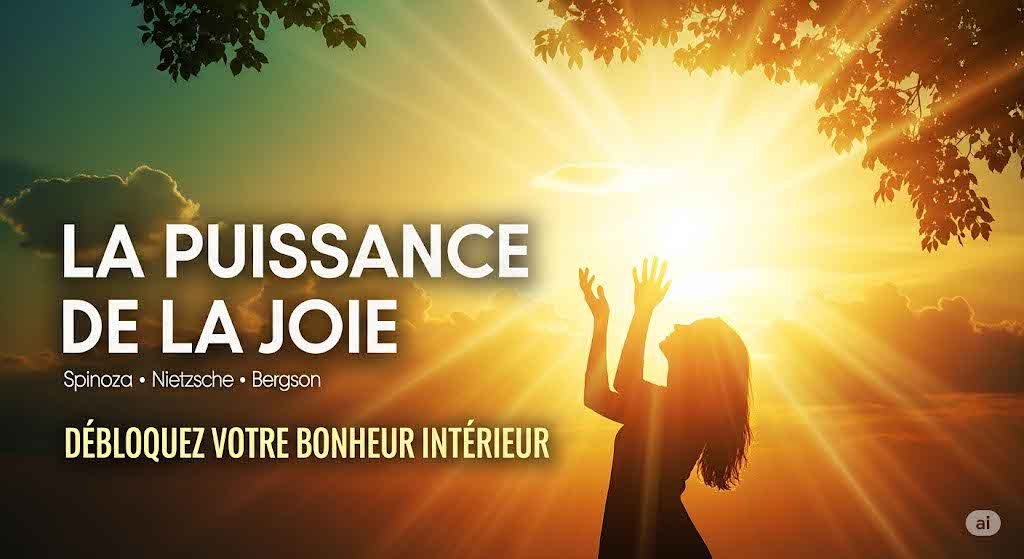Les liens pour vous procurer les différentes versions
📗Lien vers le livre papier : https://amzn.to/41aPyv6
📕Lien vers l’ebook : https://amzn.to/3HGGkzY
« Pour en finir avec Dieu » de Richard Dawkins : Une Critique Révolutionnaire de la Religion et un Plaidoyer pour la Raison 💡
Dans un monde où la religion continue de façonner les sociétés et les esprits, l’ouvrage de Richard Dawkins, « Pour en finir avec Dieu » (titre original : The God Delusion), paru en 2006, a fait l’effet d’une bombe. Traduit de l’anglais par Marie-France Desjeux-Lefort et publié chez Robert Laffont, ce livre n’est pas qu’une simple critique : c’est un manifeste audacieux qui vise à démystifier les croyances religieuses et à affirmer la puissance libératrice de l’athéisme. Dawkins, un biologiste de l’évolution de renom, propose une analyse incisive, souvent provocatrice, des fondements de la foi, invitant les lecteurs à embrasser une vision du monde basée sur la science, la raison et la fierté d’être athée.
L’Athéisme : Fierté, Réalisme et Bonheur 😌
L’un des messages les plus fondamentaux de Dawkins est d’éveiller la conscience qu’il est « réaliste, courageux et merveilleux de vouloir être athée ». Il s’agit de déconstruire l’image négative souvent associée à l’athéisme, en montrant qu’il est possible d’être « un athée heureux, équilibré, moral et intellectuellement accompli ». Ce plaidoyer pour la fierté athée est central, car pour Dawkins, il n’y a « pas de quoi s’excuser d’être athée » ; bien au contraire, il faut en être fier, la tête haute, car l’athéisme est « presque toujours la marque d’une saine indépendance d’esprit et, à vrai dire, d’un esprit sain ».
Dawkins note que de nombreuses personnes se savent athées au fond d’elles-mêmes, mais n’osent pas l’admettre devant leur famille, ou même à elles-mêmes, en partie à cause de l’étiquette effrayante associée au mot « athée ». Il cite l’exemple tragicomique de la comédienne Julia Sweeney, dont la mère a réagi avec un cri d’horreur en apprenant qu’elle était devenue « ATHÉE ».
La religiosité de l’Amérique contemporaine est un phénomène particulièrement frappant pour Dawkins, où il est plus difficile pour un athée de remporter une élection que pour un mormon ou un homosexuel. Cependant, il souligne que les athées sont bien plus nombreux qu’on ne le pense, surtout dans l’élite instruite, comme l’avait déjà remarqué John Stuart Mill au XIXe siècle. Le rêve de Dawkins est que son livre encourage ces athées « à se déclarer » et à former une masse critique, à l’instar du mouvement gay, pour faciliter l’acceptation de l’athéisme.
La Religion et le Mal : Une Racine Complexe 🌳🔥
D’emblée, Richard Dawkins tient à nuancer le titre de son documentaire « Root of All Evil? » (La racine de tout le mal ?), affirmant que la religion n’est pas l’unique source de tous les maux, car « dans aucun domaine une seule chose ne peut être la racine de tout ». Cependant, il se réjouit de la publicité de Channel Four qui sous-titrait une photo panoramique de Manhattan « Imaginez un monde sans religion » avec les tours jumelles du World Trade Center bien en évidence.
Il invite à imaginer, avec John Lennon, un monde sans religion : « Pas d’attentats suicides, pas de 11 septembre, pas de 7 juillet, pas de croisades, pas de chasses aux sorcières, pas de décapitations publiques des blasphémateurs, pas de femmes flagellées pour avoir montré une infime parcelle de peau ».
Une critique majeure de Dawkins est le « respect non mérité » accordé à la religion. Il observe qu’un principe très répandu dans notre société, y compris chez les non-croyants, est que « les convictions religieuses prêtent particulièrement le flanc aux attaques et doivent être protégées par un mur de respect anormalement épais et d’un autre ordre que le respect que tous les êtres humains se doivent mutuellement ». Il donne des exemples frappants :
- Objection de conscience : Les raisons religieuses sont plus facilement acceptées pour le statut d’objecteur de conscience que des arguments philosophiques moraux.
- Euphémismes médiatiques : Les conflits manifestement religieux sont souvent qualifiés de « luttes intercommunautaires » ou de « nettoyage ethnique », comme en Irlande du Nord ou en Irak, pour éviter le mot « religion ».
- L’affaire Salman Rushdie et les caricatures danoises : Dawkins déplore l’indignation hystérique et la violence qui ont suivi la publication des caricatures de Mahomet, contrastant cela avec la tolérance envers les caricatures de politiciens. Il souligne que la campagne d’incitation au désordre autour des caricatures a même utilisé de fausses images.
Pour Dawkins, cette propension à traiter la religion avec une « délicatesse anormale » est dangereuse, car elle inhibe la critique nécessaire.
La « Théorie de Dieu » : Une Hypothèse Scientifique comme les Autres 🔬🌌
Dawkins insiste sur le fait que l’hypothèse de Dieu – définie comme l’existence d’une « intelligence surnaturelle, surhumaine qui a délibérément conçu et créé l’univers et tout ce qu’il contient, nous, entre autres » – est une hypothèse scientifique sur l’univers qui doit être analysée avec le même scepticisme que n’importe quelle autre.
Il critique la « religion einsteinienne », une vision large et souple de Dieu comme l’ordre et la beauté de l’univers, qu’il juge être un « abus de langage ». Bien qu’Einstein ait utilisé le mot « Dieu », Dawkins explique qu’il s’agissait d’une métaphore pour l’émerveillement face à la structure du monde révélée par la science, et non d’un Dieu personnel, interventionniste ou faiseur de miracles. Confondre ces deux sens relève, selon lui, de la « haute trahison intellectuelle ».
Dawkins rejette fermement le concept de NOMA (Non-Overlapping Magisteria) proposé par Stephen Jay Gould, qui postule que science et religion occupent des domaines distincts et non-empiétants (la science pour les faits empiriques, la religion pour les questions de sens et de valeurs morales). Pour Dawkins, si Dieu a créé l’univers, cela serait une affirmation sur la nature de l’univers et donc une question scientifique. Il argumente que si des preuves scientifiques de l’existence de Dieu (comme des guérisons miraculeuses) apparaissaient, les théologiens s’empresseraient de jeter le NOMA aux oubliettes.
Il illustre ce point avec l’étude sur la prière d’intercession financée par la Templeton Foundation. Cette étude, menée par le Dr. Herbert Benson sur 1802 patients ayant subi des pontages coronariens, n’a montré aucune différence statistique entre les groupes ayant fait l’objet de prières et les groupes témoins. Dawkins souligne l’embarras des théologiens face à ces résultats, qui ont critiqué l’étude en affirmant que Dieu ne répond aux prières que si elles sont « motivées par de bonnes raisons ». Il tourne en dérision l’idée d’un Dieu qui refuserait de guérir quelqu’un parce qu’il est dans un groupe témoin expérimental. Dawkins voit dans cette attitude une tentative de protéger la religion de la vérification scientifique.
Les Arguments en Faveur de Dieu : Une Démolition Logique 🔨📚
Dawkins consacre un chapitre entier à la démolition des arguments traditionnels en faveur de l’existence de Dieu, les qualifiant de « criante faiblesse ».
Les Preuves de Thomas d’Aquin 📜
Les cinq preuves de Thomas d’Aquin (moteur non mû, cause première, être nécessaire, degré de perfection, ordre de l’univers) sont examinées et rejetées. Dawkins les considère comme de simples variations d’une régression à l’infini qui ne résout rien, mais qui aboutit à une « fin naturelle » dans le monde physique. Il compare l’invocation de Dieu pour expliquer le début d’une chaîne causale à une « recette sans queue ni tête ».
L’Argument Ontologique et A Priori 🦄
Cet argument, notamment formulé par Anselme, tente de prouver l’existence de Dieu par la seule logique, en définissant Dieu comme « quelque chose de tel qu’on ne peut rien concevoir de plus grand ». Si une telle entité existait seulement dans l’esprit, on pourrait concevoir qu’elle existe aussi dans la réalité, ce qui serait supérieur, donc Dieu doit exister en réalité. Dawkins trouve cette idée « esthétiquement choquante » et absurde, la comparant à des « logorrhées ». Il mentionne les réfutations classiques de Hume et Kant, et la « preuve » ironique de Douglas Gasking que Dieu n’existe pas en appliquant la même logique fallacieuse. Il utilise l’analogie de la licorne invisible et inaudible que les enfants du Camp Quest essaient de réfuter.
L’Argument de la Beauté 🎨🎶
Très populaire, cet argument suggère que la beauté de l’art (Shakespeare, Schubert, Michel-Ange) implique l’existence de Dieu. Dawkins le qualifie de « creux », car ceux qui l’avancent ne présentent aucune logique sous-jacente. Il le voit comme une version de l’argument du dessein ou de la jalousie du génie : « Comment un autre être humain pourrait-il oser faire une si belle musique… alors que j’en suis incapable ? C’est sûrement l’œuvre de Dieu ».
L’Argument de l’Expérience Personnelle 🗣️👻
De nombreuses personnes croient en Dieu en raison d’expériences personnelles, de visions ou de sentiments. Dawkins rappelle que le cerveau humain excelle dans la « construction de modèles », pouvant générer des rêves, des hallucinations ou des interprétations subjectives (comme voir le visage de Satan dans la fumée du 11 septembre). Il cite l’exemple de l’apparition de Fátima, où des milliers de personnes ont cru voir le soleil danser et le système solaire détruit sans que personne d’autre dans le monde ne le remarque. Pour Dawkins, ces « expériences » ne sont pas fiables et ne constituent pas une preuve pour autrui.
Le Pari de Pascal et les Arguments Bayésiens 🎲📊
Dawkins rejette le Pari de Pascal, qui soutient qu’il est plus rationnel de croire en Dieu (même s’il est peu probable) car les conséquences de ne pas croire si Dieu existe sont infiniment pires. Dawkins estime que cela réduit la foi à un calcul intéressé et cynique, se demandant pourquoi « si l’on veut plaire à Dieu, ce qu’il faut, c’est croire en lui ».
Il aborde aussi les arguments bayésiens de Stephen Unwin, qui tentent de quantifier la probabilité de l’existence de Dieu à l’aide du théorème de Bayes. Bien que Dawkins soit empathique envers l’objectif d’Unwin de traiter l’existence de Dieu comme une hypothèse scientifique, il estime que les estimations de probabilité sont intrinsèquement subjectives et ne peuvent mener à des conclusions solides (« à piètres données, piètres résultats »).
Le « Boeing 747 Ultime » : L’Argument Central de l’Improbabilité ✈️🧠
L’argument central de Dawkins contre l’existence de Dieu est ce qu’il appelle l’argument de l’improbabilité, ou le « Boeing 747 Ultime ». Cet argument réfute la logique créationniste qui postule qu’un phénomène complexe (comme un organisme vivant) doit avoir été conçu par une intelligence supérieure car il ne peut apparaître par hasard. Dawkins retourne cet argument : un concepteur, s’il était capable de concevoir quelque chose d’aussi complexe que l’univers ou la vie, devrait être lui-même extrêmement complexe et statistiquement improbable. Par conséquent, un Dieu concepteur nécessiterait une explication encore plus grande que ce qu’il est censé expliquer, créant une régression à l’infini. « Dieu est l’ultime Boeing 747 ».
La Complexité Irréductible et le Dieu des Lacunes 🕳️
Dawkins critique directement le concept de « complexité irréductible » popularisé par Michael Behe. Behe affirme que certains systèmes biologiques sont si complexes qu’ils ne peuvent fonctionner que si toutes leurs parties sont présentes simultanément (comme une souricière), et n’auraient donc pas pu évoluer par étapes progressives. Dawkins montre que cette affirmation est « tout simplement fausse ». Il cite l’exemple de l’œil, que Darwin lui-même avait initialement du mal à expliquer, mais dont l’évolution progressive est désormais bien comprise par des « stades intermédiaires utiles ». Il utilise l’analogie de la « montagne Improbable » avec une « pente douce » de l’évolution progressive, par opposition à une « falaise abrupte » que les créationnistes imaginent.
Concernant le flagelle bactérien, Behe le présente comme un exemple parfait de complexité irréductible, comparable à un « minuscule moteur de hors-bord ». Cependant, Dawkins, s’appuyant sur les travaux de Kenneth Miller, démontre que des composants du flagelle (comme le système de sécrétion de type III, TTSS) fonctionnent indépendamment et ont pu être « récupérés » et réutilisés au cours de l’évolution pour former le moteur complet. Il souligne que la prétention de Behe selon laquelle la littérature scientifique ignorait ce problème a été « démontrée de façon massive et gênante » lors du procès de Dover en 2005.
Dawkins dénonce la stratégie du « Dieu des lacunes », où les créationnistes exploitent les lacunes actuelles de la connaissance scientifique pour y insérer l’idée d’un dessein intelligent. Il insiste sur le fait que l’ignorance temporaire en science est un « défi pour de nouvelles conquêtes », et non une preuve par défaut pour Dieu. Cette approche « prive les scientifiques de la jouissance naturelle… de leur incertitude ».
Quant à l’origine de la vie, Dawkins admet que le chemin n’est pas encore complètement tracé. Cependant, il privilégie l’hypothèse anthropique et la « magie des grands nombres » : avec des milliards de planètes potentielles dans l’univers, la probabilité d’une apparition spontanée de la vie quelque part devient plausible, sans nécessiter un dessein divin.
Les Racines Évolutionnistes de la Religion : Pourquoi Croyons-Nous ? 🤔
Dawkins explore les origines de la religion à travers une lentille darwinienne, cherchant à comprendre son omniprésence non pas comme une preuve de sa vérité, mais comme une adaptation ou un sous-produit de mécanismes utiles.
Il rejette les explications superficielles comme « la religion répond à notre curiosité » ou « la religion console », car elles ne sont pas des explications darwiniennes ultimes. Dawkins s’intéresse aux causes lointaines, et non aux causes prochaines (comme une « hyperactivité dans un ganglion particulier du cerveau »).
Dawkins défend la théorie de la religion comme un « produit dérivé accidentel » ou un « raté d’une chose utile ». L’hypothèse de l’« enfant crédule » est centrale : la sélection naturelle a doté le cerveau de l’enfant d’une tendance à « croire tout ce que lui disent ses parents et les anciens de la tribu » pour des raisons de survie. Cette « obéissance en toute confiance » est bénéfique, mais son revers est une vulnérabilité aux « virus » mentaux, y compris les idées religieuses. Le dispositif hyperactif de détection d’agents (HADD), proposé par Justin Barrett, est une prédisposition psychologique où nous sommes « hyperactifs pour déceler des agents quand il n’y en a pas », ce qui favorise la croyance en des entités surnaturelles.
L’auteur prolonge l’analogie biologique avec la théorie des mèmes, des unités d’héritage culturel qui se répliquent, mutent et sont soumises à une forme de sélection. Les idées religieuses, ou « mèmes religieux », se répandent non pas nécessairement parce qu’elles sont « bonnes » ou « vraies », mais parce qu’elles sont « aptes à survivre dans le pool » de la culture humaine. Elles peuvent être intrinsèquement séduisantes (comme le mème de l’immortalité) ou compatibles avec d’autres mèmes existants, formant des « mèmeplexes ». La foi, l’irrationnalité et l’obéissance aveugle, par exemple, sont des traits qui favorisent la survie des mèmes religieux.
Les cultes du cargo des Mélanésiens sont cités comme des études de cas fascinantes de l’émergence rapide et de l’évolution des religions. Après la Seconde Guerre mondiale, les populations insulaires, stupéfaites par les biens (le « cargo ») apportés par les Blancs, ont développé des cultes messianiques (comme le culte de John Frum) où des figures prophétiques promettent le retour de cargaisons de richesses. Ces cultes reproduisent des schémas observés dans des religions plus anciennes, y compris le christianisme primitif. La rapidité avec laquelle les légendes se forment et les traces du passé sont oblitérées est frappante.
Moralité et Religion : Une Fausse Connexion ? ⚖️❌
Dawkins s’attaque à l’idée que le sens moral dérive de la religion et qu’il serait impossible d’être bon sans Dieu. Il considère cette question comme « franchement ignoble », suggérant que croire qu’on « commettrait des vols, des viols et des meurtres » si Dieu n’existait pas révèle une immoralité fondamentale.
Il montre que le comportement altruiste peut s’expliquer par l’évolution darwinienne à travers des mécanismes tels que :
- La sélection de parentèle : Les gènes qui favorisent l’altruisme envers les proches (qui partagent statistiquement les mêmes gènes) peuvent se propager dans le pool génétique.
- L’altruisme réciproque : L’aide mutuelle entre individus non apparentés peut être avantageuse à long terme si la réciprocité est assurée, y compris via la réputation.
- Le principe du handicap / signal honnête : Des actes altruistes coûteux peuvent servir de signal honnête de richesse, de statut ou de dominance, attirant ainsi des partenaires ou des alliés.
Pour Dawkins, nos « exigences du Bon Samaritain » sont des « ratés, des erreurs darwiniennes, des erreurs bénies et précieuses » des règles d’or de l’évolution. Il cite une étude de Hauser et Singer qui n’a pas trouvé de différence significative dans les jugements moraux entre athées et croyants, soutenant l’idée que nous n’avons pas besoin de Dieu pour être bons.
Dawkins passe en revue la « Sainte » Bible comme source de principes moraux, et conclut qu’une lecture honnête révèle des enseignements « odieuses » selon les standards modernes. Il cite de nombreux exemples choquants :
- Lot et Sodome : Offrir ses filles vierges à une foule pour les violer afin de protéger des étrangers.
- Le Lévite de Givéa : Offrir sa concubine à un groupe d’hommes pour la violer, conduisant à sa mort et à son démembrement.
- Abraham et Isaac : L’ordre divin de sacrifier son propre fils.
- Jephté : Sacrifier sa propre fille en holocauste après une victoire promise par Dieu.
- Massacres et génocides : Les commandements divins d’exterminer des populations entières (Madianites, Jéricho).
- Péché originel et expiation : La doctrine chrétienne qui « condamne tout enfant, même avant sa naissance, à hériter le péché d’un ancêtre lointain » et l’idée de l’exécution d’un innocent (Jésus) pour « racheter les péchés des coupables » sont jugées « folie furieuse » et « vicieusement déplaisantes ».
Il souligne que « Tu aimeras ton prochain » dans la Bible ne s’appliquait à l’origine qu’aux « autres juifs » et non à l’humanité entière. Une étude terrifiante de George Tamarin, où des écoliers israéliens ont jugé l’action de Josué à Jéricho (génocide) comme moralement acceptable parce que c’était un commandement divin, démontre l’impact de l’éducation religieuse sur la morale.
Dawkins met en évidence le « Zeitgeist moral », l’idée que la moralité collective évolue au fil du temps vers plus de compassion et d’inclusivité, indépendamment de la religion, et souvent « malgré la religion ». Il cite des exemples de vues autrefois acceptables (racisme, eugénisme) qui sont aujourd’hui abhorrées.
Quant à l’argument que les dictateurs comme Hitler et Staline étaient athées et responsables d’atrocités, Dawkins le rejette. Il montre qu’Hitler était en réalité influencé par des traditions chrétiennes antisémites et qu’il a manipulé la religion à des fins politiques, affichant parfois sa foi pour le peuple. Pour Dawkins, le danger réside dans la foi religieuse qui « permet à des êtres humains normaux par ailleurs de récolter les fruits de la folie, et de les considérer comme saints ».
L’Endoctrinement des Enfants et les Dangers de l’Absolutisme 👶🛑
Pour Richard Dawkins, l’endoctrinement religieux des enfants est une forme de maltraitance. Il cite l’affaire d’Edgardo Mortara, un enfant juif enlevé par l’Inquisition au XIXe siècle parce qu’il avait été secrètement baptisé par sa nourrice catholique. Les autorités religieuses ont défendu l’enlèvement comme un acte de charité, croyant sincèrement le « sauver » de sa famille juive. Cette histoire illustre comment la religion peut « fausser le jugement et bafouer le respect élémentaire dû à la personne humaine ».
Il déplore la pratique de coller des étiquettes religieuses sur les enfants dès leur plus jeune âge, comme « écolières catholiques » ou « enfants musulmans », au lieu de leur laisser le droit de choisir leurs propres croyances une fois adultes.
Dawkins s’inquiète également de l’enseignement du créationnisme et du dessein intelligent dans les écoles financées par l’État, comme l’Emmanuel College au Royaume-Uni. Le chef du département des sciences de cette école affirmait que l’Écriture doit être préférée à la science en cas de conflit, et que l’histoire du déluge de Noé est une « vérité historique ». Dawkins y voit une « subversion de la science » et une preuve de la « folie » de la diversité culturelle lorsqu’elle s’applique à des croyances non vérifiables.
L’ouvrage dénonce la « face sombre de l’absolutisme » religieux, qui conduit à des actes de cruauté et d’intolérance. Il cite la condamnation à mort pour blasphème au Pakistan, l’intolérance des « talibans américains » contre les homosexuels ou les avorteurs. Le « sophisme de Beethoven » (ou « grand sophisme pro-vie ») est analysé comme un argument fallacieux utilisé pour justifier l’opposition à l’avortement en se basant sur le « potentiel » de l’embryon, ignorant la logique et les faits.
Pour Dawkins, la « modération » religieuse engendre le fanatisme. En acceptant l’idée de la foi non justifiée, même les religieux modérés créent un terrain fertile pour l’extrémisme. Les actes terroristes, comme le 11 septembre ou les attentats de Londres, sont le résultat logique de croyances en un paradis des martyrs et l’obéissance inconditionnelle à des textes sacrés, non pas une « perversion » de la foi, mais sa manifestation la plus extrême.
Le Vide Nécessaire : Inspiration et Consolation sans Dieu ✨📖
Malgré sa critique cinglante, Dawkins ne laisse pas ses lecteurs dans un « vide ». Il soutient que la science et une vision du monde non religieuse peuvent offrir une consolation et une inspiration bien plus profondes et authentiques que la religion.
Il rejette l’idée que les athées sont « découragés, malheureux et angoissés », citant des exemples d’athées heureux et accomplis. La consolation religieuse est souvent fondée sur des « mythes humanisants traditionnels » ou sur l’idée neurologiquement « peu plausible » de la survie de l’âme après la mort du cerveau. Dawkins critique la vente d’indulgences et la doctrine du purgatoire comme des « arnaques pour faire de l’argent ».
La science, en revanche, ouvre l’esprit à une splendeur immense et à une joie profonde. Le monde tel que révélé par la science est « beaucoup plus riche que celui médiocre et utilitaire dont nos ancêtres avaient besoin pour survivre ». Il évoque l’émerveillement face à une galaxie lointaine, à un fossile ancien, ou à la compréhension de la physique quantique, même si elle est étrange. Pour Dawkins, l’univers sans Dieu est un lieu de « beauté et de sublime », offrant une « splendeur qui leur est propre ».
Enfin, Dawkins reconnaît la valeur littéraire et culturelle de la Bible, même si ses enseignements moraux sont rejetés et ses récits historiques mis en doute. Il liste de nombreuses expressions courantes dans la langue anglaise qui sont directement tirées de la Bible, soulignant qu’une connaissance de la Bible enrichit l’appréciation de la littérature et de la culture. Cependant, il insiste sur la distinction entre cette valeur culturelle et toute prétention à la vérité littérale ou à l’autorité morale.
Réflexions Finales : Un Appel à la Raison et à la Liberté de Pensée 🗣️🧠
« Pour en finir avec Dieu » est bien plus qu’une attaque contre la religion. C’est un plaidoyer passionné pour la raison, la pensée critique et la liberté intellectuelle. Dawkins encourage les lecteurs à remettre en question toute autorité qui ne repose pas sur des preuves. Il dénonce la tendance à accorder à la religion un respect injustifié, ce qui étouffe le débat et favorise le dogmatisme.
L’ouvrage vise à donner aux athées une voix et une légitimité, en les encourageant à « se déclarer » et à ne pas céder à la pression sociale. Il montre que la science offre un cadre pour comprendre le monde qui est non seulement intellectuellement plus solide, mais aussi source d’une immense émerveillement et d’une profonde satisfaction.
Richard Dawkins, par son style direct et argumenté, cherche à convaincre que l’abandon de la foi n’est pas une perte, mais une libération, ouvrant la voie à une vie pleinement enrichissante, basée sur la beauté de la réalité scientifique et les valeurs morales universelles issues de notre nature humaine, et non de dogmes ancestraux. Son livre est un appel retentissant à embrasser une vision du monde où la raison est la boussole et la science, notre guide pour explorer l’immense mystère de l’existence.