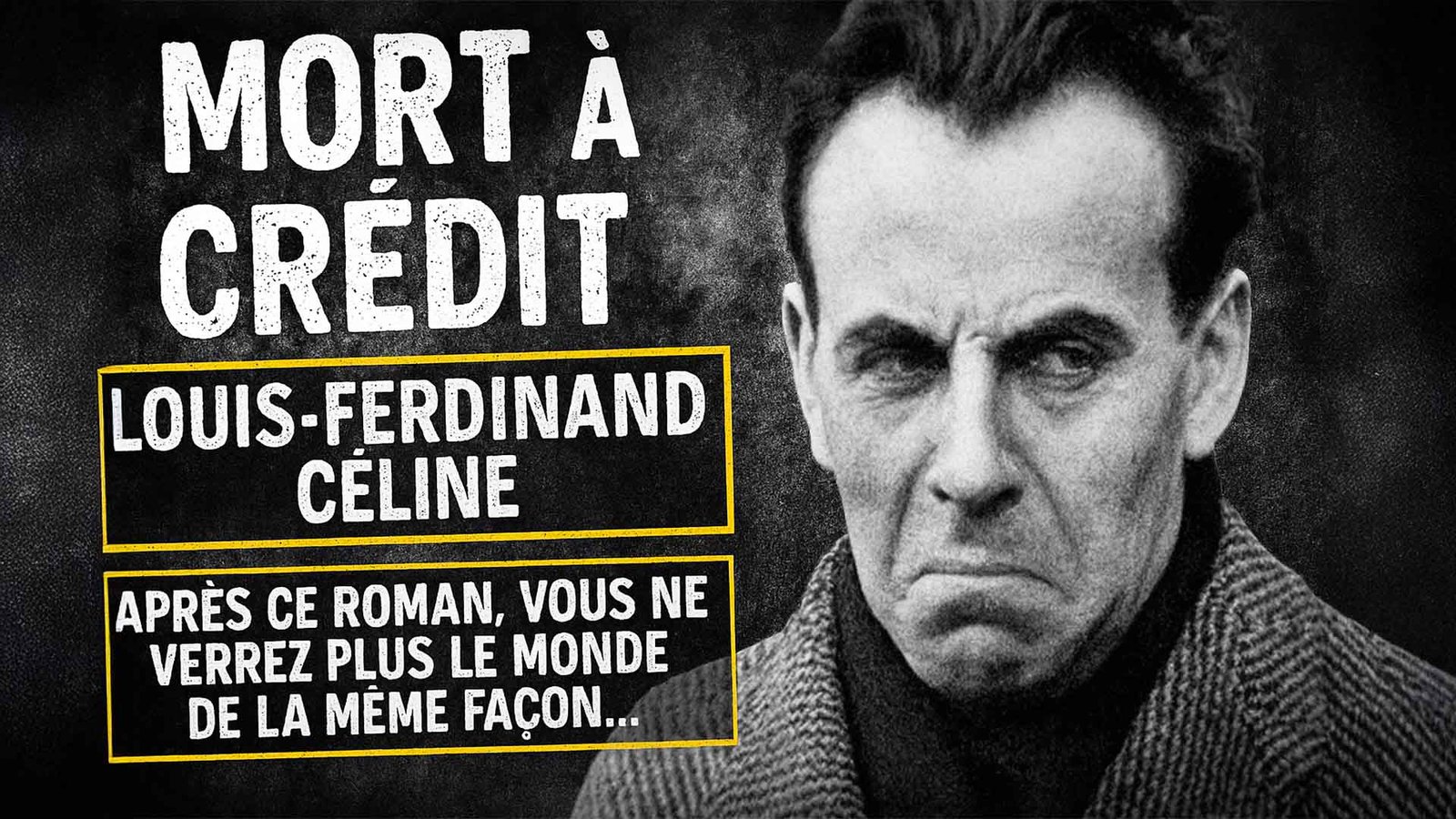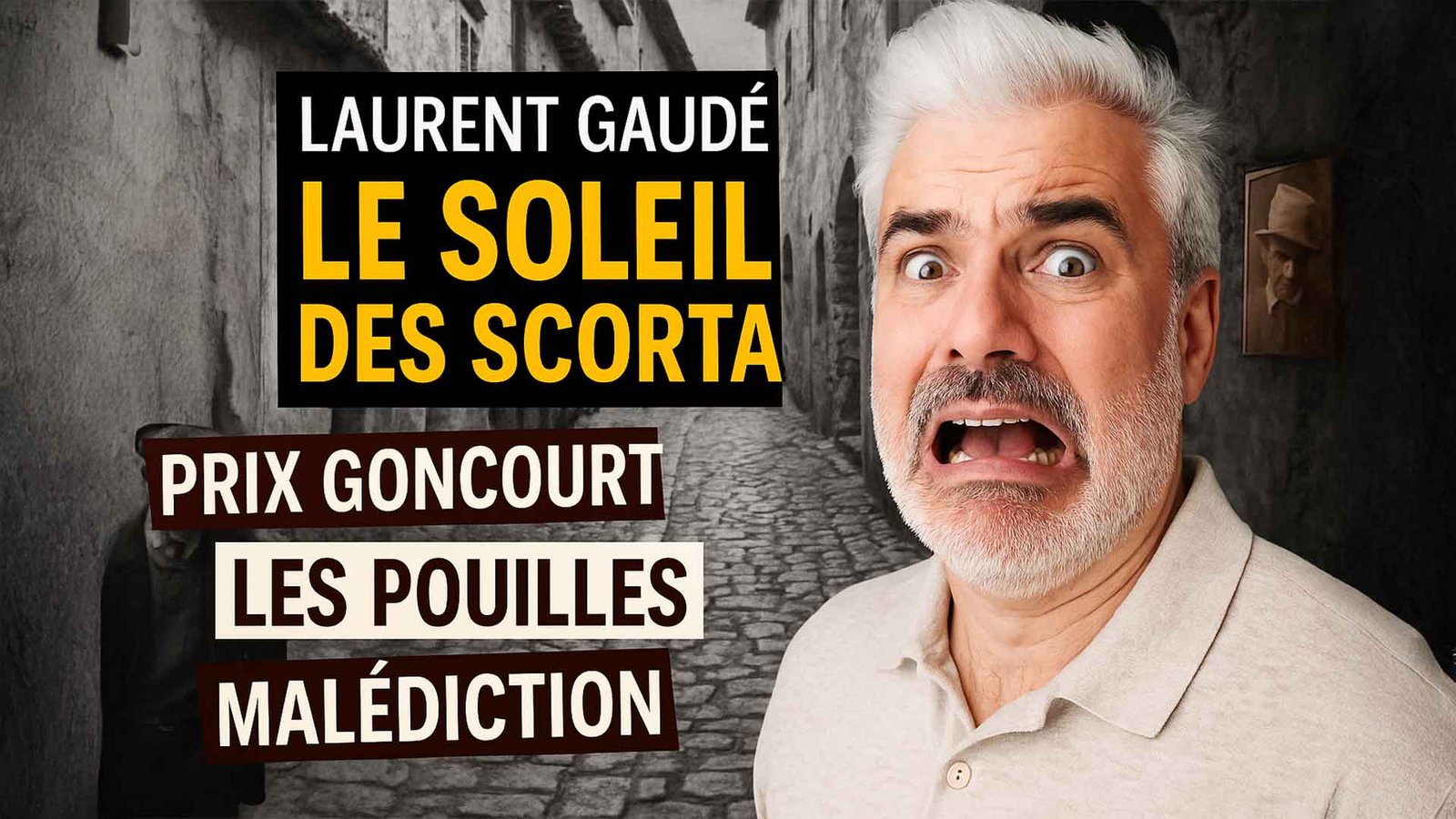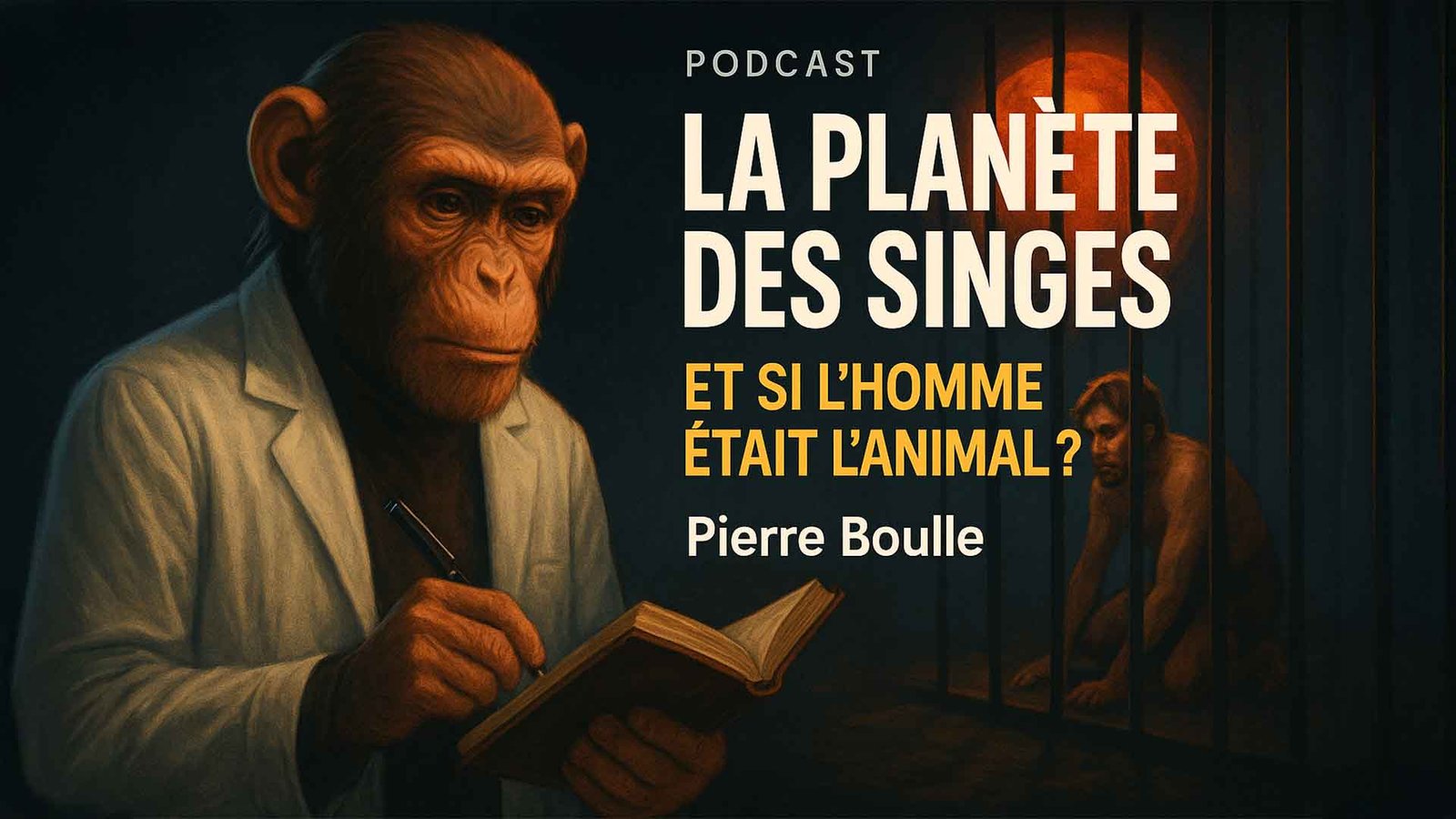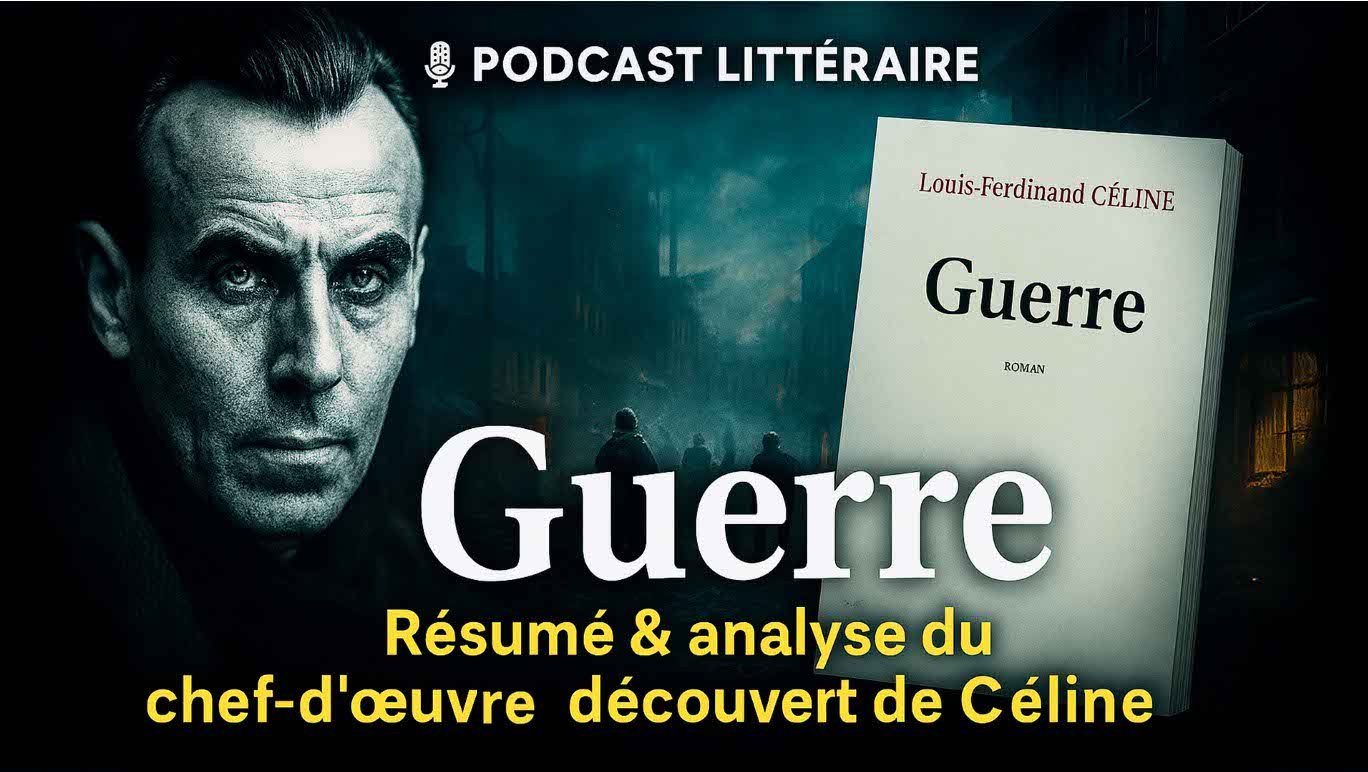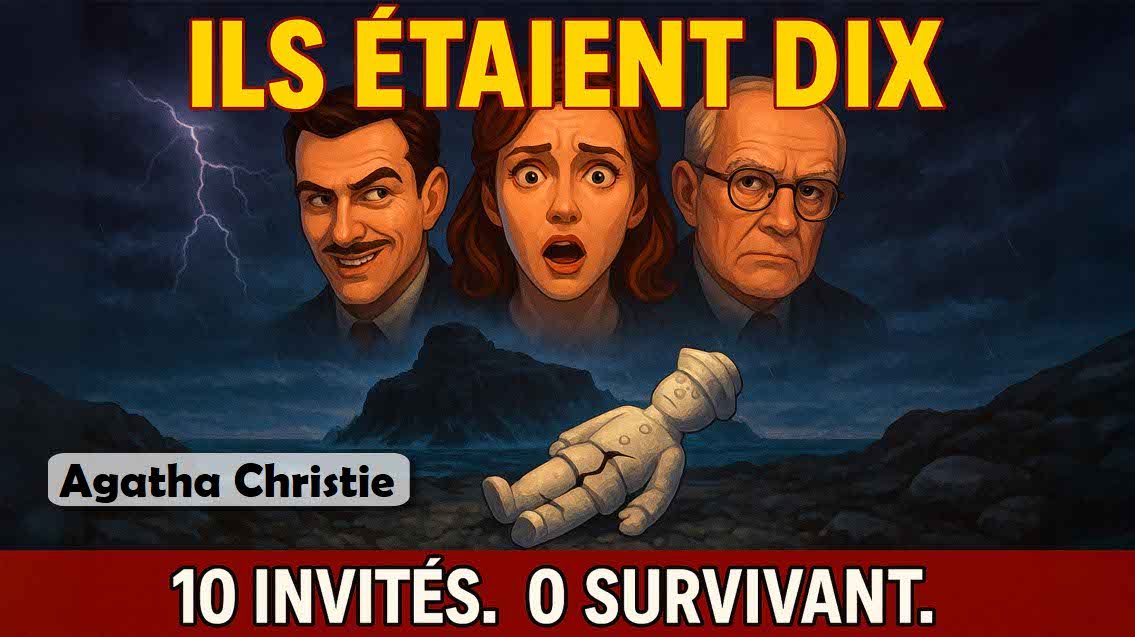Les liens pour vous procurer les différentes versions
📗Lien vers le livre papier : https://amzn.to/3TdHIwm
📘🎧Lien vers le livre audio : https://amzn.to/4kA1w8x
📕Lien vers l’ebook : https://amzn.to/40qIQAv (gratuit)
« Madame Bovary » de Gustave Flaubert : Plongée au Cœur d’un Chef-d’œuvre Controversé 📚
Découvrez l’un des romans les plus emblématiques de la littérature française, « Madame Bovary » de Gustave Flaubert. Publié pour la première fois en feuilleton en 1856, cette œuvre majeure a non seulement marqué le réalisme littéraire, mais a également déclenché un retentissant procès pour outrage à la morale publique et religieuse. Cet article vous propose un résumé détaillé et une analyse approfondie de ce roman révolutionnaire, explorant ses thèmes, ses personnages et son impact intemporel. Plongez dans la vie d’Emma Bovary, une femme provinciale en quête d’idéal romantique, et comprenez pourquoi son histoire résonne encore aujourd’hui.
Contexte et Publication : Un Procès Mémorable ⚖️
« Madame Bovary » n’est pas seulement un roman ; c’est aussi le cœur d’une affaire judiciaire qui a secoué la France du Second Empire. Le procès intenté à Gustave Flaubert pour son œuvre est une partie intégrante de son histoire et de sa réception.
La Genèse du Roman ✍️
Gustave Flaubert a consacré cinq années à l’écriture de « Madame Bovary », de 1851 à 1856. Ce travail acharné a abouti à une œuvre d’une grande précision stylistique et d’une observation minutieuse de la société de son temps. Le roman a initialement été publié dans la Revue de Paris sous forme de feuilleton, de septembre 1856 au 15 décembre 1856. Cette publication progressive, courant sur six livraisons, a permis au public de découvrir l’histoire d’Emma Bovary chapitre par chapitre.
Le Procès pour « Outrage à la Morale Publique et Religieuse » 🏛️
En février 1857, Gustave Flaubert, ainsi que Léon Laurent-Pichat (le gérant de la Revue de Paris) et l’imprimeur Auguste-Alexis Pillet, furent accusés d’outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Ce procès fut un événement majeur, reflétant les tensions entre la liberté artistique et les conservatismes de l’époque.
Les Arguments de l’Accusation (M. Ernest Pinard) 🗣️
Le procureur impérial, M. Ernest Pinard, a présenté un réquisitoire virulent, critiquant l’œuvre pour son contenu jugé immoral et irréligieux. Il a décrit le roman comme l’ « Histoire des adultères d’une femme de province« , un titre qu’il considérait plus juste que « Mœurs de province ».
Pinard a ciblé plusieurs aspects du roman :
- La Représentation d’Emma Bovary : Selon l’accusation, Flaubert n’avait pas cherché à montrer Emma du côté de son intelligence, de son cœur ou de son esprit. Sa beauté physique n’était dépeinte qu’après son adultère, et de manière lascive et provocatrice. L’œuvre glorifiait la « poésie de l’adultère » face aux « platitudes du mariage », ce qui était jugé profondément immoral.
- Les Scènes Incriminées : Pinard a mis l’accent sur quatre « tableaux » principaux:
- Les amours et la chute avec Rodolphe : Il a souligné les descriptions des préludes à l’adultère, comme le contact des doigts et le baiser où Emma cherche le consentement de Rodolphe. La description d’Emma après sa « chute » était présentée comme une « glorification de l’adultère » qui la rendait plus belle.
- La transition religieuse : Pinard a dénoncé le mélange du sacré et du voluptueux, citant le passage où Emma invente de « petits péchés » en confession pour prolonger le moment et où les comparaisons avec un « amant céleste » et un « mariage éternel » lui procurent des « douceurs inattendues ». Il a également mentionné la scène où Emma, se croyant mourante, demande la communion et ressent un « anéantissement dans cet amour » divin, transformant un acte sacré en une expérience de plaisir.
- Les amours avec Léon (le deuxième adultère) : La scène du fiacre, bien que coupée par la Revue de Paris, était implicitement incriminée pour sa suggestion de licence. Les descriptions de la chambre d’hôtel et du déshabillage d’Emma étaient jugées lascives. Pinard a également noté la « fatigue de la volupté » d’Emma, où elle retrouve dans l’adultère « toutes les platitudes du mariage ».
- La mort de Madame Bovary : Le procureur a critiqué le fait qu’au moment de l’extrême-onction, une chanson profane de l’aveugle retentisse, mêlant le sacré au profane et au voluptueux.
- La Conclusion Immorale du Livre : Pinard a soutenu que l’œuvre n’était pas morale au fond, car Emma meurt « non parce qu’elle est adultère, mais parce qu’elle l’a voulu », dans « tout le prestige de sa jeunesse et de sa beauté », sans qu’aucun personnage du livre ne la condamne. Le mari, Charles, est dépeint comme « béat » et « grotesque » et continue d’aimer Emma au-delà de la tombe, même après avoir découvert ses trahisons. Le sentiment religieux est personnifié par le curé Bournisien, jugé « matérialiste » et « ridicule », tandis que l’opinion publique est incarnée par l’ « être grotesque » qu’est le pharmacien Homais.
La Plaidoirie de la Défense (Me Jules Sénard) 🛡️
L’avocat Jules Sénard a défendu Flaubert avec passion et intelligence. Il a affirmé que le livre était, au contraire, profondément moral, voire religieux, son objectif étant « l’excitation à la vertu par l’horreur du vice ».
Sénard a mis en avant plusieurs points clés :
- La Dignité de l’Auteur : Il a souligné le caractère sérieux et studieux de Flaubert, issu d’une famille respectable (son père, chirurgien en chef à Rouen, était un ami personnel de Sénard). Flaubert, un homme de « nature grave, aux choses tristes », avait dévoué sa vie à l’étude et aux lettres, et « Madame Bovary » était son premier ouvrage.
- La Nature Réaliste de l’Œuvre : Sénard a expliqué que Flaubert appartenait à l’école réaliste et psychologique, cherchant à créer des « types vrais » et à dépeindre la réalité humaine et le développement des passions. Il a réfuté le titre « Histoire des adultères d’une femme de province » proposé par Pinard, suggérant plutôt « Histoire de l’éducation trop souvent donnée en province » et des « périls auxquels elle peut conduire », ou la « dégradation, la friponnerie, le suicide considéré comme conséquence d’une première faute ».
- La Sobriété des Descriptions : Contrairement aux accusations, Sénard a affirmé que les passages « lascifs » étaient en fait très peu nombreux (une proportion de 1 sur 500 lignes). Il a insisté sur le fait que Flaubert, contrairement à d’autres auteurs, faisait preuve d’une grande retenue descriptive dans les scènes intimes, se contentant d’un « mot » là où d’autres auraient décrit « toute la beauté du corps ». La scène du fiacre, par exemple, ne décrivait qu’une « main nue qui passa sous les petits rideaux de toile jaune et jeta des déchirures de papier ». La « coupure » de la Revue de Paris avait créé la suspicion, mais le texte original était bien plus suggéré qu’explicite.
- L’Expiation du Vice : Le défenseur a martelé que le roman montrait clairement que l’adultère n’apportait que « tourments, regrets, remords » et menait à une « expiation finale, épouvantable ». Emma connaissait la déception dès le lendemain de ses « chutes ». La mort d’Emma, décrite avec des « taches » et des « vomissements du poison », était délibérément rendue « hideuse » et « affreuse » pour illustrer l’horreur du vice.
- La Morale Religieuse : Sénard a souligné que Flaubert parlait de religion avec respect, comme en témoignent les descriptions des souvenirs d’Emma au couvent et de sa vision céleste lors de la communion. Il a même révélé que Flaubert s’était inspiré de textes religieux, comme des écrits de Bossuet et Massillon, pour dépeindre la concupiscence et les affres des passions. Le curé Bournisien, loin d’être un objet de raillerie, est un « ecclésiastique ordinaire » qui remplit son ministère avec dévouement, tandis qu’Homais, le « prêtrophobe », est celui qui est « battu, bafoué, ridiculisé » dans ses querelles contre la religion.
- La Figure de Charles Bovary : Sénard a insisté sur la supériorité morale de Charles, qui, malgré sa médiocrité, reste fidèle à son devoir. Sa mort, après celle d’Emma, est présentée comme « aussi belle, aussi touchante » que celle de sa femme est « hideuse ».
Finalement, le tribunal a reconnu que les passages incriminés pouvaient être jugés répréhensibles « envisagés abstractivement et isolément », et que l’ouvrage méritait un « blâme sévère » car la littérature devrait « orner et recréer l’esprit en élevant l’intelligence et en épurant les mœurs » plutôt que de « donner le dégoût du vice en offrant le tableau des désordres ». Cependant, il a conclu qu’il n’était « pas suffisamment établi que Pichat, Gustave Flaubert et Pillet se soient rendus coupables des délits qui leur sont imputés », et les a acquittés de toutes les accusations. Ce jugement fut une victoire majeure pour la liberté artistique.
Résumé Détaillé de l’intrigue 📖
« Madame Bovary » est un roman de mœurs qui dépeint avec un réalisme saisissant la vie d’Emma Rouault et de son époux, Charles Bovary, dans la province française du XIXe siècle.
Les Origines de Charles Bovary 👨⚕️
Le roman débute en nous présentant Charles Bovary, un jeune homme au tempérament modéré et à l’intelligence limitée. Son père, M. Charles-Denis-Bartholomé Bovary, un ancien aide-chirurgien-major qui avait dû quitter le service suite à des affaires de conscription vers 1812, avait épousé une marchande bonnetière pour sa dot de soixante mille francs. Cet homme hâbleur, aux manières voyantes et aux doigts toujours garnis de bagues, dépensait la fortune de sa femme en dînant bien, se levant tard, fumant la pipe et fréquentant les cafés.
Les parents de Charles avaient des visions différentes pour son éducation. Sa mère souhaitait qu’il soit élevé « durement, à la spartiate », lui apprenant à boire du rhum et à insulter les processions, tandis que son père, peu soucieux des lettres, disait qu’ « avec du toupet, un homme réussit toujours dans le monde ». Il commença le latin avec le curé de son village avant d’être envoyé au collège de Rouen « le plus tard possible » par économie. Charles était un élève moyen, « sans guère d’élégance dans les tournures ».
Après le collège, il étudia la médecine à Rouen, obtenant le grade d’officier de santé. Durant ses études, il fréquentait les cabarets, manquait des cours et avait pour seule passion le jeu de dominos. Ses « travaux préparatoires » le firent échouer à son premier examen, mais il réussit le second après avoir « appris d’avance toutes les questions par cœur ».
Charles s’installa ensuite comme médecin à Tostes, prenant la succession d’un vieux praticien dont sa mère « guettait la mort ». Avant son mariage avec Emma, il fut marié pendant quatorze mois à une veuve, Héloïse Dubuc, dont les « pieds, dans le lit, étaient froids comme des glaçons ». Elle avait une « taille dure » et était « maigre », portant un « petit châle noir » et des « bas gris ». La mère de Charles, qui visitait souvent, ne s’entendait pas avec sa belle-fille, la trouvant trop dépensière. Elles se querellaient et « scarifiaient » Charles par leurs réflexions. La veuve Dubuc perdit finalement sa fortune à cause d’un notaire indélicat, ce qui mit Charles en fâcheuse posture financière et le libéra de ce mariage non désiré.
La Rencontre et le Mariage avec Emma Rouault 💖
L’occasion de se remarier se présenta lorsque Charles fut appelé pour soigner la jambe cassée de M. Rouault, un cultivateur aisé des Bertaux. C’est là qu’il rencontra Emma, la fille unique de M. Rouault, qui l’aidait à tenir la maison. Charles fut frappé par la blancheur et la finesse de ses ongles, ainsi que par la hardiesse candide de ses « yeux bruns » qui semblaient noirs.
Charles commença à se rendre aux Bertaux avec un plaisir non dissimulé, appréciant l’ambiance de la ferme, l’hospitalité de M. Rouault et la présence d’Emma. Le père Rouault, de son côté, n’était pas fâché de se « débarrasser de sa fille », qu’il jugeait « trop d’esprit pour la culture » et qui ne lui était « servait guère » à la ferme. Il voyait en Charles un gendre « de bonne conduite, économe, fort instruit » qui ne « chicanerait pas trop sur la dot ».
Charles, quant à lui, était timide et n’osait pas faire sa demande en mariage. Ce fut finalement l’affaire de la veuve Dubuc qui précipita les choses. Sur les conseils de son père, Charles retourna aux Bertaux et, après la mort de sa première femme, demanda la main d’Emma.
Le mariage fut célébré sous un hangar de la charretterie, avec un festin abondant et une « pièce montée qui fit pousser des cris ». Cependant, Charles, de « complexion facétieuse », ne brilla pas pendant la noce, répondant « médiocrement aux pointes, calembours, mots à double entente ». Emma, avant le mariage, « avait cru avoir de l’amour ; mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n’étant pas venu, il fallait qu’elle se fût trompée ».
La Vie à Tostes et les Désillusions d’Emma 🏡
Après leur mariage, Charles et Emma s’installèrent à Tostes. Leur maison, bien que simple, avait une bibliothèque garnie de dictionnaires médicaux et une cour menant à une écurie et un bûcher. Le jardin, plus long que large, abritait un cadran solaire et un « curé de plâtre ». La chambre conjugale, avec son lit d’acajou et une boîte en coquillages, contenait également le bouquet de mariée de la première Madame Bovary, qu’Emma regarda et que Charles s’empressa de cacher.
Rapidement, Emma commença à s’ennuyer et à désenchanter de sa vie conjugale. Elle se demandait ce qu’étaient « félicité, passion et ivresse » qu’elle avait lues dans les livres. Son éducation au couvent, où elle avait lu des romans romantiques décrivant des « amours, amants, amantes, dames persécutées » et des « Messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux », avait forgé en elle un idéal de vie passionnante et luxueuse. Elle rêvait de « hautes positions », de « sensualités du luxe avec les joies du cœur », et trouvait la « campagne ennuyeuse », les « petits bourgeois imbéciles » et la « médiocrité de l’existence » comme une « exception » où elle se trouvait « prise ». Elle comparait Charles, avec sa « platitude », à un cheval de manège, tournant en rond sans comprendre la « besogne qu’il broie ».
Un événement marquant fut le bal au château de la Vaubyessard, une invitation inattendue. Pour Emma, ce fut une « initiation à toutes les ardeurs de la volupté », une « vision splendide ». Elle y fut éblouie par le luxe, les conversations sur l’Italie et les courses de chevaux, et dansa avec un vicomte dont la barbe sentait la « vanille et le citron ». Le duc de Laverdière, ancien amant supposé de Marie-Antoinette, attira particulièrement son attention. Elle espérait que sa vie deviendrait comme celle qu’elle imaginait à travers ses lectures et cette soirée.
Le retour à la réalité de Tostes fut brutal. Emma en fut anéantie. Elle commença à s’abonner à des journaux de mode comme La Corbeille et Le Sylphe des salons, dévorant les comptes rendus de spectacles et s’intéressant aux « modes nouvelles ». Elle lisait Balzac et Eugène Sue, « y cherchant des assouvissements imaginaires pour ses convoitises personnelles ». Elle maigrissait, sa figure s’allongeait, et elle adopta une « expression dolente ». Elle se mit même à boire du vinaigre pour « se faire maigrir ».
Charles, quant à lui, ne comprenait pas son malaise. Il s’endormait en lisant son journal de médecine. Emma, espérant que son nom de Bovary devienne « illustre », déplorait le manque d’ambition de son mari. Elle essayait parfois de lui parler des choses qu’elle avait lues, mais Charles n’était qu’une « oreille toujours ouverte, une approbation toujours prête ». Les visites de la mère de Charles exacerbaient les tensions, la belle-mère critiquant les dépenses d’Emma et son mode de vie trop « relevé ».
Le Déménagement à Yonville et l’Arrivée de Léon 🚂
Pour tenter de remédier à la « maladie nerveuse » d’Emma, Charles décida de déménager à Yonville-l’Abbaye, un « fort bourg » près de Neufchâtel, où le médecin polonais venait de partir. Yonville, bien que doté d’une nouvelle route, était resté « stationnaire », un lieu modeste avec une église à la voûte pourrie et des tombes entassées autour d’elle.
La pharmacie de M. Homais était l’attraction principale du village, avec ses « bocaux rouges et verts » et ses inscriptions vantant divers produits. Homais, un personnage pompeux et prétentieux, se croyait l’esprit le plus éclairé d’Yonville.
C’est à Yonville qu’Emma fit la connaissance de Léon Dupuis, le jeune clerc de notaire local. Tous deux partageaient des goûts romantiques pour les couchers de soleil, la mer, la musique allemande et la littérature. Leurs conversations reflétaient leur idéal commun, et une « sorte d’association, un commerce continuel de livres et de romances » s’établit entre eux. Léon, comme Emma, s’ennuyait dans le village.
Emma accoucha d’une fille, Berthe. Charles souhaitait l’appeler comme sa mère, mais Emma s’y opposa, préférant des noms aux terminaisons italiennes. Le nom de Berthe fut finalement choisi en souvenir d’une jeune femme rencontrée au château de la Vaubyessard. Homais, parrain, offrit des produits de sa pharmacie en cadeau.
Après la naissance de Berthe, Emma connut une période de retour à une vie plus domestique et religieuse. Elle chercha à se donner de l’amour, « d’après des théories qu’elle croyait bonnes ». Elle acheta des chapelets, des amulettes, et voulut devenir une sainte, aspirant à un « état de pureté flottant au-dessus de la terre, se confondant avec le ciel ». Cependant, cette ferveur fut de courte durée. Elle s’irrita contre les « prescriptions du culte » et les écrits religieux qu’elle jugeait ignorants du monde. Progressivement, elle s’éloigna de l’église et des Homais.
Pendant ce temps, Léon, timide et inexpérimenté, dut partir pour Paris afin de poursuivre ses études de droit. Son départ laissa Emma dans un « ennui prodigieux ». Charles, « peu jaloux », ne s’inquiétait pas de l’amitié entre Emma et Léon.
L’Amour Adultère avec Rodolphe Boulanger 🌹
La solitude d’Emma fut brisée par l’arrivée de Rodolphe Boulanger, un riche propriétaire terrien de La Huchette, « bel homme, hâbleur ». Âgé de trente-quatre ans, Rodolphe était un séducteur cynique, habitué aux « conquêtes faciles ». Il décida de faire d’Emma sa maîtresse, la trouvant « fort gentille », avec de « belles dents, les yeux noirs, le pied coquet, et de la tournure comme une Parisienne ».
Leur relation débuta véritablement lors des Comices agricoles d’Yonville. Pendant que les discours officiels se déroulaient, Rodolphe et Emma conversaient en parallèle, leurs paroles dissimulant un jeu de séduction subtil. Tandis que M. Lieuvain, le conseiller, louait le gouvernement et l’agriculture, Rodolphe murmurait des mots doux à Emma, leurs doigts finissant par se « confondre ». Ce moment est un exemple parfait du réalisme flaubertien, où le prosaïsme de la vie provinciale se mêle à l’émergence de la passion.
Leur première rencontre charnelle eut lieu dans la forêt, lors d’une promenade à cheval organisée par Charles pour la santé d’Emma. Emma s’abandonna, sentant son cœur battre « comme si le cadre de son être craquait ». Après cette première « audace », Emma multiplia les rendez-vous secrets avec Rodolphe, souvent le matin, se levant avant Charles et courant à travers champs pour le retrouver. Elle y arrivait « essoufflée, les joues roses, et exhalant de toute sa personne un frais parfum de sève, de verdure et de grand air ». Rodolphe, lui, la recevait souvent encore endormi.
Ces rencontres devinrent une routine. Emma se sentait transportée, mais l’illusion ne tarda pas à s’effriter. Rodolphe, lassé, finit par lui écrire une lettre de rupture, dans laquelle il invoquait la cruauté du monde et son « exil » pour se « punir » du mal qu’il lui avait fait. Il signa simplement « Votre ami » et laissa tomber une goutte d’eau, simulant une larme.
La réception de cette lettre fut un choc terrible pour Emma. Elle eut une « fièvre cérébrale », suivie d’une « fièvre typhoïde ». Charles, dévoué, resta à son chevet pendant quarante-trois jours, abandonnant ses malades et cherchant désespérément à la soigner. Sa mère, Madame Bovary mère, profita de la situation pour tenter d’empêcher Emma de lire des romans, qu’elle jugeait néfastes.
L’Échec de l’Opération d’Hippolyte et les Problèmes Financiers 📉
Au paroxysme de la maladie d’Emma, M. Homais, toujours avide de reconnaissance, incita Charles à tenter une opération novatrice pour corriger le pied bot d’Hippolyte, le garçon d’auberge du Lion d’Or. Homais y voyait une opportunité d’acquérir de la célébrité pour le médecin et d’envoyer une « petite note » au journal pour sa propre promotion. Emma, cherchant un « quelque chose de plus solide que l’amour » sur lequel s’appuyer, encouragea Charles.
Charles, malgré son manque d’expérience, se laissa convaincre. Il étudia la méthode du docteur Duval et fit construire un appareil complexe. L’opération, qui consistait à couper le tendon d’Achille, fut réalisée devant une foule curieuse, organisée en grande partie par Homais pour « éblouir la multitude ». Homais rédigea un article dithyrambique pour le Fanal de Rouen, vantant le « succès » de l’opération et prédisant qu’Hippolyte figurerait bientôt dans des « danses bachiques ».
Cependant, le pied d’Hippolyte s’aggrava rapidement, développant une gangrène due à l’appareil. Le célèbre docteur Canivet de Neufchâtel fut appelé. Il se moqua de l’opération de Charles, la qualifiant d' »invention de Paris » et une « monstruosité », avant de procéder à l’amputation de la jambe. Ce fut un événement majeur pour Yonville. Charles fut anéanti par l’échec et l’humiliation publique. Emma, de son côté, fut envahie par un « immense regret » d’avoir pu « s’imaginer qu’un pareil homme pût valoir quelque chose » et retrouva son mépris pour Charles.
Cette période fut également le début de la ruine financière du couple. M. Lheureux, le marchand de nouveautés, un Gascon astucieux devenu Normand, profita de la faiblesse de Charles et des désirs d’Emma. Il lui vendit des marchandises à crédit, lui fit souscrire des billets à ordre, et réussit à lui faire signer une procuration générale pour « gérer et administrer ses affaires ». Emma, sans aucune notion de gestion, se retrouva rapidement endettée et fut forcée de vendre les quelques biens de son mari, y compris une petite ferme à Barneville. Charles, naïf, accepta la procuration, la voyant comme une preuve de confiance et « sa femme était un ange ».
Le Retour de Léon et la Spirale Infernale 🌀
Trois ans après son départ, Léon Dupuis revint à Rouen, plus confiant et « expérimenté » par son séjour parisien. Emma et Charles le retrouvèrent lors d’une visite à l’opéra de Rouen, où ils assistèrent à Lucie de Lammermoor. La performance du ténor Edgar Lagardy ravit Emma, et elle se sentit à nouveau transportée par des « rêves de volupté ».
La passion entre Emma et Léon se ralluma. Le jour suivant, lors d’un rendez-vous dans la cathédrale, Léon la poussa dans un fiacre, scène célèbre pour son caractère évocateur bien que non explicite dans la version publiée.
Les rendez-vous se multiplièrent dans une chambre louée à Rouen. Emma vivait ses nouvelles ardeurs avec fureur, « se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre ». Cependant, Léon commença à se lasser. Il se sentait « révolté contre l’absorption, chaque jour plus grande, de sa personnalité ». Emma, percevant son éloignement, redoubla de « coquetteries » et d’attentions, lui offrant même une médaille de la Vierge pour le retenir.
Pendant ce temps, les dettes s’accumulaient. Lheureux la harcelait, brandissant des billets à ordre et menaçant de saisir ses biens. Emma était désespérée, tentant de vendre ses vieux objets, falsifiant des factures et allant jusqu’à demander de l’argent à Léon, qui recula devant l’idée d’un « crime » pour l’obtenir. Elle essaya de séduire M. Guillaumin, le notaire, pour lui emprunter de l’argent, mais celui-ci, après avoir tenté de la toucher, recula devant son indignation.
La Fin Tragique 💀
Acculée par les dettes et les huissiers, Emma se retrouva sans issue. Un jour, en fouillant dans la pharmacie d’Homais, elle trouva un bocal d’arsenic. Sans hésitation, elle l’ingéra, dans un acte de « sérénité d’un devoir accompli ».
Son agonie fut longue et atroce, décrite avec un réalisme clinique par Flaubert. Charles, Homais et Canivet tentèrent en vain de la sauver, impuissants face au poison. Le curé Bournisien fut appelé pour lui administrer l’extrême-onction. Au moment de sa mort, on entendit le chant de l’aveugle mendiant, qu’Emma avait souvent croisé et qui la poursuivait de son chant obscène. Ce chant résonnait alors qu’elle sombrait, « une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s’approchèrent. Elle n’existait plus ».
Charles fut dévasté par la mort de sa femme. Il demanda qu’elle soit enterrée dans sa robe de mariée, avec des souliers blancs et une couronne, sous un grand morceau de velours vert. Le père Rouault vint pour l’enterrement, et Homais, toujours soucieux des apparences, remarqua l’absence de Binet et le port d’un habit bleu par le domestique du notaire, jugeant cela « peu convenable ».
Quelques temps plus tard, Charles, errant dans sa maison, découvrit la lettre de rupture de Rodolphe. Bien qu’elle le bouleversât, il se laissa illusionner par le « ton respectueux de la lettre » et conclut qu’ils s’étaient peut-être aimés « platoniquement », incapable de descendre « au fond des choses ».
Charles dépérit, négligeant sa clientèle et sa famille. Il mourut un jour dans la tonnelle de son jardin, tenant dans ses mains une « longue mèche de cheveux noirs ». Sa fille, Berthe, fut confiée à sa grand-mère paternelle, puis à une tante pauvre qui la fit travailler dans une filature de coton.
Quant à Homais, il continua sa quête de reconnaissance. Il fut décoré de la Légion d’honneur, ayant activement lutté contre le curé et d’autres médecins, et étant devenu une figure influente dans la région.
Les Thèmes Majeurs et leur Analyse 🕵️♀️
« Madame Bovary » est une œuvre riche en significations, explorant des thèmes universels à travers le prisme du réalisme.
Le Réalisme et la Critique Sociale 🏙️
L’une des forces du roman réside dans sa représentation minutieuse de la vie provinciale du XIXe siècle. Flaubert dépeint avec une précision quasi photographique les paysages (la ferme des Bertaux, les rues d’Yonville), les intérieurs (la maison de Tostes, la pharmacie d’Homais) et les scènes sociales (le bal à la Vaubyessard, les Comices agricoles). Cette exactitude « tout daguerrienne » dans la reproduction du réel fut d’ailleurs soulignée lors du procès.
Le roman est également une critique acerbe de la bourgeoisie provinciale et de ses mœurs. Les personnages masculins, en particulier, incarnent différentes facettes de cette critique :
- Charles Bovary symbolise la médiocrité, la naïveté et la banalité d’une vie sans ambition ni profondeur.
- Monsieur Homais est la caricature de l’intellectuel provincial, auto-proclamé porte-drapeau du progrès et de la science, mais en réalité plein de prétentions, d’hypocrisie et de vanité. Ses discours sont des logorrhées qui masquent une pensée superficielle.
- M. Lheureux représente l’avidité et le capitalisme prédateur, tirant profit de la faiblesse des autres pour sa propre ruine.
- Le roman met en lumière l’ennui et le manque de perspective dans la vie provinciale, qui poussent Emma à chercher ailleurs ce qu’elle ne trouve pas autour d’elle.
L’Illusion Romantique et la Désillusion 💔
Le thème central du roman est la quête d’un idéal romantique et la confrontation brutale avec la réalité, menant à une désillusion constante. Emma Rouault, élevée au couvent, nourrie de romans passionnels et de keepsakes illustrés, a développé une vision idéalisée de l’amour, de la passion et du luxe. Elle s’imagine une vie pleine d’aventures, de châteaux et de chevaliers, loin de la « médiocrité de l’existence » provinciale.
Cependant, la réalité de son mariage avec Charles Bovary, un homme simple et sans éclat, est un choc. Le bonheur qu’elle attendait ne vient pas, et elle en conclut qu’elle « s’était trompée ». Chaque tentative d’atteindre cet idéal, que ce soit à travers le luxe éphémère du bal de la Vaubyessard, ou ses relations adultères, ne mène qu’à une déception renouvelée.
- Avec Rodolphe, elle cherche la passion flamboyante qu’elle lit dans ses livres, mais il s’avère être un cynique qui la quitte par une lettre convenue. La première « chute » la remplit de joie, mais la « déception arrive » rapidement.
- Avec Léon, elle retrouve un écho de ses aspirations plus intellectuelles et sensibles, un « commerce continuel de livres et de romances ». Cependant, cette relation aussi s’enlise dans la routine et l’ennui, et Léon finit par se lasser de ses exigences. Emma réalise alors que « dans l’adultère [elle retrouvait] toutes les platitudes du mariage ».
Emma est une figure de la désillusion, incapable de s’adapter à la réalité et toujours en quête d’une « volupté plus haute » qu’elle ne trouvera jamais.
La Fatalité et la Décadence ⏳
Le roman dépeint une descente inéluctable pour Emma, une spirale de décadence morale, financière et physique. Chaque décision qu’elle prend, chaque espoir qu’elle place, la mène un peu plus vers sa ruine. L’affaire d’Hippolyte est emblématique : la tentative de Charles pour acquérir de la « célébrité » se solde par un échec humiliant et une amputation, renforçant le mépris d’Emma pour son mari et précipitant sa propre dégradation.
Les manipulations de Lheureux, qui la pousse à souscrire des billets à ordre et à vendre ses biens, illustrent cette fatalité financière. Emma est incapable de gérer ses finances, incapable de faire face aux réalités matérielles, et s’enfonce toujours plus dans le mensonge et le désespoir. La procuration générale qu’elle obtient de Charles, censée lui donner du pouvoir, devient un instrument de sa propre perte.
La maladie d’Emma (la fièvre typhoïde après la rupture avec Rodolphe, puis la maladie finale) est également une manifestation de sa détérioration, à la fois physique et mentale. Le roman montre comment ses illusions, ses désirs insatisfaits et ses échecs la consument de l’intérieur.
Le Rôle des Hommes dans la Vie d’Emma 🧍♂️
Les hommes qui entourent Emma sont cruciaux pour comprendre son parcours :
- Charles Bovary : Représentant la médiocrité de la province, Charles est fondamentalement un homme bon, simple, dévoué et aimant. Sa naïveté et son manque d’ambition irritent profondément Emma, qui cherche une existence plus exaltante. Il incarne la sécurité mais aussi l’ennui. Sa fidélité et son amour inconditionnel pour Emma, même après sa mort et la découverte de ses adultères, en font une figure pathétique et, paradoxalement, une figure morale dans l’œuvre.
- Léon Dupuis : Jeune et rêveur, Léon est un miroir des aspirations romantiques d’Emma. Leur amour est initialement pur et idéaliste, fait de lectures partagées et de conversations passionnées. Mais Léon, malgré ses « ardeurs », est finalement faible, peureux, et incapable de soutenir Emma dans sa fuite des réalités financières et émotionnelles. Il recule devant l’idée du crime et de la compromission.
- Rodolphe Boulanger : L’incarnation du séducteur cynique et expérimenté. Il offre à Emma l’illusion de la grande passion et du luxe qu’elle désire. Rodolphe manipule les sentiments d’Emma avec aisance, mais son amour est superficiel et égoïste. Sa lâcheté et son refus de s’engager la poussent au désespoir le plus profond.
- Monsieur Homais : Le pharmacien d’Yonville est le type du bourgeois voltairien, fervent adepte du progrès et de la science, mais dénué de toute sensibilité et d’humilité. Il représente l’hypocrisie et l’arrivisme social. Son personnage contraste fortement avec la quête d’absolu d’Emma et sert de contrepoint ironique aux « mœurs de province ».
- Monsieur Lheureux : Ce marchand, usurier et manipulateur, précipite la ruine d’Emma par ses crédits et ses intrigues financières. Il incarne la rapacité et la froideur du monde des affaires qui broie Emma.
Pourquoi « Madame Bovary » reste un Incontournable ? 🌟
« Madame Bovary » est bien plus qu’une simple histoire d’adultère. Son pouvoir et sa pertinence résident dans plusieurs aspects :
- La Maîtrise du Style et de la Langue : Flaubert est reconnu pour son style impeccable, sa recherche du « mot juste », et sa capacité à créer des tableaux vivants par des descriptions précises et sensorielles. Le roman est une leçon de prose française.
- La Profondeur Psychologique : Flaubert excelle dans l’analyse des motivations et des tourments de ses personnages. Emma est un personnage complexe, à la fois victime de ses illusions et responsable de ses choix, dont les aspirations inassouvies résonnent avec l’expérience humaine. La défense a d’ailleurs mis en lumière que le roman s’attachait au « sentiment humain, le développement des passions ».
- La Critique Sociale et Culturelle : Au-delà de l’histoire individuelle d’Emma, le roman offre un panorama critique de la société provinciale du XIXe siècle, de ses valeurs bourgeoises, de ses hypocrisies et de ses limites. Il met en lumière les dangers d’une éducation inadaptée et de l’influence pernicieuse du romantisme sur des esprits non préparés.
- La Modernité de ses Thèmes : Les thèmes de l’ennui existentiel, de la quête de sens, de la confrontation entre rêve et réalité, de la place de la femme dans la société, et de la corruption par l’argent sont des préoccupations intemporelles qui continuent de toucher les lecteurs d’aujourd’hui.
- Son Rôle dans l’Histoire Littéraire : « Madame Bovary » est considéré comme un pilier du réalisme et du naturalisme, ayant influencé de nombreux écrivains par sa rigueur d’observation et son approche objective de la fiction. Le procès lui-même a renforcé sa notoriété et a contribué à définir les limites de la liberté artistique.
Conclusion : Une Leçon Morale Intemporelle ✅
Contre l’accusation d’immoralité, la défense de Flaubert a soutenu que « Madame Bovary » était une œuvre éminemment morale, visant à susciter l’ « horreur du vice » par la démonstration de ses conséquences désastreuses. En effet, l’itinéraire d’Emma Bovary est une descente aux enfers, pavée de désillusions, de regrets et de souffrances. Son suicide et l’agonie qu’elle endure, décrits avec une précision glaçante, sont l’ultime illustration de la futilité de sa quête et de la punition de ses fautes.
Le roman ne se contente pas de montrer le vice, il en expose les mécanismes, les illusions et les conséquences fatales. L’histoire d’Emma est une mise en garde contre les dangers de l’excès de rêverie, de la superficialité, de la vanité et de la recherche égoïste du plaisir. La figure de Charles, le mari simple et loyal, qui, malgré tout, conserve sa droiture et son amour, contraste avec la décadence d’Emma, offrant ainsi une perspective morale subtile et percutante.
« Madame Bovary » est un chef-d’œuvre qui, bien que controversé à son époque, a su traverser le temps grâce à sa vérité psychologique, sa force descriptive et sa pertinence universelle. C’est un roman qui invite à la réflexion sur les choix de vie, les idéaux et la nature complexe du bonheur.
Pour comprendre pleinement la richesse de cette œuvre, il est essentiel de la lire dans son intégralité, sans « découpures » ni interprétations hâtives, comme le plaidait Me Sénard. C’est en embrassant toute la complexité du texte que l’on perçoit la profonde leçon morale qu’il recèle.
Plongez dans l’univers de Flaubert et découvrez par vous-même la force intemporelle de « Madame Bovary » !