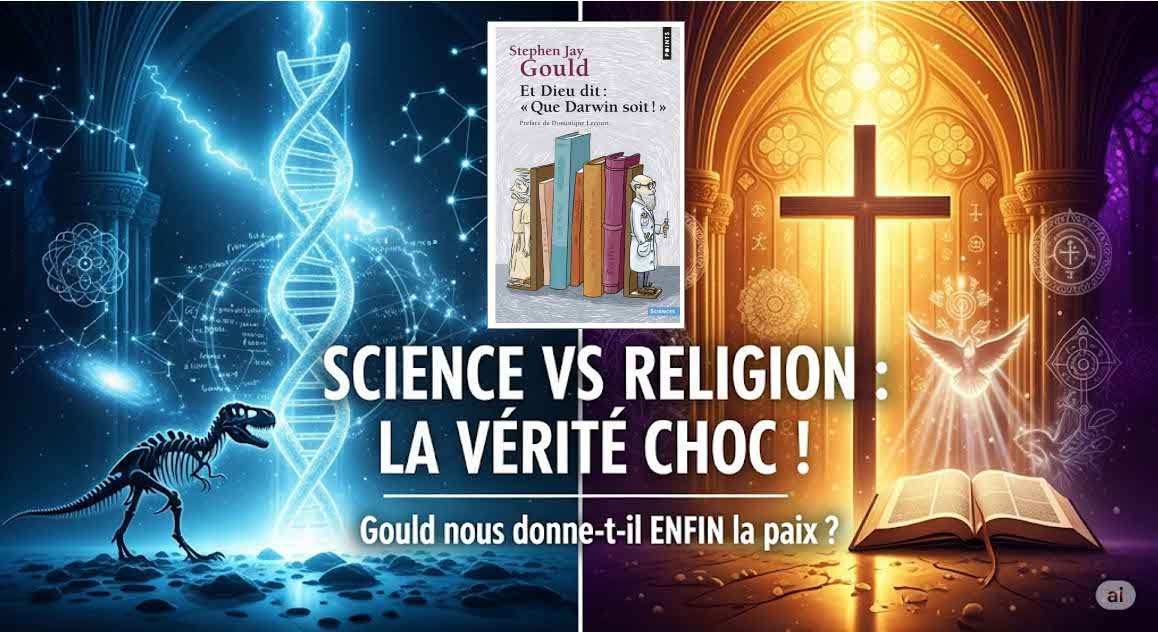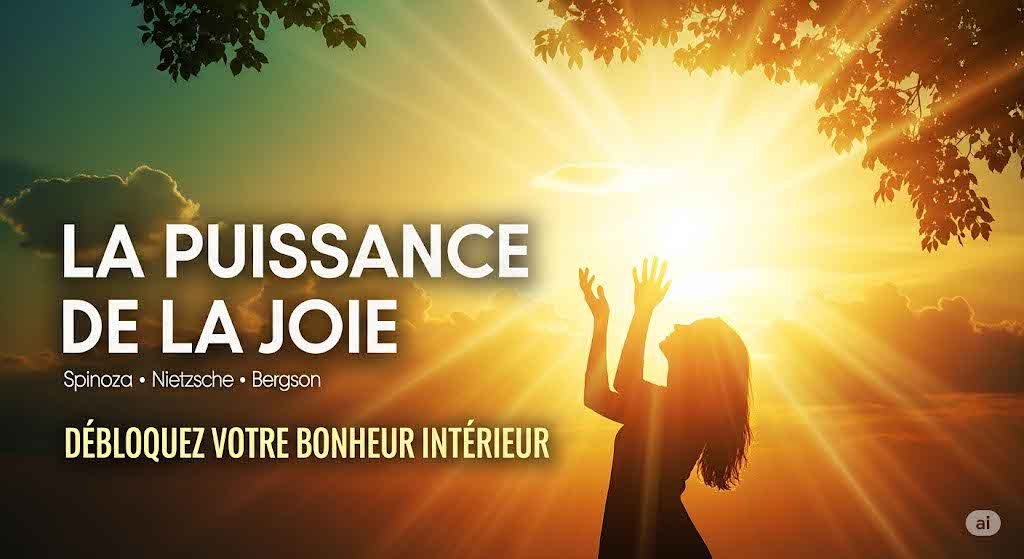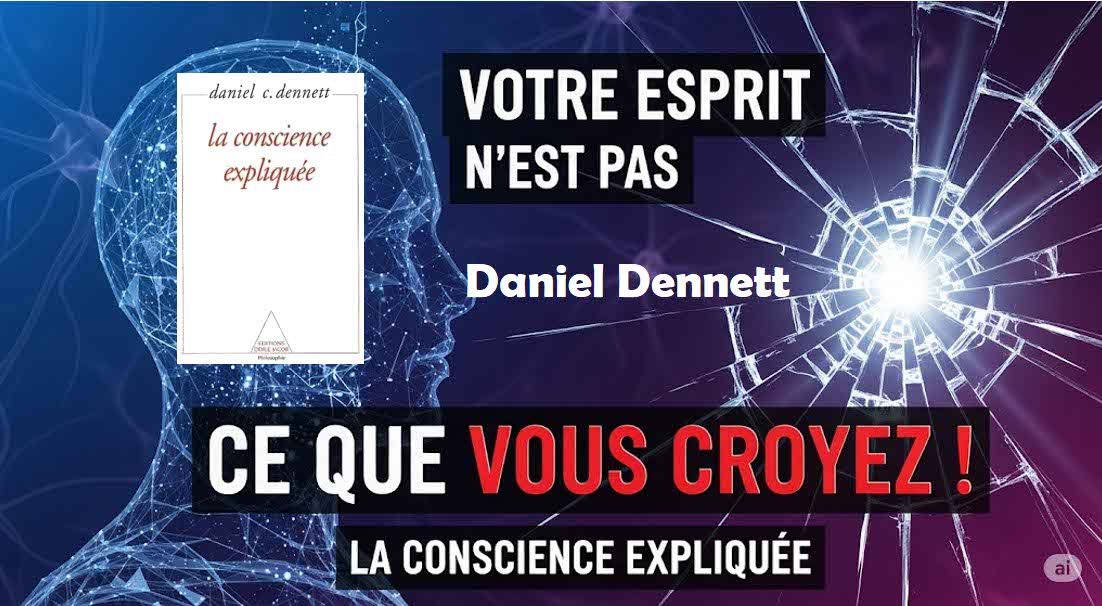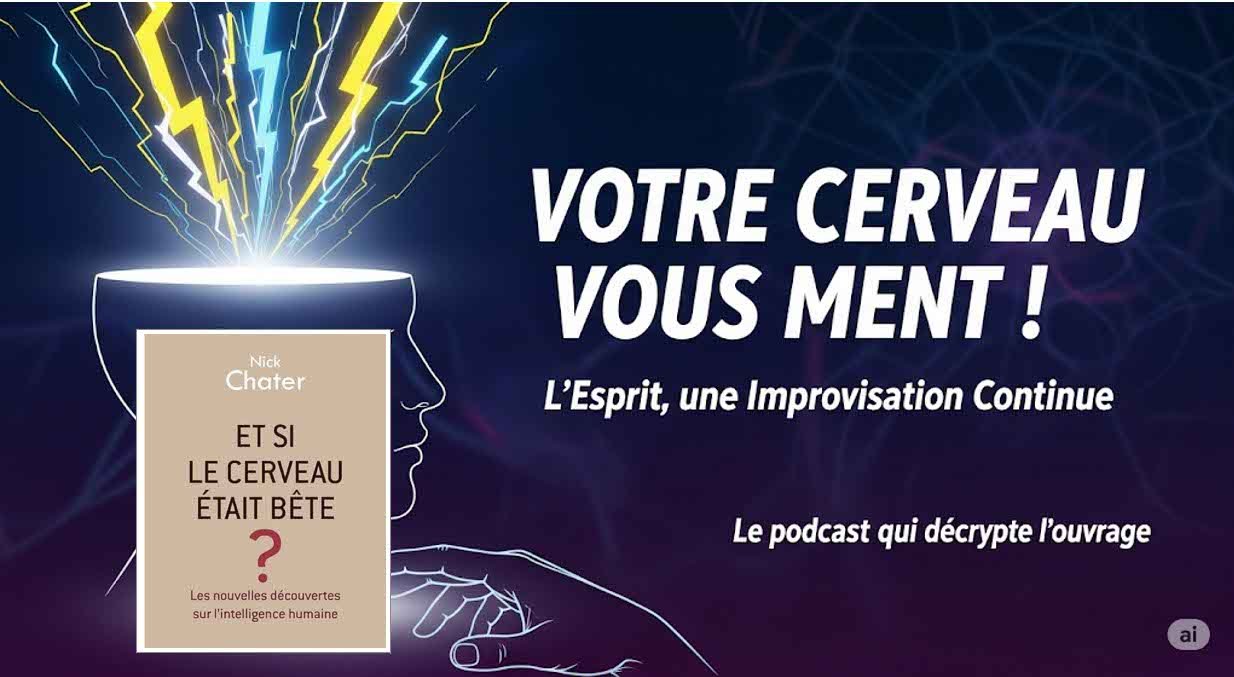Les liens pour vous procurer les différentes versions
📗Lien vers le livre papier : https://amzn.to/3Jn6UPe
🧠✨ « L’Homme Neuronal » de Jean-Pierre Changeux : Plongée Révolutionnaire au Cœur de la Pensée Humaine 🌐
Jean-Pierre Changeux, figure emblématique de la neurobiologie française, nous invite dans son œuvre magistrale, « L’Homme Neuronal » (1983), à un voyage fascinant au sein du cerveau humain. Ce livre, né d’un dialogue stimulant entre psychanalystes et neurobiologistes, ambitionne de jeter une passerelle entre le monde des sciences « dures » et celui du psychisme, souvent perçu comme distinct. Il s’inscrit dans une période de « révolution neurobiologique » où les connaissances sur le système nerveux connaissent une expansion sans précédent, comparable à celle de la physique au début du XXe siècle ou de la biologie moléculaire dans les années 50. L’enjeu est de taille : démontrer que l’homme pense avec son cerveau et que ses facultés mentales trouvent leurs racines dans une base purement biologique, défiant ainsi le clivage traditionnel de l’âme et du corps.
Cet ouvrage nous propose une synthèse des découvertes majeures dans les sciences du système nerveux, depuis l’Antiquité jusqu’aux avancées les plus récentes (à l’époque de la publication), explorant la complexité du cerveau non pas comme un mystère insondable, mais comme une machine dont les mécanismes peuvent être déchiffrés. Changeux nous guide à travers l’anatomie, la physiologie, la biochimie et le développement du cerveau, remettant en question les approches réductionnistes simplistes tout en affirmant la nécessité d’une explication biologique du psychisme. Son message est clair : l’homme neuronal n’a plus rien à faire de l’« Esprit », il lui suffit d’être un Homme Neuronal.
📜 Aux Origines de la Pensée Cérébrale : De l’Égypte Ancienne à la Belle Époque 🧠
L’idée que le cerveau est le siège de la pensée n’est pas nouvelle, mais sa reconnaissance fut un long chemin semé d’obstacles idéologiques.
Le Cerveau, Organe de la Pensée ? Une Longue Quête 🧐
L’histoire de la fonction cérébrale débute avec des observations cliniques précoces. Le papyrus d’Edwin Smith, daté du XVIIe siècle av. J.-C. (mais copié d’un texte plus ancien de 3000 av. J.-C.), décrit 48 cas de blessures à la tête et au cou. Il y est noté, par exemple, qu’une blessure au crâne peut entraîner une « déviation des globes oculaires » ou un patient « marchant en traînant le pied », et qu’une tempe enfoncée peut causer une perte de parole. Ces descriptions, malgré leur objectivité, ne conduisent pas les anciens Égyptiens à attribuer l’intelligence au cerveau, mais plutôt au cœur, comme les Mésopotamiens, les Hébreux, et Homère.
C’est avec les Atomistes présocratiques, comme Démocrite (VIIe-Ve siècle av. J.-C.), que l’idée d’une base matérielle pour la sensation et la pensée émerge. Démocrite propose des « atomes psychiques » fins, polis et ronds, et assigne la pensée au cerveau, bien qu’il localise la colère dans le cœur et le désir dans le foie. Ces idées sont enrichies par Hippocrate et ses collègues (siècle de Périclès), qui, par l’observation clinique des plaies crâniennes, découvrent la contralatéralité (lésion à droite affectant le côté gauche du corps) et attribuent les maladies neurologiques et mentales à une origine cérébrale.
Malgré ces avancées, Aristote (et Platon) égarera les esprits pendant des siècles en affirmant que le cœur est le siège des sensations et de l’intelligence, reléguant le cerveau à un rôle de « réfrigérateur » du corps. Son erreur, s’appuyant sur l’insensibilité du cerveau à la stimulation mécanique et l’absence d’organes similaires chez les invertébrés, persistera jusqu’au XVIIIe siècle.
L’École d’Alexandrie, avec Hérophile et Érasistrate (IIIe siècle av. J.-C.), marque un tournant décisif en inaugurant la dissection humaine. Ils distinguent le cervelet, le cerveau et la moelle épinière, notent les ventricules et les circonvolutions, et prouvent que les nerfs proviennent du cerveau/moelle, non du cœur. Ils différencient également les nerfs moteurs et sensoriels, et observent la richesse des circonvolutions cérébrales chez l’homme par rapport aux animaux, anticipant des découvertes du XVIIe siècle en Europe. Galien (près de 500 ans plus tard) consolide cette position par l’expérimentation, démontrant le rôle central du cerveau dans la commande du corps et l’activité mentale, affaiblissant la thèse cardiocentriste.
Âme et Corps : Le Défi du Dualisme 👻
La question de l’âme et de sa relation avec le corps reste centrale. Galien développe la notion de « pneuma psychique » produit et stocké dans les ventricules, circulant dans les nerfs pour relier le cerveau aux organes. Ce concept évoluera vers les « esprits animaux » puis le « fluide nerveux ». Les Pères de l’Église primitive, comme Némésius et Saint-Augustin (IVe-Ve siècle), vont plus loin en localisant l’imagination, la raison et la mémoire dans les ventricules antérieur, moyen et postérieur respectivement, créant ainsi le premier modèle de localisation cérébrale.
Descartes, tout en comparant le corps à une machine (comme un orgue où les esprits animaux sont l’air), maintient un dualisme strict en postulant une âme unique, immatérielle et immortelle, unie au corps par la glande pinéale. Son héritage, la conception de l’homme comme « machine » anatomique, ouvre la voie à l’étude des réflexes. Willis (XVIIe siècle) observe l’écorce cérébrale plissée recouvrant des centres « sous-corticaux » et distingue la substance grise (produisant les esprits animaux) de la substance blanche (les distribuant). Il accepte encore l’âme raisonnable, la plaçant au-delà de son scalpel.
Le XVIIIe siècle voit l’abandon progressif de l’immatérialité de l’âme. Gassendi réhabilite les atomistes grecs, affirmant que les animaux possèdent aussi une âme, ce qui « animalise » l’homme et « dévalue » l’âme. Guillaume Lamy équivaut « âme » et « esprits animaux ». La Mettrie ira jusqu’à affirmer que l’on peut retirer l’âme du système cartésien sans grand dommage, l’homme étant une « machine ». Cabanis résume cette évolution par sa formule célèbre : « Le cerveau secrète la pensée comme le foie la bile ».
La Phrénologie : Une Première Cartographie Contestée 🗺️
Le début du XIXe siècle voit l’émergence de la phrénologie de Gall, une théorie qui, malgré ses défauts d’application, pose des principes fondamentaux justes. Gall, anatomiste, bien qu’innovant peu sur la structure fine du cerveau, note la position du cortex cérébral au plus haut niveau de l’encéphale et son développement chez les mammifères et l’homme. Sa singularité réside dans sa démarche théorique: analyser et localiser les fonctions cérébrales sans introspection, mais en physiologiste. Il postule l’existence d’un grand nombre de « facultés morales et intellectuelles » innées et irréductibles (ex: instinct de propagation, agressivité, mémoire verbale).
Gall attribue à chaque faculté une localisation corticale précise, pensant que le crâne en reproduit la surface. Sa « crânioscopie » consiste à palper les proéminences du crâne pour corréler avec des facultés développées. Bien que sa topographie soit en grande partie fantaisiste (à part la mémoire des mots et le sens du langage dans les régions frontales), sa théorie est rapidement critiquée comme matérialiste.
Flourens, figure officielle et dualiste, tente de réfuter Gall par des ablations d’aires cérébrales. Il montre que l’ablation du cervelet entraîne des déficits de coordination, et que des lésions du bulbe affectent les fonctions vitales (respiration), confirmant la localisation pour ces structures. Cependant, il conclut que le cortex fonctionne comme un tout indivis, siège de l’âme. Ses conclusions sont aujourd’hui contestées, notamment parce que ses méthodes pouvaient endommager des structures sous-corticales et qu’il travaillait sur des animaux avec un cortex moins différencié.
La preuve irréfutable de la localisation corticale vient de l’étude humaine. Bouillaud, un élève de Gall, étudie les traumatismes crâniens et les lésions cérébrales, corrélant les perturbations du langage avec des lésions du lobe antérieur du cortex. Mais c’est Paul Broca, en 1861, qui apporte la démonstration décisive avec le cas de Leborgne (surnommé « Tan »). L’autopsie de son cerveau révèle une lésion majeure dans la partie moyenne du lobe frontal de l’hémisphère gauche, établissant un lien rigoureux entre cette lésion et l’aphasie (perte de la parole). Broca met également en évidence une asymétrie entre les deux hémisphères.
L’époque autour de 1900 est la « Belle Époque » des localisations cérébrales. Brodmann (1909) synthétise les données, divisant le cortex en 52 aires numérotées, chacune avec une fonction spécifique (ex: aire 4 pour la motricité, 17 pour la vision). Cette « nouvelle phrénologie » se fonde sur des critères anatomiques et fonctionnels incontestables, remplaçant la crânioscopie approximative de Gall.
🔗 Le Cerveau en Pièces Détachées : De la Macroscopie au Micro-Circuit 🔬
Pour comprendre le cerveau, il faut le démonter jusqu’à ses composants fondamentaux.
Poids et Dimensions : Un Regard Global ⚖️
L’encéphale humain pèse en moyenne 1330 g, mais cette valeur est très variable. La capacité crânienne, qui est étroitement liée au volume du cerveau, peut être utilisée comme indicateur. Des études ont tenté de corréler le poids du cerveau avec des aptitudes (ex: travailleurs qualifiés vs. non qualifiés), mais ces conclusions sont souvent biaisées par des facteurs comme la taille corporelle et l’alimentation.
Le simple poids absolu n’est pas un bon indicateur de « supériorité » intellectuelle, car des animaux comme le rorqual bleu (6000g) ou l’éléphant (5700g) ont des cerveaux beaucoup plus lourds que l’homme. Une comparaison plus pertinente est l’indice d’encéphalisation, qui rapporte le poids du cerveau au poids du corps et le compare aux espèces de référence (insectivores). Sur cette échelle, l’homme obtient un indice moyen de 28,7, signifiant qu’à poids corporel égal, son cerveau est 28,7 fois plus important que celui de l’insectivore de base. Le chimpanzé a un indice de 11,3, et d’autres mammifères marins comme les dauphins dépassent 20, soulignant la complexité négligée par une simple mesure de poids.
L’Expansion du Néocortex : Une Caractéristique Humaine 📈
Les hémisphères cérébraux, et en particulier le néocortex (le « nouveau » cortex), sont la différence la plus essentielle entre l’homme et les autres animaux. Alors que chez les poissons, les hémisphères ne représentent qu’une fraction mineure de l’encéphale, leur expansion est spectaculaire chez les primates et atteint son maximum chez l’homme. L’indice de progression du néocortex est de 58 chez le chimpanzé et de 156 chez l’homme, contre seulement 1 pour les insectivores.
Cet immense développement du néocortex se traduit par un accroissement majeur de sa surface, qui atteint environ 22 dm² chez l’homme (contre 4,9 dm² chez le chimpanzé). Pour tenir dans le crâne, cette surface se plisse en circonvolutions, les deux tiers étant enfouis dans des sillons. Cette « corticalisation » de l’encéphale est la marque du cerveau humain moderne.
Micro-circuits : Le Monde Cellulaire du Cortex 🔄
Le cortex cérébral est composé de substance grise (externe) et de substance blanche (interne). Dès le XIXe siècle, Baillarger observe sa disposition stratifiée en six couches superposées, cherchant une base anatomique aux maladies mentales.
La compréhension de l’organisation cellulaire fine du cortex doit beaucoup à la doctrine du neurone. Deiters (1865) propose l’image moderne de la cellule nerveuse: un corps cellulaire (soma) avec un noyau, des dendrites (multiples et ramifiées, recevant des signaux), et un axone (unique, transmettant les signaux). Cependant, la question de savoir si les neurones forment un réseau continu (réticularisme) ou des unités indépendantes en contiguïté (neuronisme) divise les scientifiques. Golgi, développant sa méthode de coloration « reazione nera », penche pour la vision réticulariste. Mais Ramón y Cajal, utilisant la même méthode avec une rigueur inégalée, accumule les preuves que les neurones sont des unités distinctes en contact. L’introduction de la microscopie électronique après 1950 confirmera définitivement la théorie du neurone, montrant que les membranes cellulaires sont séparées par une « fente » synaptique.
Le cortex est principalement composé de cellules pyramidales (dominantes numériquement), caractérisées par leur forme pyramidale, un dendrite apical vertical et des dendrites basilaires couverts d’épines (jusqu’à 20 000 par cellule chez l’homme). Les cellules étoilées sont des interneurones dont les axones restent dans le cortex. Ces catégories de neurones, avec leurs formes et compositions chimiques (répertoire de gènes exprimés), sont étonnamment conservées de la souris à l’homme, ce qui signifie que le cerveau humain est construit avec les mêmes « pièces détachées ».
Malgré cette uniformité des types cellulaires, l’organisation du cortex présente des différences d’une aire à l’autre (épaisseur, densité et répartition des neurones). Cependant, des études quantitatives récentes (Rocket, Hiorns et Powell, 1980) révèlent un fait remarquable : le nombre de neurones par colonne prismatique de cortex est quasiment constant chez les mammifères (environ 110 ± 10), de la souris à l’homme, à l’exception de l’aire visuelle. Cela implique que l’évolution du cortex chez les mammifères se traduit principalement par un accroissement de sa surface, et non par une augmentation de la densité cellulaire.
Cet accroissement de surface s’accompagne d’une augmentation du nombre total de neurones (estimé à au moins 30 milliards dans le cortex humain, contre 65 millions chez le rat). Cela signifie une augmentation considérable du nombre de neurones au sein d’une même catégorie. L’accroissement de la complexité du cortex réside donc dans l’augmentation du nombre total de neurones et, par conséquent, du nombre et de la complexité des opérations possibles, ainsi que de l’enrichissement des arborisations dendritiques et axonales. La densité synaptique par mm³ est similaire chez le rat et l’homme, mais le nombre total de synapses est gigantesque (10^14 à 10^15 dans le cortex humain). Il n’y a pas de réorganisation « qualitative » brutale entre le cerveau « animal » et le cerveau « humain », mais une évolution quantitative et continue.
Les neurones corticaux sont organisés en micro-circuits complexes. Les fibres thalamiques, principales voies d’entrée du cortex, établissent des synapses sur les dendrites des cellules pyramidales, entraînant une propagation verticale des impulsions. Des interneurones étoilés créent des influences latérales. Enfin, les axones des cellules pyramidales, seules voies de sortie du cortex, envoient des collatérales pour créer des boucles de ré-entrée, complexifiant les calculs. Les destinations de ces axones sont liées à la localisation du soma dans les couches corticales.
Des études micro-électrodes ont révélé une organisation en modules ou colonnes. Mountcastle (1957) a montré que les neurones dans une colonne verticale répondent à la même modalité sensorielle. Hubel et Wiesel ont confirmé cette observation dans le cortex visuel, montrant des colonnes de dominance oculaire. Cependant, l’organisation réelle est plus complexe, avec des « bandes » qui peuvent varier en dimension selon l’expérience.
⚡ Le Langage du Cerveau : Des Esprits Animaux aux Neurotransmetteurs 🧪
Comprendre le cerveau ne se limite pas à sa structure statique ; il faut saisir sa dynamique. Le système nerveux utilise des signaux de communication qui ont évolué des concepts de « pneumatiques » à l’électricité et à la chimie.
L’Électricité Cérébrale et l’Influx Nerveux 💡
L’idée de l’électricité cérébrale remonte aux expériences de Galvani (1791) sur la « électricité animale » dans les pattes de grenouille. Malgré les critiques de Volta, l’existence d’une électricité intrinsèque au corps est démontrée. Du Bois Reymond (1848) montre que le signal nerveux est une « onde de négativité » (potentiel d’action) se propageant le long du nerf. Von Helmholtz mesure sa vitesse (25-40 m/s), suffisamment rapide pour expliquer la rapidité des processus mentaux.
Les travaux de Fritsch et Hitzig (1870) sont cruciaux : en stimulant électriquement des points précis du cortex canin, ils provoquent des contractions musculaires controlatérales, établissant un lien direct entre électricité et fonction cérébrale. Caton (1875) découvre l’électroencéphalographie (EEG) en enregistrant des courants électriques spontanés et des « potentiels évoqués » dans le cortex. Ces ondes cérébrales (alpha au repos, bêta en activité) sont des manifestations électriques globales qui, bien que lentes, contiennent des activités plus élémentaires. L’utilisation de microélectrodes permet de « décomposer » cette activité continue en impulsions discrètes provenant de neurones individuels. Chaque neurone génère des impulsions électriques à des fréquences variables (quelques dizaines par seconde). L’ensemble des manifestations électriques cérébrales est réductible à l’activité électrique des cellules nerveuses, leur propagation le long des axones et leur transmission au niveau des synapses.
Le signal nerveux n’est pas un simple courant électrique ; c’est une onde qui se propage avec une amplitude constante le long de l’axone. La membrane cellulaire joue un rôle fondamental dans cette production d’électricité. Au repos, il existe une différence de potentiel électrique (50-90 mV) à travers la membrane, maintenue par des enzymes-pompes qui transportent activement les ions (sodium, potassium) en dépensant de l’ATP. L’influx nerveux est déclenché par une perméabilisation transitoire de la membrane aux ions sodium, ouvrant des canaux ioniques voltage-dépendants. Ces mécanismes sont universels, de l’axone géant du Calmar aux neurones corticaux humains.
Certains neurones, appelés oscillateurs, produisent spontanément des rafales d’impulsions électriques avec une régularité. Ces oscillations résultent de la dynamique des flux ioniques à travers la membrane, répondant aux principes de la thermodynamique des systèmes ouverts et hors d’équilibre (structures dissipatives de Prigogine). Cette activité spontanée n’est pas un simple « brouillage » mais une propriété générale de la cellule nerveuse, contribuant à l’activité cérébrale même en l’absence de stimulus externes.
D’un Neurone à l’Autre : La Synapse Chimique 🔑
La transmission du signal d’un neurone à l’autre se fait principalement au niveau de la synapse. Sherrington (1906) a souligné l’importance des « barrières intercellulaires ». Le débat historique entre transmission électrique et chimique est clos : les deux modes existent. Cependant, la transmission chimique est prédominante.
Elliott (1904) propose l’idée d’un médiateur chimique, l’adrénaline, pour la signalisation nerveuse. Henry Dale (1953) et d’autres pharmacologues confirment le rôle de substances comme l’acétylcholine. La microscopie électronique révèle la morphologie caractéristique des synapses chimiques : un espace synaptique plus large (20-50 nm), des vésicules dans le terminal présynaptique contenant le neurotransmetteur, et un épaississement de la membrane postsynaptique. Ces synapses sont abondantes dans le cortex. L’arrivée de l’impulsion électrique provoque la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique, où sa concentration augmente brusquement. Ce neurotransmetteur se lie à des molécules-récepteurs spécifiques sur la membrane postsynaptique, ouvrant des canaux ioniques et produisant un courant électrique. Ces récepteurs sont des protéines spécialisées. La découverte de la toxine α de serpent (ex: cobra), qui se fixe de manière sélective et irréversible au récepteur de l’acétylcholine, a permis d’isoler et de purifier cette molécule. Le récepteur de l’acétylcholine est une grosse protéine (250 000 Da) composée de cinq chaînes, formant à la fois le site de reconnaissance de l’acétylcholine et le canal ionique.
La diversité biochimique est une caractéristique clé du système nerveux central. Le cerveau contient des dizaines de neurotransmetteurs (acétylcholine, noradrénaline, dopamine, sérotonine, glutamate, GABA, peptides comme les enképhalines, substance P, VIP). Cette diversité permet une « combinatoire de signaux » et des possibilités de calcul plus complexes qu’avec un simple système électrique. Il est remarquable que les mécanismes élémentaires de la communication nerveuse (neurotransmetteurs, récepteurs, canaux ioniques) sont largement conservés de l’organe électrique du gymnote au cerveau humain, soulignant une continuité évolutive fondamentale.
🎭 Le Passage à l’Acte et les Objets Mentaux : Une Approche Biologique du Psychisme 💭
Comprendre le comportement et la pensée humaine nécessite d’ouvrir la « boîte noire » du cerveau, au-delà du simple stimulus-réponse du behaviorisme.
Comportements et Codages : Topologie, Impulsions et Chimie 🧩
Tout comportement implique la mobilisation d’ensembles définis de cellules nerveuses, un « graphe ». Le codage du comportement repose sur trois modes complémentaires:
- Topologie des connexions : La géométrie fixe du réseau neuronal. Par exemple, le chant du grillon est déterminé par un réseau spécifique de neurones et les impulsions qui y circulent.
- Impulsions électriques : Le déroulement temporel des signaux nerveux. La cellule de Mauthner chez le poisson illustre comment un « calcul » élémentaire (sommation de signaux excitateurs et inhibiteurs) dans la membrane du neurone détermine une décision de fuite.
- Messagers chimiques : Les neurotransmetteurs et neuromodulateurs spécifiques.
- L’angiotensine II agit comme médiateur chimique de la soif, signalant un manque d’eau à l’hypothalamus.
- La substance P est le transmetteur de la douleur dans la moelle épinière, libérée par les neurones de la douleur. Les enképhalines (morphines internes) agissent en inhibant la libération de substance P, soulageant la douleur.
- L’orgasme, une expérience interne, semble impliquer l’acétylcholine dans le septum.
Ces exemples montrent que le codage chimique diversifie les connexions et permet des relations plus précises entre neurones et comportements. Les comportements les plus fondamentaux (boire, manger, sexualité) dépendent de petits groupes de neurones chimiquement étiquetés, souvent situés dans des régions comme l’hypothalamus et le système limbique.
Le Cerveau qui Analyse et Parle : Cartes Corticales et Langage 🗣️🌍
Le néocortex humain, particulièrement développé, joue un rôle central dans l’analyse et l’action. Les comportements automatiques dépendent davantage des structures sous-corticales. Le cortex contient des représentations anatomiques de l’environnement. Des « figurines » ou homoncules sensoriels (découverts par Penfield et Rasmussen) se dessinent sur sa surface, montrant une représentation disproportionnée des parties du corps les plus sensibles (mains, lèvres chez l’homme, moustaches chez le rat). De multiples représentations corticales (jusqu’à 8 pour la rétine chez le singe) coexistent, chacune spécialisée dans l’extraction de traits spécifiques (orientation, direction, couleurs). Le cortex est un « analyseur » sophistiqué.
Il est aussi un « acteur ». L’homoncule moteur juxtapose l’homoncule sensoriel, montrant des régions étendues pour la main, la bouche et le larynx, reflétant l’importance de ces organes dans l’action et la communication. La communication sociale, et en particulier le langage, occupe une partie considérable du cortex. Les travaux suivant Broca ont confirmé la localisation des aires du langage, majoritairement dans l’hémisphère gauche (aires 44-46, 39, 40). Les lésions de l’aire de Broca entraînent des troubles de l’élocution (aphasie) sans affecter le chant. Le cortex est de plus en plus « parcellisé » fonctionnellement, jusqu’au niveau de neurones individuels ayant des « singularités » fonctionnelles uniques (ex: cellules visuelles répondant à des orientations spécifiques).
Les objets mentaux, tels que les images et les concepts, sont au cœur de la pensée. Changeux soutient que les images mentales ont une matérialité. Des expériences (Shepard & Metzler, Kosslyn) montrent que les images mentales se comportent comme des objets physiques (rotation mentale à vitesse mesurable, exploration de cartes mentales respectant les distances réelles, « zoom » mental). Les images mentales et les percepts peuvent même être confondus (Perky) et entrent en compétition pour le même canal sensoriel (Segal et Fusella), suggérant une parenté neurale et une congruence matérielle. Les concepts sont des images mentales « simplifiées », « squelettiques », réduites à des traits essentiels. Pour Hume, les concepts sont des percepts « affaiblis ». Changeux regroupe percepts, images de mémoire et concepts sous le terme général d’« objets mentaux », les identifiant à des formes ou états divers d’unités matérielles de représentation mentale. La machine cérébrale effectue des « calculs » sur ces objets mentaux, les évoquant, les combinant pour créer de nouveaux concepts et « hypothèses ». Le langage sert d’intermédiaire pour traduire ces objets mentaux en symboles externes.
Un objet mental est identifié à un état physique créé par l’entrée en activité corrélée et transitoire d’une large population de neurones (« assemblée ») distribués dans plusieurs aires corticales. Cette assemblée est décrite mathématiquement par un graphe, et se compose de neurones aux « singularités » différentes. Les concepts, plus abstraits, mobilisent des neurones dans des aires associatives multiples. Les objets mentaux s’enchaînent par la mise en commun de neurones, où un même neurone peut appartenir à plusieurs graphes d’objets mentaux différents.
🧬 L’Architecture du Cerveau : Le Pouvoir des Gènes et l’Épigénèse 🌱
Le cerveau est une représentation du monde, et son organisation anatomique, caractérisant l’espèce, est intrinsèquement liée à ses gènes.
La Prédestination du Cerveau : L’Invariance Génétique de l’Espèce 📏
La forme de l’encéphale humain est remarquablement stable à travers les générations et cultures, attestant d’une définition neurobiologique de l’espèce. Cette invariance se retrouve au niveau des détails histologiques, les principales connexions étant en place avant la naissance. Cependant, des variations existent. Des études histologiques montrent une variabilité significative de la disposition en couches du corps genouillé latéral chez l’homme. Les mutations géniques peuvent avoir des effets profonds. L’albinisme, par exemple, est une mutation récessive qui, en plus de la pigmentation, affecte l’organisation des voies visuelles dans le cerveau, illustrant la pléiotropie (un gène influençant plusieurs traits distincts). L’anencéphalie, l’absence de cortex cérébral, est un autre exemple extrême. Des mutations chez la drosophile ont permis d’identifier des gènes cibles critiques pour la propagation de l’influx nerveux (affectant les canaux ioniques) ou pour l’apprentissage et la mémoire (affectant des enzymes comme l’AMP cyclique phosphodiestérase). Ces mécanismes sont sous le contrôle de gènes de structure, suggérant que les bases moléculaires de l’activité nerveuse et de l’apprentissage sont génétiquement déterminées chez des espèces aussi diverses que la drosophile, l’aplysie et l’homme. Chez l’homme, la psychose maniaco-dépressive montre une forte composante héréditaire, avec des taux de concordance élevés chez les vrais jumeaux. Des études génétiques suggèrent l’implication d’un ou plusieurs gènes dominants sur le chromosome X. Ces troubles n’impliquent pas de lésions anatomiques majeures mais des perturbations de la physiologie et de la biochimie cérébrale.
Le Paradoxe du Génome : Simplicité Génétique, Complexité Cérébrale 🤔
Le support matériel de l’hérédité est l’ADN, qui contient le « programme » génétique. Bien que l’ADN code pour toutes les protéines de l’organisme, le cerveau se distingue par la richesse de son répertoire de gènes ouverts (exprimés en ARN messager), atteignant potentiellement 150 000 espèces différentes, bien plus que tout autre organe. Cependant, un paradoxe subsiste: la quantité totale d’ADN par noyau cellulaire est similaire chez la souris et l’homme (à 10 % près), malgré une différence spectaculaire de complexité et de nombre de neurones (plusieurs dizaines de milliards chez l’homme contre 5 à 6 millions chez la souris). Le nombre de gènes (20 000 à 150 000) est dérisoire comparé aux 10^14 à 10^15 synapses du cerveau humain. Cela signifie qu’il ne peut y avoir de correspondance simple du type « un gène – une synapse ».
La solution à ce paradoxe réside dans la manière dont cette complexité est construite au cours du développement embryonnaire, l’Entwicklungsmechanik. Le modèle de la cellule-automate propose que le comportement d’une cellule embryonnaire (sa différenciation) résulte de choix successifs guidés par un petit nombre de signaux. Ce mécanisme combinatoire permet une diversification considérable d’états cellulaires à partir d’un minimum de signaux, expliquant comment un génome relativement « pauvre » peut engendrer la complexité du cerveau. Des « gènes de communication » sont essentiels pour coordonner les interactions cellulaires au sein de l’« embryon-système ».
L’Épigénèse : Sculptant le Cerveau par l’Expérience 🖐️
L’épigénèse est un mécanisme combinatoire qui, sans modifier le matériel génétique, agit au niveau des ensembles de cellules nerveuses pour modeler la topologie du réseau de connexions. La théorie proposée par Changeux est l’épigenèse par stabilisation sélective de synapses.
- Variabilité Phénotypique : Les vrais jumeaux, génétiquement identiques, ne possèdent pas « exactement » le même cerveau. Des études sur des organismes simples (daphnie, poisson Poecilia formosa) montrent une variabilité dans les détails des arborisations dendritiques et des synapses, même si le nombre de cellules et les connexions qualitatives restent constants. Chez la souris, la distribution des cellules de Purkinje dans le cervelet de chimères est largement aléatoire, indiquant que les divisions et migrations cellulaires ne sont pas soumises à un déterminisme rigoureux à un niveau fin.
- Le Comportement du Cône de Croissance : Le cône de croissance, découvert par Cajal, est la partie mobile du neurone qui guide l’élongation des axones et la formation des branchements. Il explore son environnement en « palpant » le substrat et en étant attiré par des facteurs chimiques (comme le Nerve Growth Factor – NGF). Les zigzags et aléas de sa navigation s’inscrivent dans la topologie des connexions nerveuses, introduisant une importante variabilité dans la géométrie des axones et dendrites chez l’adulte.
- Régression et Redondance : Le développement du système nerveux est marqué par une mort cellulaire massive (ex: 40% des neurones moteurs de la moelle épinière chez l’embryon de poulet meurent) et une élimination sélective des synapses (ex: les cellules de Purkinje chez les mammifères sont initialement innervées par plusieurs fibres grimpantes, mais une seule persiste chez l’adulte). Les dendrites des cellules pyramidales du cortex se couvrent d’épines puis leur nombre diminue d’un facteur 2 après la naissance chez le macaque. Cette redondance transitoire est une étape critique de l’organisation.
- L’Assemblage de la Synapse : La synapse est l’ultime canal de communication. Chez l’embryon, le récepteur de l’acétylcholine est diffus, mobile et labile sur toute la fibre musculaire. L’arrivée des fibres nerveuses provoque l’agrégation et la stabilisation de ces récepteurs sous la terminaison nerveuse, tandis que les récepteurs extrasynaptiques disparaissent. L’activité nerveuse embryonnaire est cruciale pour l’élimination du récepteur excédentaire et l’assemblage de la synapse. La paralysie expérimentale de l’embryon maintient des neurones moteurs qui auraient dû mourir, et le récepteur excédentaire persiste, confirmant le rôle de l’activité dans ces phénomènes régressifs.
La théorie de la stabilisation sélective postule qu’au stade de « connectivité maximale » (période critique), les synapses embryonnaires labiles peuvent devenir stables ou dégénérer. L’expérience (y compris l’activité spontanée du système nerveux embryonnaire) sélectionne et stabilise certaines combinaisons de connexions préexistantes, sans nécessiter la synthèse de nouvelles molécules ou structures induites. L’apprentissage est ainsi une forme d’élimination : le cerveau produit spontanément des « pré-représentations » labiles, et l’interaction avec l’environnement en sélectionne et stabilise seulement quelques-unes, les autres étant éliminées.
Cette théorie explique la variabilité phénotypique entre individus isogéniques: le même message entrant peut stabiliser des organisations différentes mais conduire à une fonction identique. Les colonnes de dominance oculaire dans le cortex visuel se forment par ségrégation après une distribution diffuse des axones, et la privation visuelle pendant une période critique affecte leur développement. La spécialisation hémisphérique, notamment pour le langage (généralement à gauche), n’est pas strictement génétiquement déterminée. Bien qu’une prédisposition innée existe (ex: planum temporale plus large à gauche chez le fœtus), une régulation épigénétique intervient, les « potentialités » de l’hémisphère droit se perdant avec l’âge adulte. L’encombrement utérin chez les jumeaux pourrait même atténuer l’asymétrie initiale. L’empreinte culturelle est rendue possible par la longue période de développement post-natal du cerveau humain, où la majorité des synapses corticales se forment après la naissance. L’apprentissage du chant chez le moineau implique une « attrition syllabique » (élimination de types de syllabes), et l’acquisition du langage chez l’homme s’accompagne d’une perte de capacités perceptives (ex: distinction de phonèmes japonais). Ces phénomènes sont cohérents avec l’idée d’une stabilisation sélective. L’apprentissage de systèmes d’écriture complexes, comme le kanji japonais, engage des aires hémisphériques différentes (droit pour les images, gauche pour les caractères phonétiques), démontrant une plasticité fonctionnelle liée à l’environnement culturel.
🌐 Le Cerveau, Représentation du Monde : Conscience et Futur 🔮
Changeux affirme que le cerveau humain est une machine qui construit des représentations du monde.
La « Substance » de l’Esprit : Du Neuronal au Mental 🤯
Le livre s’efforce de détruire les barrières entre le neural et le mental, proposant que les unités mentales sont identifiées à des états d’activités physiques (électriques et chimiques) d’ensembles de neurones. L’« objet mental » est défini comme un état d’activité corrélé et transitoire d’une large population ou « assemblée » de neurones distribués dans plusieurs aires corticales. Cette organisation est à la fois locale et délocalisée, « entre le cristal et la fumée ». Le nombre de combinaisons possibles de neurones pour créer des concepts est gigantesque.
Des techniques d’idéographie, comme l’imagerie par émission de positrons (PET scan), permettent d’observer l’activité du cerveau à travers le crâne en mesurant la consommation d’énergie (glucose) et le débit sanguin local. Ces images montrent l’activation de différentes aires corticales en fonction des tâches (vision, langage, activité mentale). Chez les schizophrènes chroniques, on observe une hypo-frontale (faible activité du cortex frontal). L’espoir est grand que ces techniques permettront un jour de visualiser directement les objets mentaux eux-mêmes, malgré leur fugacité et leur topologie distribuée.
La conscience est définie comme ce système de régulations en fonctionnement, émergeant de l’interaction et de l’emboîtement des « toiles d’araignée » neuronales et de leurs boucles de réentrée. L’identité entre états mentaux et états physiologiques/physicochimiques du cerveau s’impose légitimement. La critique de l’irréductibilité du psychologique au neurologique est rejetée, car la fécondation d’une discipline par une autre (ex: physique et physiologie, génétique et biochimie) a toujours généré des progrès spectaculaires. La capacité du cerveau à construire des représentations (par l’activation de neurones répartis dans différentes aires corticales) détermine leur caractère figuratif ou abstrait. L’objet mental est un événement transitoire, mais la « singularité » des neurones qui le composent est plus stable, forgée par l’expression génétique et les interactions avec l’environnement. Cette composante épigénétique constitue elle-même une « représentation » stable inscrite dans le câblage neuronal.
La formation de ces représentations suit un schéma darwinien : une diversification initiale par variation est suivie d’un processus de stabilisation sélective. Au niveau génétique, mutations et recombinaisons créent la diversité, puis la sélection naturelle stabilise certaines combinaisons. Durant l’épigenèse post-natale, la « redondance transitoire » des cellules et connexions produit une diversité spatiale, dont seules certaines configurations sont stabilisées chez l’adulte. Les objets mentaux eux-mêmes pourraient se diversifier spontanément par recombinaison d’assemblées de neurones, suivie d’une sélection par « résonance ». Cette idée s’étend à des inventions culturelles comme l’écriture, qui a évolué des pictogrammes aux idéogrammes, puis à l’alphabet par un processus de diversification et de « stabilisation sélective » des signes. Les théories « instructives » (comme l’hérédité des caractères acquis de Lamarck) ont historiquement précédé les théories « sélectives » (comme le darwinisme) car ces dernières sont plus complexes à concevoir et à prouver.
Enfin, le livre explore la relation entre « structure » et « fonction » : l’activité fonctionnelle d’un instant laisse une trace dans la structure du cerveau, devenant elle-même structure. La distinction entre troubles « organiques » et « fonctionnels » devient alors une question d’échelle de temps.
L’Homme Neuronal et la Société : Un Dialogue Crucial 🤝
L’ouvrage se termine sur une réflexion sur l’évolution de l’homme (anthropogénie). L’homme moderne, Homo sapiens sapiens, se distingue par le développement brutal de son cerveau, notamment le néocortex, en quelques millions d’années. Cette évolution est d’autant plus remarquable que l’homme et le chimpanzé sont génétiquement très proches (différence de seulement 0,8% dans les séquences protéiques). Le « paradoxe de non-linéarité évolutive » (faible changement génétique, forte complexité cérébrale) est expliqué par l’action différentielle de quelques « gènes de communication » embryonnaires et l’intervention de l’épigenèse par stabilisation sélective.
La taille du cerveau a considérablement augmenté chez les ancêtres de l’homme (triple en quelques millions d’années), reflété par l’augmentation de la capacité crânienne (ex: Homo habilis à 638 cm³, Homo erectus à 800-1200 cm³, Homo sapiens à 1200-1400 cm³). Le développement privilégié du lobe frontal et la multiplication des sillons corticaux témoignent de cette évolution. La fabrication d’outils et le développement culturel (inhumation des morts) sont des indicateurs des fonctions cérébrales de ces hominidés.
Changeux souligne que l’évolution du lien social chez les primates supérieurs pourrait être une conséquence de l’épanouissement du néocortex, mais il n’exclut pas une rétroaction de l’environnement social sur l’évolution génétique. Des hypothèses sur l’alimentation (chasse nécessitant coopération), la polygamie des chefs (propagation des gènes des plus aptes), ou la compétence maternelle sont évoquées. La dérive de l’agressivité intra-espèce pourrait aussi avoir favorisé le développement cérébral.
Le livre conclut en interrogeant la relation entre l’homme neuronal et son environnement social actuel. L’usage massif de tranquillisants (comme les benzodiazépines, 7 millions de boîtes par mois en France) suggère une dysharmonie profonde entre le cerveau humain et le monde qu’il a produit. L’homme moderne doit-il s’endormir chimiquement pour supporter son environnement ? Cette question, posée avec gravité, invite à une réflexion approfondie sur l’avenir de « l’Homme Neuronal » et sur la nécessité de construire une « image » de l’homme qui convienne à son futur.
« L’Homme Neuronal » n’est pas seulement un résumé des connaissances neurobiologiques ; c’est un plaidoyer pour une approche matérialiste et scientifique de la pensée et de la conscience. Il nous pousse à comprendre que les mystères du psychisme sont, en réalité, les défis complexes d’une machine biologique extraordinaire, dont les secrets sont progressivement révélés par la science.