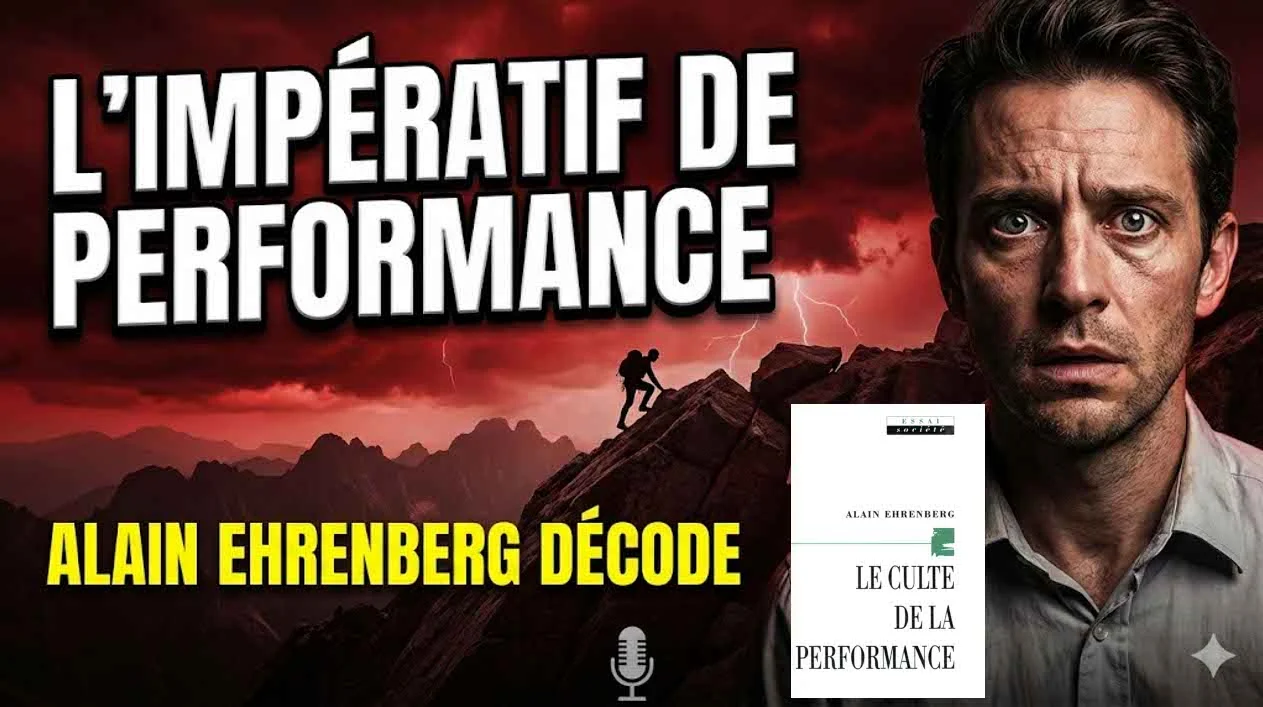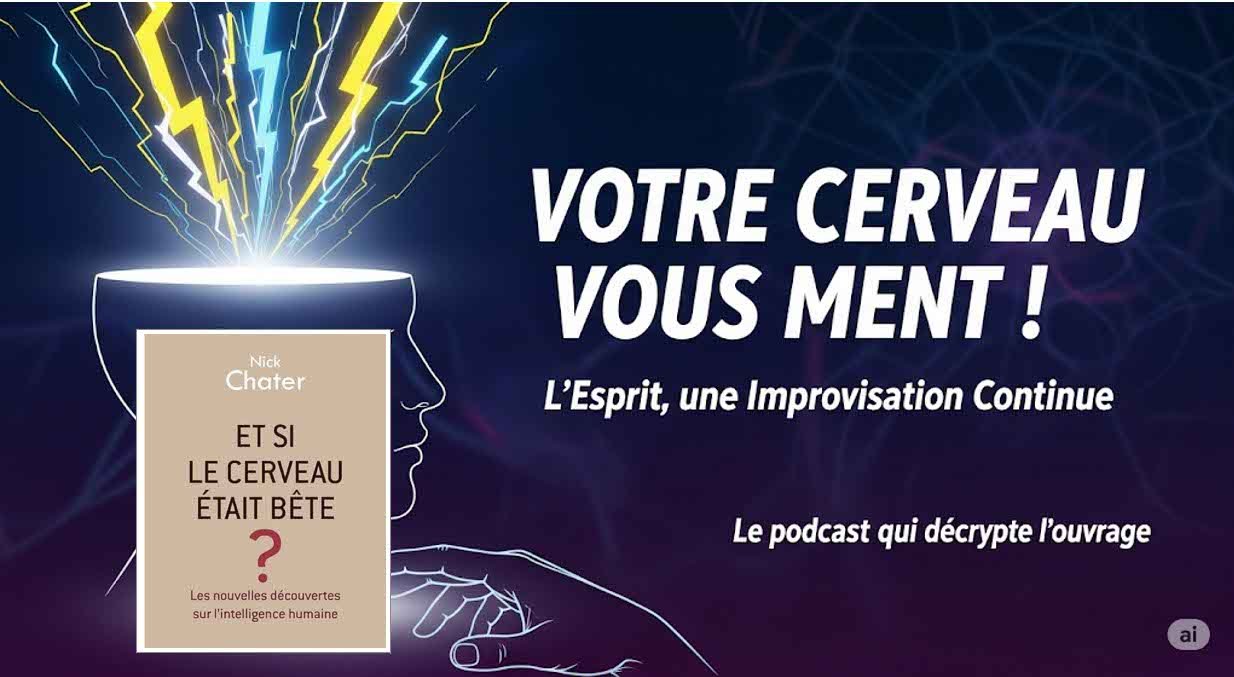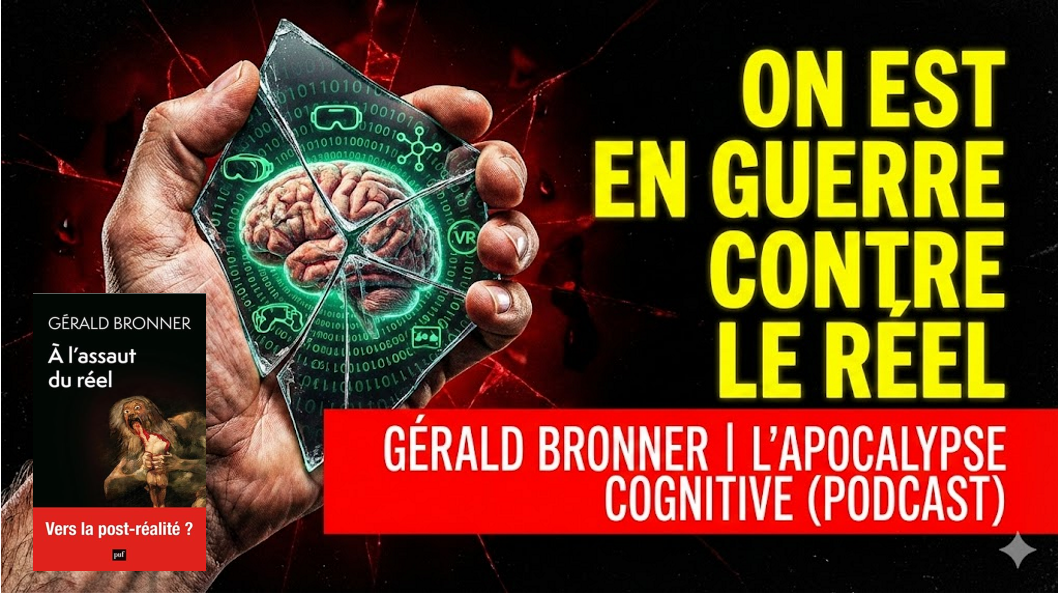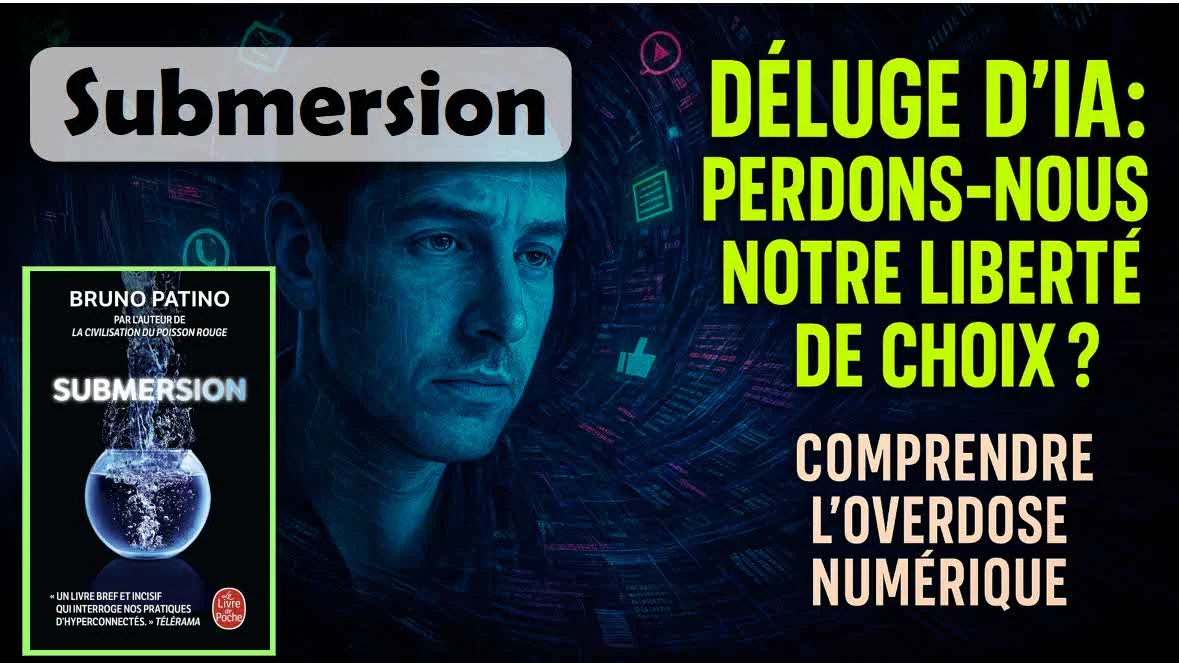Les liens pour vous procurer les différentes versions
📗Lien vers le livre papier : https://amzn.to/4kx8WtV
📘🎧Lien vers le livre audio : https://amzn.to/45b30lx
📕Lien vers l’ebook : https://amzn.to/3Fpmcl6
L’Heure des Prédateurs 🐆 : Quand les Maîtres du Chaos Redéfinissent la Politique Mondiale
Dans son percutant ouvrage, « L’heure des prédateurs », Giuliano da Empoli propose une analyse fascinante et troublante des dynamiques de pouvoir contemporaines. À travers le regard d’un « scribe aztèque », il dresse un parallèle saisissant entre l’arrivée des conquistadors espagnols dans l’Empire aztèque et l’émergence des nouvelles forces qui remodèlent aujourd’hui la scène politique mondiale : les autocrates décomplexés et les seigneurs de la tech. Ce livre est le récit de cette « conquête », capturant le « souffle d’un monde » qui sombre et « l’emprise glacée d’un autre » qui prend sa place.
Giuliano da Empoli, écrivain et conseiller politique italo-suisse, connu pour ses ouvrages comme « Les ingénieurs du chaos » et « Le mage du Kremlin », nous emmène dans un voyage à travers les coulisses du pouvoir, de New York à Riyad, de l’ONU au Ritz-Carlton. Il observe comment, face à la « foudre et au tonnerre d’Internet, des réseaux sociaux et de l’IA », les responsables politiques des démocraties occidentales ont réagi avec une « docilité » rappelant celle de Moctezuma II face à Hernán Cortés. Une hésitation qui, comme pour l’empereur aztèque, a conduit non pas à éviter la guerre, mais à subir « et le déshonneur et la guerre ».
🏛️ Le Mythe Aztèque face aux Conquistadors de la Tech
Le point de départ de l’analyse de Da Empoli est l’histoire de la réponse de l’empereur aztèque Moctezuma II à l’arrivée d’Hernán Cortés. Face à ces visiteurs inattendus, décrits comme dotés de « pouvoirs surnaturels » – recouverts de métal, chevauchant de « grandes bêtes » et maîtrisant le « souffle de feu et le tonnerre » – les conseillers de Moctezuma étaient divisés. Fallait-il repousser les intrus immédiatement, malgré leur apparence divine, ou s’incliner face à ce qui pourrait être le retour du dieu Quetzalcóatl ? Pris entre ces avis, l’empereur choisit l’indécision, envoyant des cadeaux mais interdisant l’accès à la capitale. Le résultat fut désastreux : il « eut et le déshonneur et la guerre ».
Selon l’auteur, c’est exactement ainsi que les responsables politiques des démocraties occidentales se sont comportés « face aux conquistadors de la tech » au cours des trente dernières années. Confrontés aux innovations massives comme Internet, les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle, ils se sont « soumis, dans l’espoir qu’un peu de poussière de fée rejaillirait sur eux ». Da Empoli décrit des scènes répétées dans les capitales, où les politiques suppliaient les « oligarques » de la tech pour des pôles de recherche ou des laboratoires d’IA, se contentant finalement d’un « selfie à la va-vite ».
Cette docilité n’a pas assuré la survie de l’autorité des gouvernants. Les conquistadors de la tech, après avoir fait mine de respecter cette autorité, ont progressivement « imposé leur empire ». Aujourd’hui, « l’heure des prédateurs a sonné ».
🏙️ L’Assemblée Générale de l’ONU : Miroir du Désarroi Politique
Les chapitres consacrés à l’Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre 2024 offrent une immersion dans ce nouveau monde. L’ONU, décrite comme « le dernier lieu où des gens qui n’ont pas l’habitude de se parler peuvent le faire », est aussi un lieu de chaos et de désillusion.
L’auteur y décrit trois niveaux d’observation : celui des dirigeants, « convaincus d’être le moteur du monde », celui des conseillers et sherpas qui « tissent leur toile », et celui des gardes du corps, pour qui la notion de périmètre de sécurité est une « utopie ». Multipliez ces trois niveaux par les cent quatre-vingt-treize délégations nationales, chacune avec la « conviction d’être au centre du monde », et vous commencez à comprendre pourquoi les Nations unies ne peuvent pas fonctionner, tout en étant indispensables.
Physiquement, l’ONU est un lieu où les corps des puissants, habitués aux « vastes espaces des palais », se retrouvent « à l’étroit dans les couloirs et les salles claustrophobes du Palais de verre ». Le corps du puissant, d’habitude une « entité abstraite », symbole de la nation, redevient ici un simple corps physique, courant, se pressant, se heurtant aux autres. L’Assemblée générale est le moment « où les hommes de pouvoir redeviennent des corps ».
Malgré le faste et l’histoire (évoquant les discours de Kennedy, Castro, Khrouchtchev, Arafat, Reagan), la réalité est que « quel que soit le moment, il n’y a jamais plus de quinze personnes qui écoutent l’orateur à la tribune ». L’objectif des discours n’est pas d’enflammer la salle, mais « d’envoyer le bon signal ».
L’exemple des hommes en marron entourant le président de l’Autorité palestinienne illustre l’épuisement et la fatigue qui peuvent régner. Ces hommes, « mine usée de bureaucrates ou d’anciens guerriers devenus bureaucrates », restent inanimés à travers le monologue de leur chef et les propos du président français, jusqu’à ce qu’un « seul mot, inattendu » ne soit prononcé, les faisant s’animer, prendre des notes et échanger des regards. Ce mot symbolise les rares moments où quelque chose de réel perce le rituel.
L’anecdote des gardes du corps du président iranien et des agents français et américain se disputant une position devant une porte souligne l’absurdité et la tension palpable, où la notion de « périmètre de sécurité relève ici de l’utopie ». Un incident où deux délégations courent en sens inverse dans un couloir étroit, se percutent et commencent à se bousculer, jusqu’à ce que les leaders (dont le président chilien Boric) se reconnaissent et désamorcent le conflit par une accolade, illustre le mélange de chaos et de rencontres fortuites.
Ces observations contrastent avec la perception du sommet depuis les « trois grandes catégories de séries politiques » : l’héroïque (West Wing), la sombre (House of Cards), et la comédie des erreurs (Veep). L’auteur et un collègue avaient l’habitude d’évaluer chaque journée en pourcentages de ces séries, trouvant généralement environ 10% de West Wing, 20% de House of Cards, et 70% de Veep. Cependant, « les temps se sont considérablement assombris », offrant de moins en moins d’occasions de rire.
🗡️ L’Ère Borgienne : Action, Audace et Absence de Scrupules
Le cœur de la thèse de Da Empoli repose sur l’idée que le moment présent est « machiavélien » et « borgien ». Il établit un parallèle direct entre les dirigeants actuels et César Borgia, le modèle du Prince pour Machiavel.
Mohammed Ben Salman (MBS) est présenté comme la « réincarnation » de César Borgia. Décrit comme un homme d’une « grande douceur », au « sourire désarmant, presque enfantin », il cultive l’image d’un « bon géant ». Pourtant, cette façade masque un personnage « tout droit sorti des pages de Machiavel ». L’épisode du Ritz-Carlton en novembre 2017, transformé en prison de luxe pour des centaines de princes, ministres et milliardaires saoudiens, en est une illustration parfaite. Accueillis par des invitations, séparés de leurs escortes, on leur a confisqué leurs biens et distribué des tenues de rechange identiques. Les interrogatoires qui ont suivi, menés avec l’aide de mercenaires de Blackwater, ont impliqué des « techniques d’interrogatoire musclées » et ont permis de récupérer plus de cent milliards de dollars. Des figures puissantes ont été humiliées, forcées de payer ou emprisonnées. Cette opération visait à « couper les têtes qui menaçaient la domination de MBS » et a instillé la peur.
L’auteur compare explicitement l’affaire du Ritz-Carlton à la « nuit de Senigallia » où César Borgia, sous prétexte de réconciliation et de banquet, attira et fit exécuter ses anciens alliés qui avaient conjuré contre lui. L’issue saoudienne fut « un peu moins sanglante », mais l’esprit est le même.
Nayib Bukele, le jeune président du Salvador, est un autre adepte de l’action « borgienne ». Qualifié de « dictateur le plus cool de la Terre », « roi philosophe » ou « Caudillo millénial », il a utilisé une « initiative audacieuse et de moyens expéditifs » pour produire une « divine surprise ». Face à une criminalité endémique, sa réponse a été radicale : décréter l’état d’urgence et faire arrêter « toutes les personnes tatouées », envoyant quatre-vingt mille personnes en prison. Le tout mis en scène dans des vidéos virales sur les réseaux sociaux. Malgré les critiques des ONG, le taux d’homicides a chuté drastiquement, faisant du Salvador le pays le plus sûr de l’hémisphère occidental.
Bukele opère dans une démocratie dont il « teste les limites ». Il a utilisé l’armée pour intimider le Parlement, révoqué des juges pour les remplacer par ses partisans, et modifié l’interprétation de la Constitution pour se faire réélire avec 84% des voix et une majorité écrasante au Parlement. Sa logique est celle de la victoire totale, rejetant l’idée de modérer son succès électoral pour préserver un équilibre des pouvoirs.
L’un des principes fondamentaux des borgiens est l’action résolue, surtout en « situation d’incertitude, lorsque la légitimité du pouvoir est précaire ». L’inaction conduit inévitablement au désavantage. Cette action doit souvent être « irréfléchie » pour produire un « effet de sidération sur lequel se fonde le pouvoir du prince ». Les exemples incluent l’emprisonnement du Premier ministre libanais Hariri à Riyad, l’assassinat de Jamal Khashoggi, ou le piratage du téléphone de Jeff Bezos, tous attribués à l’initiative de MBS.
Donald Trump est présenté comme une « forme de vie extraordinairement adaptée au temps présent ». Son approche politique, décrite comme celle d’un « analphabète fonctionnel » capable d’atteindre une « forme de génie dans sa capacité à résonner avec l’esprit du temps », privilégie l’oralité et refuse de lire des notes structurées. Il fonctionne à l’instinct, en « action », car « la connaissance, comme on le sait, est l’un des pires ennemis » de l’action audacieuse nécessaire pour « sidérer les adversaires » dans un environnement chaotique. Trump reprend d’ailleurs les idées « borgiennes » de Bukele sur la délinquance (« une journée vraiment méchante… une heure brutale ») et celles de Javier Milei sur la coupe des dépenses publiques.
📱 Les Conquistadors Numériques et le « Contrôle Manuel »
Les seigneurs de la tech sont étroitement liés à cette nouvelle ère. Ils partagent de nombreux traits avec les borgiens. Ils sont souvent des « personnages excentriques » qui ont brisé les codes, se méfient des experts et des élites de l’ancien monde, ont un « goût de l’action » et sont convaincus de pouvoir « modeler la réalité selon leurs désirs ». Pour eux, la « viralité prime sur la vérité et la vitesse est au service du plus fort ». Ils méprisent les politiques et les bureaucrates, sentant que leur époque est révolue.
Elon Musk est un exemple contemporain de cette convergence. Après avoir soutenu des figures comme Bolsonaro, Milei, Bukele et Trump, il s’engage en Europe auprès du parti du Brexit et de l’AfD en Allemagne. Da Empoli souligne que son soutien à l’AfD n’est pas une simple excentricité, mais révèle une tendance plus profonde des « conquistadors de la tech » à vouloir « se débarrasser des anciennes élites politiques ». Ces nouvelles élites technologiques n’ont rien à voir avec les « technocrates de Davos » ; leur philosophie repose sur « une sacrée envie de foutre le bordel ». L’ordre, la prudence, et le respect des règles sont rejetés.
Pourtant, cette convergence n’a pas toujours été évidente. Eric Schmidt, ancien PDG de Google, est présenté comme l’opposé d’Elon Musk par son approche douce et conciliante. Surnommé le « cardinal » de la tech, il a joué un rôle crucial dans la transformation de Google et a été très influent sous la présidence Obama. Schmidt a aidé l’équipe de campagne d’Obama en 2012 à construire « la plus vaste base de données électorales que le monde ait jamais connue », le « projet Narval », pour cibler individuellement chaque électeur. Grâce à cette technologie, la victoire d’Obama en 2012 est qualifiée d' »essentiellement technique », par opposition à la nature plus politique de celle de 2008.
Cette proximité entre les démocrates américains et les entreprises de la tech a conduit le « parti des avocats » (terme utilisé pour décrire les démocrates, beaucoup d’entre eux ayant une formation juridique) à « oublier d’imposer la moindre règle aux plateformes ». Même face aux preuves que le pouvoir des plateformes altérait le fonctionnement de la démocratie, les démocrates n’ont pas sérieusement envisagé de leur imposer des responsabilités. Cela a permis à l’IA de se développer « sans aucun contrôle, aux mains d’entreprises privées qui s’élèvent au rang d’États-nations ».
Depuis trente ans, les démocrates américains se sont « couchés devant les entrepreneurs de la tech », permettant à ces « gentils nerds » de se transformer en « effroyables molochs ». Da Empoli établit un parallèle avec la conquête de l’Empire mexicain, où une poignée d’Espagnols n’auraient pu réussir sans la « complicité de squires locaux ». À « l’âge de la colonisation numérique », les dirigeants modérés ont joué un rôle similaire, certains se mettant même au service des nouveaux conquistadors, comme Al Gore ou Nick Clegg.
La « convergence structurelle » entre les seigneurs de la tech et les borgiens est devenue évidente. Ils « tirent toutes deux leur pouvoir de l’insurrection numérique et aucune n’est prête à tolérer de limites à sa volonté de puissance ». Les avocats sont considérés comme leurs « ennemis naturels ».
⚖️ Le Déclin des Règles et le Triomphe du Chaos
L’ouvrage dépeint un monde où les règles et les procédures de l’ancien ordre politique s’effondrent. L’ancien « consensus de Davos », basé sur la gestion compétente et les principes libéraux, a explosé. L’ère des prédateurs ignore les garde-fous comme le respect des institutions, les droits humains ou les répercussions internationales. La seule option semble être « Pedal to the metal », l’accélérationnisme. La « fenêtre d’opportunité » pour mettre en place un système de règles s’est refermée. L’idée même de limites à la force, à la finance, à l’IA ou au basculement de l’ordre international vers la « jungle » est devenue inconcevable.
Les borgiens excellent dans ce monde « sans limites ». Ils ne font pas que résister à l’adversité ; ils « tirent leur force de l’inattendu, de l’instable et du belliqueux ».
Une illustration frappante de ce décalage est l’anecdote du dîner inaugural de la fondation Obama à Chicago en 2017. Venu chercher des idées face à la vague illibérale, l’auteur assiste à des discours sur le potager de Michelle Obama et découvre un dîner où les invités doivent répondre à des questions dirigées par un « facilitateur de conversation » pour atteindre un niveau d’échange « plus profond ». Cette scène, où même l’agent de sécurité du groupe se sent mal à l’aise et rapetisse à vue d’œil, symbolise le décalage entre les élites libérales et le « peuple ». L’auteur conclut que cet agent de sécurité, s’il avait été un électeur, serait ressorti « trumpiste » de ce dîner.
Pour Da Empoli, les démocrates, en se rabattant sur la représentation des minorités plutôt que de s’attaquer aux inégalités économiques, ont abandonné les « enjeux décisifs ». Leur focalisation sur une bataille « de plus en plus extrême pour les droits » les a conduits à des positions radicales déconnectées de la majorité de leurs électeurs. Le « wokisme » est ainsi devenu « du pain bénit » pour les borgiens, car il « contribue à élever le niveau du conflit » et à « alimenter leur machine du chaos ».
L’ancien patron de Cambridge Analytica, Alexander Nix, expliquait leur approche en comparant la vente de Coca dans un cinéma. Pendant que les agences traditionnelles se concentrent sur la publicité et les points de vente, Nix expliquait que leur méthode consistait à « augmenter la température dans la salle de cinéma » pour que les gens aient soif. Appliqué à la politique, cela signifie « augmenter la température pour multiplier l’engagement », identifier les « sujets chauds », pousser les « positions les plus extrêmes » et projeter l’affrontement sur l’ensemble du public pour « surchauffer de plus en plus l’atmosphère ».
Les plateformes numériques, bien qu’elles se présentent comme transparentes, sont des « miroirs de foire » qui déforment la réalité. Les ingénieurs de la Silicon Valley sont devenus des « programmateurs de comportements humains ». En confiant notre rapport à la réalité à ces plateformes, nous nous mettons entre leurs mains et celles de ceux qui alimentent le « réchauffement du climat social ». L’idée que « l’on ne voit que ce que l’on croit » est devenue la « principe logique de l’époque », touchant même les élites.
🤖 L’Intelligence Artificielle : Une Intelligence Autoritaire ?
L’intelligence artificielle occupe une place centrale dans cette ère des prédateurs. Elle est présentée non seulement comme un accélérateur de pouvoir mais comme une « nouvelle forme de pouvoir », une « intelligence autoritaire ».
Lors d’une réunion à Lisbonne en mai 2023, l’auteur observe les « papes de l’IA », Sam Altman (OpenAI) et Demis Hassabis (DeepMind), s’adresser à un auditoire de dirigeants et d’experts mondiaux. Malgré leur position de pouvoir, ces « amis de Kissinger » (en référence à Henry Kissinger, qui s’intéressait aussi à l’IA), apparaissent « désemparés » face au monde nouveau décrit par les technologues. Ils réalisent qu’il n’y a « pas le moindre point de contact entre leur expérience et le monde nouveau », que toute relation humaine avec ces « porteurs de la Bonne Nouvelle » est impossible car ils « habitaient déjà un autre monde ».
Les technologues expliquent que l’IA ne pourra jamais expliquer comment elle prend ses décisions, qu’il faudra se contenter de la fiabilité des modèles. Cette proposition équivaut à un retour à un « monde magique, incompréhensible », régi par l’IA « que l’on priera comme les dieux de l’Antiquité ». Le règne de l’IA nécessite de « remplacer le savoir par la foi ».
L’IA est décrite comme une « technologie borgienne », dont le pouvoir repose sur la « sidération » et qui se « nourrit du chaos ». Elle ne s’embarrasse ni de règles ni de procédures, et « personne, pas même ses concepteurs, ne sait comment elle prend ses décisions ». Seul compte le « résultat – le succès, dirait Milei – quelle que soit la manière dont on y parvient ». Son pouvoir n’est ni démocratique ni transparent.
Le dilemme majeur du XXIe siècle, selon Kissinger cité par l’auteur, n’est plus État contre marché, mais « l’humain et la machine ». Dans quelle mesure nos vies doivent-elles être soumises aux « puissants systèmes numériques » ? Chaque choix en faveur de l’humain, même s’il est moins efficace qu’une solution IA, aura un prix.
🏰 Le Château : La Métaphore du Pouvoir Algorithmique Opaque
Pour décrire le pouvoir opaque et insaisissable de l’IA et des plateformes, Da Empoli utilise la métaphore du « Château » de Kafka. Comme le protagoniste de Kafka, K, qui ne peut ni accéder au centre du pouvoir qui contrôle son destin, ni obtenir d’explication, nous sommes confrontés à des systèmes dont la logique nous échappe.
Ce « Château » n’est pas une hypothèse lointaine ; il est déjà une réalité, particulièrement pour ceux « en bas de l’échelle », comme les livreurs. Leur travail est entièrement régi par une application : elle attribue les tâches, guide, évalue, selon une logique parfois « impénétrable ». En cas de problème, il n’y a « personne vers qui se tourner ». L’application « tire ses conclusions et rend son jugement ».
Le Château « occupe de nouveaux espaces » et gravit la hiérarchie sociale, touchant désormais les employés, fonctionnaires, et même les professions libérales. Dans un futur proche, médecins, comptables et avocats devront se conformer aux instructions de l’IA, ne conservant une marge de manœuvre que s’ils sont « les plus puissants ». L’auteur suggère que même les dirigeants les plus puissants finiront par être rattrapés par ce Château, lorsque la supériorité des algorithmes sur leur jugement sera démontrée.
L’exemple du maire de Lieusaint, Michel Bisson, et son combat contre Waze, l’application de Google, illustre parfaitement l’impuissance face au Château. Waze, cette « petite marionnette souriante », a pour seule mission de faire gagner du temps à ses utilisateurs, quitte à déverser des milliers de voitures dans les rues résidentielles d’une petite commune, mettant en danger la sécurité des habitants pour gagner « une misérable minute ». Waze, comme ses concepteurs, souffre d’Asperger, concentré sur un seul objectif.
Face à ce problème causé par un algorithme, le maire essaie d’abord des solutions locales (modifier le plan de circulation, installer un feu rouge stratégique). Puis il tente de remonter la filière, découvrant que Waze est basé sur le travail de cartographes bénévoles. Mais il n’y a « pas même un employé en France, pas même un numéro de téléphone » pour parler aux responsables de la plateforme. Le contact avec Waze se fait via le « bourdonnement des voix lointaines du Château ». Même en sollicitant les médias (« la solution nucléaire »), le contact avec des émissaires de Waze venus d’Amsterdam se révèle futile ; ils sont polis, prennent des notes, mais n’ont « pas le moindre pouvoir ». Ils sont eux aussi « des rouages dans la machine algorithmique ». Le maire demande d’intégrer des paramètres (comme éviter les écoles), mais les émissaires s’excusent et disparaissent, et l’auteur et le maire doutent qu’ils aient fait quoi que ce soit.
Cette anecdote symbolise le désarroi face à des systèmes puissants mais inaccessibles et inflexibles, qui privilégient une logique algorithmique unique au détriment des considérations humaines et locales.
🤔 Réflexions sur la Sagesse, l’Histoire et l’Avenir
L’auteur contraste cette ère de chaos et d’algorithmes avec la sagesse de figures politiques plus anciennes, marquées par l’histoire et la guerre. Il évoque Francesco Cossiga, ancien président italien, connu pour son intelligence machiavélique et sa capacité à « fabriquer de l’inattendu », ou encore Henry Kissinger. Kissinger, un « entomologiste du pouvoir », un « dernier vieux sage » qui conseillait d' »étudier l’histoire », a appréhendé l’IA non comme un simple enjeu technique, mais comme un « enjeu politique », une nouvelle forme de pouvoir aux conséquences profondes pour la « conscience humaine ».
Contrairement aux jeunes technologues qui affichent leur « ignorance du passé » (comme Zuckerberg courant sur la place Tian’anmen ou Bezos citant un scientifique nazi), Kissinger comprenait l’importance de l’histoire pour appréhender « ce qui se passe de véritablement nouveau ».
L’ouvrage se termine sur une note de fatalisme, suggérant que « l’heure des prédateurs n’est, au fond, qu’un retour à la normale ». La période courte où l’on pensait pouvoir brider la quête de pouvoir par des règles était plutôt l' »anomalie ». Les agissements des borgiens d’aujourd’hui sont une « version actualisée » de ce que racontent les livres d’histoire.
Malgré le désarroi général face à un avenir de plus en plus imprévisible – où nous avons plus d’informations mais moins de capacité à prédire – l’auteur nous invite, à travers le regard lucide et parfois ironique du scribe aztèque, à regarder en face les forces qui sont à l’œuvre. L’article n’offre pas de solutions simples, mais un « compte-rendu aussi haletant que glaçant » d’un monde qui bascule.
Conclusion ✨
« L’heure des prédateurs » de Giuliano da Empoli est un ouvrage essentiel pour comprendre les mutations actuelles du pouvoir. En comparant les défis posés par les figures comme MBS, Bukele et Trump à ceux que Cortés représenta pour Moctezuma, et en analysant le rôle croissant des « conquistadors de la tech » et de l’IA, l’auteur met en lumière un monde où l’action, la sidération et le chaos semblent avoir pris le pas sur les règles et les compromis de la politique traditionnelle. Le livre, écrit avec la lucidité d’un Machiavel, nous invite à reconnaître cette nouvelle réalité, aussi déconcertante soit-elle, pour mieux appréhender les défis à venir.
Mots clés SEO : L’heure des prédateurs, Giuliano da Empoli, analyse livre, résumé, politique mondiale, pouvoir, autocrates, seigneurs tech, IA, Machiavel, César Borgia, MBS, Nayib Bukele, Donald Trump, Elon Musk, Eric Schmidt, ONU, démocratie, chaos, algorithmes, Waze, Kissinger, critique politique, géopolitique.